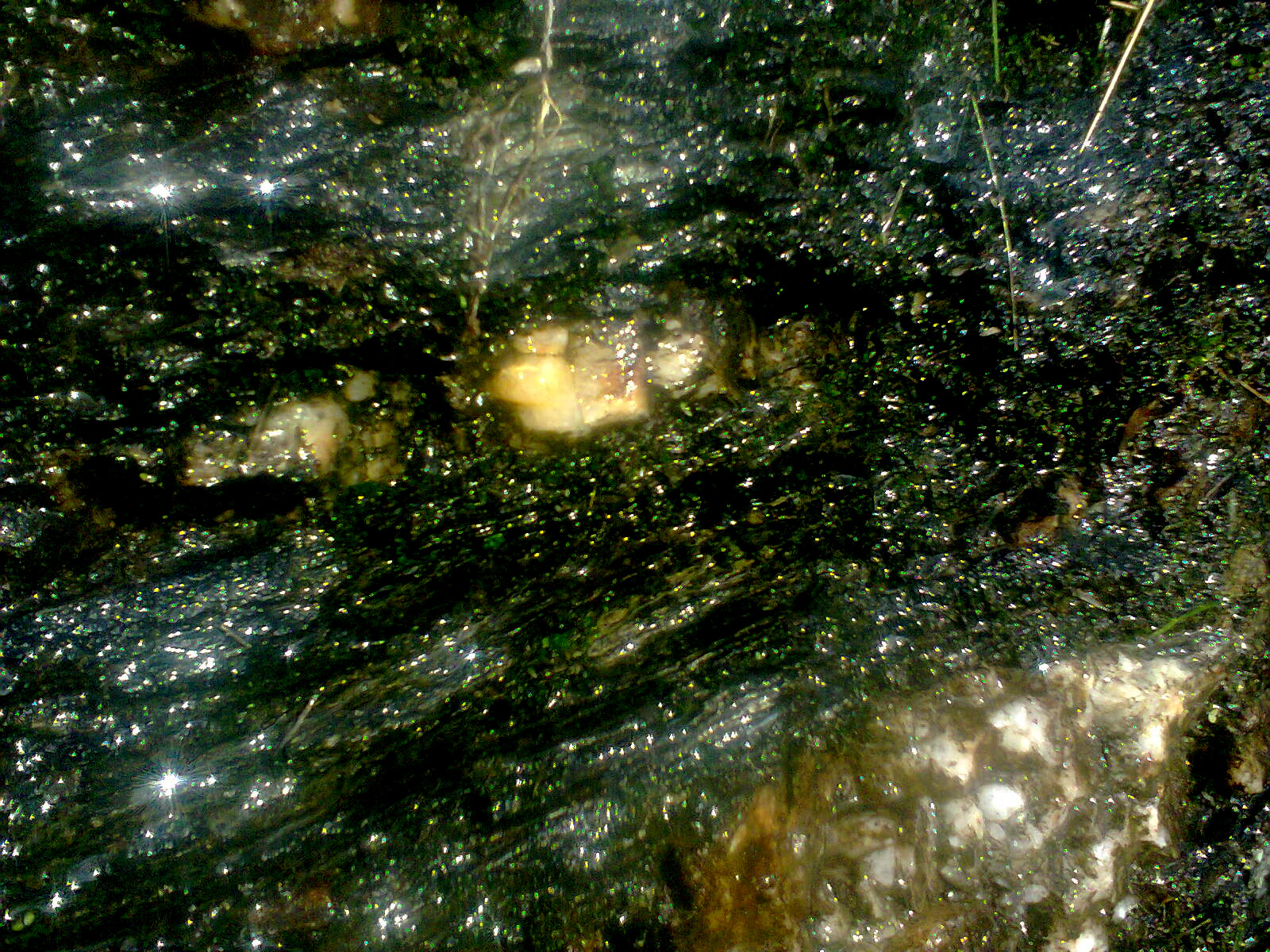
samedi 20 mars 2021
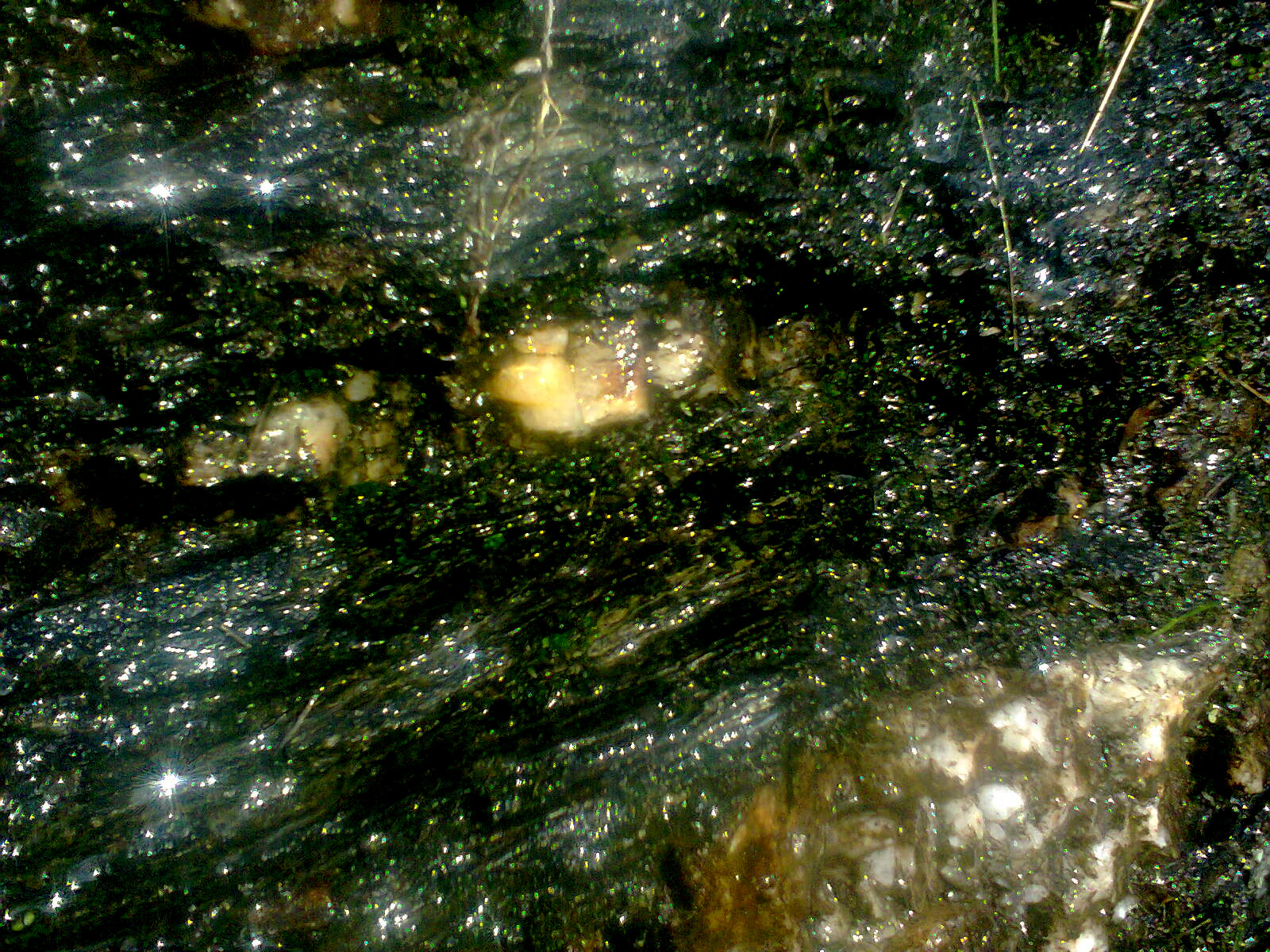
Il faut vraiment s'adresser à un phénomène général, le positionnement du pessimiste écologique.
En fait cela se résume à:
«Puisque tout est foutu, pas la peine de chercher la porte de sortie».
«Puisque nous sommes des nuisibles agressifs, ce sera pour le mieux si l'on disparaît.»
Il est facile de comprendre ainsi le raisonnement derrière la pensée – il nous absout d''une réflexion soutenue sur les changements que nous pourrions mettre en œuvre pour que tout ne soit pas foutu, tout en paraissant absolument raisonnable. Il fait supposer qu'on y a déjà réfléchi, qu'on a déjà pesé le pour et le contre.
La science, les tendances, le fait même que nous risquons un effondrement grave, tout renforce le point de vue «abandonnez tout espoir, ceux qui passent par là.» Il n'y a ni responsabilité ni culpabilité si il n'y a pas de solution. Toute bonne volonté est un bonus, un acte de charité condescendant. Cette pensée négative nous permet de nous concentrer sur nos vies quotidiennes sans gène.
Elle convient bien, donc, à tous ceux qui ont une «vie quotidienne» plus ou moins en équilibre, à défendre cette équilibre.
Elle se manifeste surtout face aux constructivistes et aux progressistes, ceux qui refusent d'abandonner tout espoir, qui proposent des changements, vite caractérisés de «radical», de cette vie quotidienne. Ces derniers se voient obligés de défendre leur point de vu, comme s'ils étaient des optimistes qui nient la réalité. Premier indice explicatif de l'éco-pessimisme, c'est un positionnement de contre-attaque défensif.
Il permet la liberté d'expression. «J'en ai marre des solutionnistes écologiques» veut-il dire. «J'adore être réactionnaire, juste pour décontenancer cet incessant débit de pensée politiquement correcte mal-fondé.» On peut le comprendre, la plupart des solutions écologiques proposées ne sont pas bien fondées et ceux qui les proposent devraient pouvoir démontrer leur efficacité. Il y a une fonction à l'éco-pessimisme, il permet de bien choisir avant d'agir.
En temps de guerre, la pensée négative est étiquetée «défaitiste» - elle sape le moral. Dans une situation génocidaire, ce genre de pensée peut être considéré comme «génocidaire» - conductif au génocide. Pour normaliser une situation d'hystérie collective, d'état d'urgence perpétuelle, on refuse de participer à l'extrèmisation et la censure. C'est le sens d'humour du soldat.
Faisons une deuxième passe. Est-ce qu'il y a des raisons sincères pour en vouloir à l'humanité jusqu'au point de désirer sa disparution? Émotivement, oui. On pourrait apprécier que quelqu'un qui a subi la torture ou perdu sa famille à cause de la violence des hommes peut les regarder de mauvais œil. Mais en général, ce n'est pas ces gens-là qui sont si misanthropes. Aimer la vie, aimer soi-même, vouloir être «en vie», ce sont des choses qui ne marchent pas de manière linéaire avec ce qu'on appelle le «niveau» de vie. C'est ceux qui ont les vies les plus dures qui sont, le plus souvent, les plus donnés à la vie.
Par rapport à l'idéologie philosophique qui justifie ou invalide la thèse du péché originel ou inversement l'essentielle bonté de l'homme, il surgit la question de preuves plus matérielles. Notre compréhension de la sélection «Darwinienne» est colorée par nos idées reçues. Concevoir de la vie comme une bataille où c'est le plus fort qui gagne, c'est la survie du plus apte défini par Darwin, ou on le suppose : a priori cela paraît logique. Mais dans les faits, le plus apte c'est souvent le plus doux – ne représentant pas de menace, il ne provoque pas de réponse conflictuelle. Le plus apte peut aussi être celui qui arrive à générer le plus de soutien social, c'est, par exemple, le cas pour les enfants en général. La survie du plus apte ne parle pas, en fait, des compétences individuelles, sinon des gènes transmises – l'individu peut être mort, sa descendance non – et c'est cela qui compte, du point de vu évolutionnaire. Dés que l'on vit en société, la protection du groupe et non pas la protection purement égoïste de soi-même et de ses proches peut se révéler la stratégie gagnante, en termes évolutionnaires.
Si on considère ce que diable peut bien faire l'homme pour justifier un tel rancœur de la part des éco-pessimistes, il est vrai qu'il y a des bonnes raisons pour lui en vouloir. La position industrielle et coloniale est extractiviste – on s'en fout de la destruction qu'on laisse derrière. Comme dans une guerre, la mobilité permet de spolier des terres ennemis et rentrer chez soi après. C'est cela «l'externalisation» des coûts.
Mais le paradigme écologique est très pointu là-dessus: c'est terminé pour l'externalisation, l'ennemi s'invite chez nous. On s'y prépare avec une nationalisme et une xénophobie rampante, ce qui ne promet pas d’y jeter grande lumière dessus.
C'est une explication sociopsychologique du pessimisme écologique: ne pouvant plus nous isoler du mal, nous en faisons logiquement partie. Nous sommes à découverte, tous pourris (tous ensemble), plus la peine de nous faire passer pour des gentils. C’est la force « autruche » de la stupidité collective.
Mais ce sont des faits conjoncturels, c'est-à-dire que rien n'est écrit dans le sable. Au contraire, on peut épingler certains aspects de nos cultures qui sont nocifs, sans pour autant généraliser sur la nature nocive de l'homme ou de sa culture. On peut ainsi se séparer du mal, en essayant de faire autre chose. L'écopessimiste perçoit la menace, il ne veut pas se trouver isolé dans son atroce nihilisme. Il ne suffit donc pas de garder son opinion pessimiste à l'abri: il faut éliminer les lueurs d'espoir chez les autres, éteindre les foyers de construction d'un monde qui a un avenir.
Pour cela, l'écolosceptique, qui n’est qu’un écopessimiste démasqué, doit se faire passer pour quelqu'un de raisonnable, doit accuser ceux qui proposent des solutions d'être des radicaux, extrémistes, illuminés, même des éco terroristes.
Au «mais c'est foutu», il peut rajouter que ce que nous avons déjà fait va nous tuer, en tous cas, parce qu'il y a latence de quelques décennies, pour la hausse mondiale de température, par exemple. Cela nous dépasse, l'échelle est trop grande, la boîte de Pandore est ouverte, il y en a un tas, d'expressions de résignation.
En suivant cette logique méticuleusement, on pourrait lui répondre qu'il vient d'expliquer pourquoi la révolution industrielle n'a pas eu lieu et pourquoi elle ne s'est pas faite en à peine une dizaine de décennies, dans certains pays beaucoup moins.
Il est tout aussi possible de défaire rapidement les conséquences désastreuses de notre révolution industrielle qu'il l'a été de les produire. D'ailleurs, nous avons beaucoup plus de moyens et de connaissances pour le faire, maintenant.
Par exemple, notre manipulation de l'énergie solaire dans toutes ses formes renouvelables ne cesse d'augmenter, et cette énergie rayonne au rythme de quelques watts ou kilowatts par mètre carré par jour un peu partout – c'est-à-dire qu'il y en a largement assez.
Au niveau objectif, tout n'est pas foutu.
Il y a de plus en plus d'évidence, dans ce qu'on appelait la préhistoire, de notre intégration dans la nature de manière plutôt équilibrée, très proche des animaux, très affectueux envers ses petits, très expert dans l'usage des plantes, on ne peut pas vraiment maintenir que c'est dans la nature de l'homme de n'être que bête, méchant et destructeur de la nature nourricière. L'acte de cultiver indique un rapport non de dominance mais de travailler la main dans la main avec la nature. Ces observations indiquent un chemin à suivre – celui de notre réintégration naturelle. Si l'époque préhistorique nous attire plus que l'époque de l'agriculture, c'est qu'elle va plus loin – de notre point de vu, l'agriculture est le premier ps envers le productivisme et l'externalisation de ses dégâts.
Prenons l'analogie du cancer. Il y a ce qu'on appelle les cancers bénins et les cancers malins, la différence étant que les cancers bénins ou semi-bénins ne risquent pas (normalement) de croître outre-mesure, ou de développer des métastases. Le cancer, comme pathologie, nous préoccupe parce que c'est une croissance désordonnée dans l'organisme hôte, qui ne tient pas en compte son bien être.
Des cultures, de combat ou guerrière par exemple, n'ont pas posé une menace existentielle pour l'entièreté de l'humanité pendant la plupart de notre existence. Le perfectionnement de la guerre moderne, avec ses armes de destruction en masse, elle si, pose problème. Tout comme la crise de surconsommation d'une minorité tumeureuse pose problème.
La traditionalisme de l'humain pose un problème plus grave. Le prophète fataliste qui dit «pour ceux qui passent par là, abandonnez tout espoir» est inévitabiliste en grande partie parce que nous sommes très dogmatiques, une fois formés nous avons beaucoup de mal à changer. L'industriel, la vie de confort auxquels nous nous sommes habitués, parfois depuis plusieurs générations, sont profondément enracinés dans nos us et coutumes, on ne peut pas le nier.
Le scénario qui se dessine est donc d'une vague colonialiste de rénaturalisation, de réoccupation, de reprise en main du milieu rural. La polarisation ville-campagne, qui nous a permis de ne traiter de la campagne qu'en zone productive, zone touristique, zone réservée à la nature, ne peut pas tenir. L'installation d'infrastructure urbaine partout – on peut citer les pilonnes et les câbles 4 et 5 G, peut être caractérisée d'un genre de pilonnage de la campagne, pour préparer son urbanisation.
C'est ce qui rajoute à l'écopessimisme – tout ce qu'on touche devient laid. Là où on essaie de faire fleurir la nature, on la casse, on la pollue.
Ce qui est tout à fait vrai. Il n'y a pas de plus anti-écologique que ce qui se passe actuellement dans la campagne, foncièrement industrielle.
Tout cela change, doit changer avec l'arrivée des habitants des villes dans la campagne. Pour eux, la campagne est idéalisée, étudiée, chérie. Elle est, ou devrait être à l'antipode de la ville. On peut entendre des commentaires comme «ceux qui viennent à la campagne, avec leurs voitures, comme s'ils espéraient le même niveau de confort qu'en ville, ...» Dans les faits, ce n'est pas ça. Les gens de l'arrière-pays sont beaucoup plus donnés à la voiture qu'en ville, beaucoup plus dans le modèle industriel. Le désert rural est peuplé par ceux qui l'ont désertifié. Leurs normes et leur culture est la plus dogmatiquement industrielle qui soit. Il s'ébauche un vrai choc de civilisation, la ville peut vite noyer la campagne, culturellement, et un style de vie adapté à une population réduite ne peut pas perdurer lorsque cette population augmente outre-mesure.
Tout cela est bien loin du discours des idées reçues – l' «essence de campagne» est encore sacrée, pour les gens qui occupent les positions de pouvoir et d'influence en ville. C'est paradoxal – cela coûte trop cher de vivre en campagne pour les classes pauvres, ce n'est que le classes moins pauvres qui peuvent se payer des pieds-à-terre en campagne, des vacances, des transhumances régulières. Et c'est eux donc qui en parlent, qui censurent le débat. La campagne, avec ses réserves, ses loisirs, sa «richesse» naturelle n'est qu'un Disneyland des riches, pour ce qui concerne sa représentation actuelle. Même les les progressistes sociaux se sont laissés prendre à ce jeu – ils prennent tellement de peine à créer des îlots d'excellence, de biodiversité, de paix, pour montrer le chemin.
Dans une petite ville enclavée à la montagne, tout le monde se chauffe au bois. C'est normal, c'est la ressource «biorenouvelable» qui se trouve en abondance en ouvrant sa porte. Les médecins du coin ne pensent pas à la pollution de l'air, en milieu rural, d'autant plus que les maisons des riches sont situés à mi-hauteur sur les collines et qu'on ne prend pas de mesures.
Lorsque la population se densifie, tout cela change. Les maux de l'industrialisation sont masqués en campagne parce que, actuellement, ils sont dilués. L'écopessimisme est le plus fort, dans la campagne, parce que on s'en sent préservé encore. L'arrivée des gens de la ville change la donne, comme jamais avant. C'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de devenir des «confinés dehors».