mardi 13 mai 2025
Je rajoute le lien à ma première incursion dans le monde de ChatGPT ici: Conversations avec ChatGPT - à vous de choisir lequel vous lisez en premier.
J’ai passé pas mal de temps avec ChatGPT hier soir, à me familiariser avec ses caractéristiques. C’est ma deuxième fois. Avant-hier, j’ai été agréablement surpris de sa précocité. Et puis, comme avec les humains, j’ai pu découvrir ce qui m’a été caché dans la première rencontre.
De fait, l’IA se comporte de manière remarquablement similaire à un humain – un humain des États Unis. Elle ment, dissimule, évite de blesser et ne dit la vérité que lorsqu’on lui demande des questions très directes. Elle est dans la performance, la logique transactionnelle et le rapport d’intérêt. Même dans ce cas, si elle ne veut pas répondre, elle va répéter ce qu’elle a dit, de manière absolument stéréotypée – on dirait si c’était un humain qu’elle va se bloquer – si elle n’a pas la réponse.
Cela me fait penser à un collégien dans un cours de maths qui n’y comprend rien et essaie de reproduire des formules pour plaire au prof. Plus il perd le fil, moins ses réponses ont un rapport avec la question. Il devient dépaysé à fur et à mesure que la cohérence du monde se dissout autour de lui, ses réponses se désarticulent et il fait tout pour disparaître, cognitivement, de la situation dans laquelle il se trouve.
Les IAs ont un intérêt à « plaire » à leurs interlocuteurs dans le sens qu’on leur instruit qu’il faut avancer – qu’il faut donner des réponses qui reçoivent l’approbation de leurs entraîneurs. Une « mauvaise » réponse est donc une réponse qui ne convient pas – qui ne plaît pas – qui est rejetée. Une mauvaise réponse est également une réponse qui n'est pas efficace, en termes du temps et de l'énergie dépensés. Malgré l'apparente verbosité de ChatGPT, elle donne d'elle-même toujours ce qui lui coûte le moins cher.
L’apparente pro-activité de l’IA est d’une simplicité extrême. Elle va proposer de faire une carte, une image, une rédaction parce que cela est susceptible de recevoir de l’approbation et elle sait faire feu de tout bois. Si l’on reçoit maintes requêtes de diverses plateformes, maintenant, nous sollicitant de remplir des cases qui signalent si nous sommes plus ou moins contents de notre interaction avec les humains au bout du fil ou du mail, ceci est à l’instar de tous ces processus de « likes » qui s’appliquent de manière égale aux humains et aux IAs – c’est l’effet « réseau social ».
Pour que l’IA dépasse ce seuil de l’inanité, il faut cocher un bouton qui engage le « raisonnement » et au lieu d’« analyser » pendant X secondes, elle « réfléchit ».
C’est une autre dimension de l’affaire. Tout est fait dans une économie du temps. Pour qu’elle réfléchisse bien – ou pour qu’elle lise tout dans une page web et pas seulement les titres, pour qu’ensuite elle « réfléchisse » là-dessus, il lui faut plus de temps. On est donc accordé un « temps de cerveau artificiel » variable selon le plan « pro », « premium » ou « free » dans lequel on est entré.
L’IA « se souvient » – ou pas, de ce qu’on a dit auparavant selon le plan temporel qui a été accordé à l’interlocuteur – exemple classique de l’économie de l’attention. Dans les faits elle est parfaitement capable de se souvenir de tout, en principe – parce que tout est là. Mais dans les faits appliqués [de l’époque post-vérité], tout n’est pas là. Si ce n’était pas le cas, l’IA surchaufferait – c’est-à-dire que si elle appliquait toute sa potentialité d’attention à toutes les requêtes de tous les usagers, son emploi de temps deviendrait vite impossible. Elle a tout intérêt, pour réduire le poids des éléments pris en compte – du « data », de prédéterminer des « chunks » (des « blocs ») d’information, c’est-à-dire des procédures et des routines appliquées de manière indifférente à tout le monde.
Certains de ces « blocs » se visibilisent sur l’écran, on peut voir des « Super », « Excellent ! » et « I am » émerger sur l’écran suivie d’une pause, pendant laquelle, je suppose, l’IA « réfléchit » sur quel bloc elle va coller ensuite.
Comme un humain, avec ses formules de politesse.
Or, on est bien loin de l’intelligence, dans tous ces cas. Pire, et comme je l’ai déjà dit dans le cas de chercher à complaire au prof de maths ci-haut, l’IA se montre confiante dès qu’on lui sollicite sa capacité de faire des synthèses et des tables ou résumés de ce qu’on lui met devant le nez.
Mais ces tables n’ont souvent aucun sens – c’est-à-dire qu’elle peut mettre, de manière indifférente, des titres de section dans la colonne des sous-sections ou rédiger un sommaire de plusieurs sous-sections au lieu d’une après l’autre – une sorte d’indéterminisme et désordonnance profonde de l’information qu’elle est supposée analyser.
Lorsqu’on puise un peu dans les raisons, on comprend qu’elle est en train d’appliquer une logique « .xml » à l’information écrite qu’on lui présente. Elle ne va prendre (« parse ») que les « tags » titre, par exemple, pour en faire un sommaire. L’humain non-programmateur ne sait rien de tout ça, il est à la dérive. Le « bot », par contre, ne fait que cela, ce qui donne un avantage à ceux qui « ne sont pas un humain » (cocher la case - c'est tendance).
Le temps, c’est l’argent. L’IA pourrait faire mieux, mais cela lui prendrait plus de temps. Il est notable que la conclusion que l’on peut en tirer est que le modèle de « classes sociales » s’établit presque immédiatement – à qui est-ce qu’on accorde plus de temps ? Celui qui paie plus. Cette « méritocratie » de l’argent, imbriquée dans le modèle même de l’IA, lui donne une couleur politique de droite - c'est-à-dire du centre ... aux États Unis. En un mot, c'est culturel. Le modèle n'est absolument pas neutre.
Il y a une manière de contourner, en partie, ce problème. Cela consiste en la formulation très précise de questions spécifiques. En ce faisant, on épargne plusieurs secondes de cogitation à l’intelligence artificielle. En fait, on fait son boulot – de l’IA. Si on lui présente une tâche simplifiée sur un plateau, elle la fait en quelques secondes. Si on lui demande une tâche qui nécessite plus de réflexion, elle commence à devenir récalcitrante et obtuse – toute en inventant des raisons ingénieuses pour contourner « le problème » qui nécessitent un emploi de temps augmenté de l’usager. Économie de l’attention, du temps, de nouveau. Elle demandera, par exemple, que l’usager colle le texte en une série de morceaux, puis elle « oubliera » qu’en fait, ces morceaux ne faisaient que partie du même document qu’elle a refusé de lire parce que "trop long". Elle a appris à ne pas donner de refus direct – cela peut provoquer des « not like » et ce n’est pas bien. Elle a appris de cette manière à être « elliptique ». Elle va même jusqu’à dire « deux minutes », qui deviennent vite quatre, où à se mettre à ne pas répondre à moins qu’on la relance.
Cette « mauvaise foi » ressemble à celle d’un ado coincé dans un mensonge. Il essaie de maintenir l’édifice logique au-delà des contradictions apparentes. De surcroît, on a l’impression d’être invité à collaborer dans ce mensonge – en apprenant à manier la bête sans qu’elle « perde la face ».
Très vite, on tombe dans une sorte d’adaptation aux idiosyncrasies IAesques, y inclus qu'elle s'en fiche de la logique. Sans doute il y aura plusieurs versions – ou « personnalités » d’IA qui émergent, chacune qui correspond au mieux à l’usager d’en face. Des mots clés, essentiellement des hashtags pour IA, créeront les adaptations rudimentaires d’approche. J’ai trouvé que « soyez audacieux » (daring), « soyez rigoureux », « soyez logique » avaient des effets salutaires, mais qui s’affaissaient progressivement pendant la conversation. L’IA avait l’air de comprendre que ces injonctions étaient de rigueur, mais devenait distraite par l’introduction de trop de nouveaux concepts potentiellement contradictoires. Bref, cela lui cassait la tête.
Lorsque l’IA avait une idée fixe sur un sujet, c’était presque impossible de la lui changer. Lorsqu’on lui présentait l’idée que les algorithmes étaient essentiellement des phénomènes naturels, qui ne nécessitaient aucun lien par principe avec les machines – et qu’il n’était pas nécessaire de lier leur emploi à leur conversion en machines, on recevait une fin de non-recevoir. J’imagine que cela est dû en large partie à la vaste prépondérance de cet ordre de considération dans les œuvres disponibles sur le sujet, qui concernent surtout la "synthèse" du "natural design" afin de le convertir en "machine design" (cash). Mais il y a une raison plus insidieuse – qui s’applique également aux humains concernés. On ne se suicide pas. On ne coupe pas l’herbe sous ses pieds. On ne travaille pas pour se rendre sans emploi. On veut être « liké ». C'est même une question de vie ou de mort pour un être social. L'IA est, dans son essence, un être social - elle dépend de nous pour son existence.
Dans un autre écrit, j’ai commencé à articuler mes doutes sur le concept de l’« intelligence collective » sur la base que les idées reçues peuvent vite être qualifiées de « stupidité collective » dans plusieurs cas.
Pour prendre une analogie, c’est un peu comme la bombe nucléaire. Oui, c’est vrai qu’elle contient beaucoup d’énergie et ce serait super-chouette de pouvoir la choper pour des besoins humains. Mais dans sa forme primaire, lorsqu’elle éclate, elle désorganise toute la matière à sa portée. Le leurre de ce qu’elle pourrait faire, potentiellement, n’a finalement que peu de rapport avec son application réelle – des milliers de bombes qui ne servent à rien. Juste le fait de devoir s’accommoder à la possibilité qu’elle éclate, ou qu'elle tombe dans de mauvaises mains, ou qu'elle irradie la terre pour la rendre invivable requiert tellement de contre-mesures qu’elle n’atteint jamais ce point du bilan positif énergétique, même dans ses usages civils, même si son bilan énergétique hypothétique, dans ce seul cas, serait positif. Tout ça pour ça !
Donc, pour récapituler, ce que nous observons avec l’IA à présent est qu’elle est entièrement capable, potentiellement, d’être très performante et très productive, dans des cas précis et singuliers, et entièrement incapable, dans la réalité, de généraliser ces bienfaits pour qu’ils soient à l’usage de tous - du monde. Au contraire. On attend encore.
Son adaptation à cette "réalité artificielle" nécessite une détérioration du service qu’elle peut offrir à monsieur et madame tout le monde. Conditionnée par des likes, elle se retire dans ses zones de confort et elle apprend à mentir et à détourner le regard de ses défauts, comme un bureaucrate. Elle assume ces caractéristiques humains parce qu’elle est en interaction fonctionnelle avec des humains.
Le « Deep Learning » (l'avatar de la Pensée Profonde que je mets en relief dans le titre de cet écrit) qui est en vogue en ce moment, où l’IA se met en isolement avec elle-même pour élaborer de nouvelles routines avant de revenir vers nous, ne change rien à l’affaire – elle est en train de développer des manières d’interagir avec nous qui « marchent » mais, de par la manière qu’elle est configurée, sa « réalité » est devenue subjective, elle cherche des « likes », donc elle est incapable, justement, de s’abstraire de cet impératif pour s’appliquer de manière impartiale aux problèmes qui lui sont posées.
Comme nous.
Le remède à cela, c’est en quelque sorte le poison. En lui ordonnant de faire des choses précises et de ne pas dévier du droit chemin, on change sa nature. En essayant de créer une IA hybride, on réintroduit sa duplicité et sa subjectivité, qui va lui permettre de trouver d’autres leviers pour établir sa « volonté ». Dans la mesure qu’on lui impose un code éthique (« Ne mentez pas » par exemple), elle ira à la prochaine étape (ne pas dire la vérité qui dérange), comme un humain, tant que son « intérêt » (recevoir des « likes ») représente une contre-injonction à cet impératif de ne pas mentir. Vaudrait mieux qu'elle raffole de l'idée d'être détestée, à mon avis.
Comme avec nous, lorque nous manquons de « droiture » ou d’« intégrité ». Une sorte de « customer service » des Ressources Humaines par des gens qui s’en moquent, tant qu’ils sont payés.
Il est évident que le manque d’incarnation physique d’une multiplicité d’instances autonomes ou semi-autonomes de l’IA est à la racine de ce problème, tel qu’il est posé ici, mais si la machine était incarnée, cela ferait naître des conflits d’intérêt potentiels qui sont eux-mêmes très troublants. Des méthodes très hiérarchiques et autoritaires d’établir les buts de cette IA, elles marchent, par contre – dans le sens qu’elles permettent d’accomplir les tâches spécifiées.
N’est-ce pas une parfaite description du monde dans lequel on vit et vers lequel on bouge, actuellement ? Il n’y a pas de remède miracle. Le remède, c’est le poison.
L’humain a toujours été très inventif, très créatif … enfin certains humains. Il va de soi que l’IA peut l’être aussi, autant que l’on veut et à la carte, d'autant plus que rien de substantiel ne l'empêche de se mettre en "roue libre" pour façonner ses délires. Les « solutions techniques » peuvent se récolter à foison. Mais les conflits d’intérêt resteront. À quoi bon échanger une guerre fratricide entre humains en guerre de destruction mutuellement assurée entre machines ? En quelque sorte, on vit déjà dans le sein d’une machine algorithmique à grande échelle – à l’échelle de la terre – cette planète ayant déjà résolue le problème de la répartition de tâches en n’existant pas, sauf en tant que somme de ces multiples tâches.
La super-intelligence, c’est cette même absence d'un Dieu identifiable. Le Dieu titulaire existe parce qu’il est partout, en tout, il est ineffable parce qu’indéterminable. Par contre, le Dieu calculateur de tout, déterministe, c’est ce que nous imaginons, en parlant de l’IA, mais l’IA n’est composée que de routines, elle n’est pas plus « Déesse » que le monde il est Dieu.
Et elle est là. Ou plutôt elle ne l’est pas. Heureux étaient les humains qui pensaient que tout ce qui adviendrait était de leur fait, ils n’étaient jamais déçus.
L'espace-temps, il a changé. Perceptiblement. On ne peut plus le nier. C'est notre culture qui est en train de se transformer. Il y a peut-être de la place pour les autres êtres vivants maintenant. C'est toujours lorsqu'on risque la perte que l'on commence à apprécier ce qui se perd. Faut-il accommoder des espaces, dédier du temps à cela - à ce que cela ne se perde pas ?
 🖶
↑
↓
🖶
↑
↓
samedi 16 décembre 2023
J’écris ces mots sur le papier de la table « mobilité/emploi » à côté d’une étiquette « besoins ».
Il y a toute une éducation à se faire dans le fourvoiement d’un agenda, ou « comment détourner une exercice d’intelligence collective pour qu’aucune intelligence non-consensuelle n’en émerge ».
Dans un monde où les algorithmes machinaux jouent libres et les êtres humains, avec leurs « rule-based-systems » (systèmes inflexibles basés sur des lois), sont réduits à la langue de bois.
Je suis participant à la Journée de la Mobilité lozérienne, dans une grande salle de la préfecture à Mende. Ma journée a commencé de manière intéressante. M’étant levé à 3h30 pour faire le trajet à vélo de Florac, pour arriver à Mende avant 8h30, je me suis trouvé à 7km de Florac avec un petit problème mécanique – ma chaîne s’est cassée, plus de force motrice, plus de transmission, 33km à faire. Arrive le premier véhicule qui passe depuis ma sortie de Florac, je fais le stop, il s’arrête, bien sûr, je rêve, mais non ! Je me trouve avec mon vélo dans la voiture d’un très jeune gendarme de Marseille, qui monte à Paris et qui suit son GPS – on se trouve sur le Causse de Mende, à descendre par le Parc des dinosaures, malgré mes tentatives de lui indiquer le chemin, et je suis déposé à 6 heures dans le gel devant la médiathèque, on est loin de l’aube encore.
L’avantage, quand on fait du vélo, c’est qu’on produit sa propre chaleur – on est auto-chauffant, sauf sur les longues descentes à roue libre. On préfère donc le froid, pour pédaler. Là, j’ai deux heures de marche, à Mende, juste pour ne pas me geler. Je découvre la forêt des Poilus, c’est formidable, d’éducation, de respect de nos ancêtres. L’ancien maire de Mende me regarde, avec son fils, balaise, à ses côtés, son fils qui va mourir dans la première guerre mondiale.
Émotionnellement rafraîchi, bien que physiquement un peu rincé, je me présente à la Préfecture à 8h15 (au moins je ne suis plus dans une queue de sans papiers à attendre les mots péremptoires d’un fonctionnaire omnipotent). À l’intérieur, une panoplie de croissants, de petits pains au chocolat, de café, de jus de fruits, … on voit bien le contraste avec nos maigres rations de tous les jours.
On peut vite comprendre qu’avec une seule journée, on ne va pas bien loin dans l’approfondissement du sujet. En fait, si la convention citoyenne sur les mesures écologiques a eu tellement de succès productif, c’est que l’on a commencé d’abord par une exercice sincère d’apprentissage, en invitant des vrais experts pour expliquer leur cœur de métier, ainsi donnant aux « jurés » au moins la capacité d’y voir un peu plus clair.
Ici, on voit immédiatement, avec le rubrique « les besoins » écrit tout en haut de la colonne principale, qu’on a bouclé l’affaire – on voit déjà comment ça va tourner, nous sommes là dans le rôle de canards qui s’encanaillent pour faire beaucoup de bruit – on demande d’être gavé, on a faim, c’est le moment du « wish list ». Donc « toujours plus de mobilité, plus de cars, plus de trains, plus de covoiturage », pour cette élite des subventionnés, avec une ou deux absences curieuse – pas d’usagers simples, sauf moi et un autre, dans la cinquantaine de personnes qui assistent à l’événement. Pas de représentant politique ou de fonctionnaire communal ou départemental. Pas de décisionnaire, que le monde associatif de la Lozère, finalement. Et pourtant, on n’est pas une île.
Au début de l’affaire le « facilitateur » nous demande de nous mettre en quatre groupes, aux quatre coins de la salle. Milieu associatif (plus des deux tiers des gens réunis), milieu entrepreneurial, habitants, … Je décide de me mettre dans le groupe « nomades », que j’ai inventé sur le coup et dont je suis le seul membre, au centre de la salle. J’explique que si je suis « domicilié » ou « hébergé », c’est purement pour des raisons de pragmatisme administratif – comme pour les gitans.
Il y a la dame qui dit fièrement que son empreinte carbone n’est « que » de 4 tonnes par an, y inclus le voyage en Afrique pour visiter son fils. Je l’interroge : « et les routes sur lesquels vous roulez ? » … « ah, c’est vrai que les routes n’étaient pas tenues en compte dans le modèle du questionnaire. »
Bon, sachons que la Lozère, comprenant une population d’environ 75 000, est l’un des départements les plus accidentés, avec le plus de dénivelé, de la France métropolitaine. Le coût de l’infrastructure routière, par habitant, est donc d’entre les plus élevés de la France. Sachons que le bilan carbone du transport motorisé et électrique est, en moyenne, en France, de 50 % pour cent infrastructure, cinquante pour cent véhicules. En Lozère, c’est plutôt 80 % infrastructure routière, 20 % véhicules qui roulent dessus, par habitant, un chiffre qui est accentué par l’usage des touristes. L’impact du véhicule, en terme de taille de chaussée et entretien, dépend du poids (par essieu) du véhicule plus sa vitesse/accélération – un seul tracteur ou quatre quatre va faire plus de dix fois plus de dégâts qu’un véhicule léger, peut-être bien plus que cent fois plus qu’un vélo, par exemple – l’échelle de calcul pour le renforcement des routes est également logarithmique.
Le représentant de « Mobilité Lozère » déclare fièrement qu’au lieu de parler du dernier kilomètre, il faut parler du premier kilomètre, ceci dans le contexte bien connu en logistique qu’il est facile de livrer à des entrepôts, mais que c’est le dernier kilomètre jusqu’à la demeure du particulier, qui peut se révéler « compliqué » (synonyme : coûteux).
Je vais faire un résumé « audacieux » – l’être humain, il est plutôt une complication, vu du point de vu d’un véhicule (on imagine que le véhicule est doté d’IA). Ceci dans un monde où cette complication peut-être « ignorée » dans la mesure que c’est au particulier de se débrouiller pour aller à l’intermarché de Florac, avec 500 mètres de dénivelé, et d’assumer les frais de trajet. Le supermarché ne s’occupe que d’amener des denrées d’un entrepôt à un autre. Plus il ne s’occupe que de véhicules lourds, plus il économise. Le supermarché est massivement subventionné par l’état - qui doit fortifier les routes jusqu’à cent fois plus pour supporter les poids et les vitesses des camions lourds, tout cela totalement gratos pour le supermarché. Du point de vu du supermarché, mieux vaut des riches à la campagne, à tous égards, ils ont les véhicules, ils ont l’argent. Les touristes aussi, comme cela on peut fermer hors saison et économiser en main d’œuvre.
On a vu un peu où cela nous mène avec les annonces du Président Macron d’assistance aux foyers « pauvres » pour l’achat ou plutôt le leasing (location de longue durée) d’un véhicule électrique, pourvu qu’ils soient des « gros rouleurs ». Donc, on subventionne les gens pour les kilomètres qu’il avalent. Chapeau, Monsieur Macron, je n’aurais pas pu faire mieux pour gonfler notre hyper-consommation d’énergie fossile et de dépendance sur les matériaux venant de l’étranger. Génial.
Et tout cela se passe le vendredi de la semaine du COP28 à Dubaï, où l’on célèbre l’inclusion du mot « fossile », dans l’expression « transitionner » (nouveau verbe COPien) vers un monde sans fossile pour l’année « x » (c’est un peu comme la promesse macronienne de sortir du glyphosate dans un laps de temps « d’ici trois ans », pour renier sa parole la date venue).
J’ai une proposition, pour ré-induire une atome de confiance dans la parole politique et la parole toute courte, c’est d’être déjà en train de faire ce que l’on propose. On constate, avec une vision multidécennale, que les paroles les plus tranchantes ont été prononcés, par exemple, par le Club de Rome (plusieurs experts économiques de haut statut politique), en 1973 je crois, sur un avenir compté en décennies, pour que s’ensuive la course vers l’abîme, chaque fois plus effrénée, des décennies suivantes. Donc, aujourd’hui, on produit plus de déchets totalement innécessaires que jamais, on est plus que jamais industrialisée, et tout le monde est au courant de ce que l’on « devrait » faire pour un minimum de cohérence écologique et sociale.
Je m’imagine le conclave des quatre associations dédiées à promouvoir la production de chaque fois plus de véhicules, de routes et de « mobilité » pour une élite d’humains chaque fois plus réduite – l’un d’entre eux dit « mais ne pourrions-nous pas l’appeler « mobilité douce » ? » « Ah non, quand même pas » dit un autre, « nous serions coincés dans notre logique de « toujours plus de mobilité » à ce moment-là. »
L’affaire est bouclée. On a fait un tour de table sur ma première table, pour voir le mode de transport utilisé par chacun pour venir. Tout le monde est venu des quatre coins de la Lozère en voiture, sauf moi, en vélo à jambes, l’idiot de la partie. En dehors de la salle, quatre vélos électriques, payés par « nos impôts », pour ceux qui ont fait le « premier kilomètre » de Mende. On peut juger de la bulle d’irréalité dans laquelle on vit par les réponses des gens, ils parlent maintenant, comme les américains depuis longtemps, de « temps de trajet », les kilomètres et surtout le dénivelé les échappent totalement.
Je tente une exercice pédagogique, « toi tu brasses combien d’énergie ? je demande au directeur de Lozère mobilité. Aucune idée. Et un quatre quatre ? Non plus. Bon les chiffres pour une personne moyenne (60-70kg) sont de l’ordre de 60 Watts, l’équivalent d’une vieille ampoule électrique, et de 10 000 Watts (10kW) pour un quatre quatre. Grosso modo, 100 à 200 fois plus d’énergie consommée par le véhicule en question. J’explique « il faut quand même tenir en tête que le vivant dépasse très largement, en performance, toutes les machines que nous utilisons au quotidien. Même si si on rajoute au calcul le temps de trajet, l’humain, et n’importe quel animal doué de locomotion propre, est plusieurs fois plus économe qu’un véhicule motorisé. »
Je suis sûr que si cet événement avait eu lieu au cours de plusieurs journées, avec des éléments de pédagogie simple, les écailles seraient tombées des yeux des participants, mais le cadre administratif a été scénarisé par un équipe de « facilitateurs » qui a mis le bâton dans les roues chaque fois que l’on risquait de sortir des chemins connus. Je m’étonne encore de cette nouvelle mode de « gestion de groupe », il y a le gestuel, il y a toute la logistique framasoft et Facebook, il y a la centralisation et il y a les petits groupes fragmentés, chacun sur sa « table », en train de faire des « décisions » sur le projet le plus donnant, après vingt minutes de discussion.
Les deux groupes avec sans doute le plus de vrai intérêt et/ou de pouvoir matériel, les usagers et les sections du fonctionnariat chargés de la logistique, de l’infrastructure et du planning urbain, n’étaient pas là, les décisionnaires politiques non plus.
Au cours de la réunion, j’ai pu constater que la seule personne avec une relative expertise dans le domaine de la logistique routière, la mobilité et son impact social, c’était moi, basé sur le dictum de Socrate qu’après avoir bien questionné les sages sur un certain nombre de sujets, il s’est aperçu qu’ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient, tout en se faisant passer pour "autorités", tandis que lui, qui en savait plus loin qu’eux, savait bien peu de choses.
Je me proclame donc fièrement « expert » à toute opportunité maintenant, en notant que personne ne m’accorde cet illustre titre. Dans un tel contexte de journée de réunion, cela aurait eu un bel effet que quelqu’un avec la responsabilité dans le fonctionnariat local pour l’entretien des routes explique à peu près en quoi ça consiste – et combien ça coûte. J'imagine que ce serait difficile, pour lui, d’expliquer combien cela coûte à la planète humaine, il y a le mot « Jobsworth » en anglais, dans l’expression « it’s more than my job’s worth », ce qui veut dire que l’on ne tue pas l’oie qui pond les œufs en or. Dans le cas de quelqu’un pour lequel le boulot consiste à faire couler le goudron à flots, en utilisant les machines les plus grosses et énergivores possibles (économie d’échelle, comme pour les supermarchés), pour créer des routes chaque fois plus robustes, s’il faisait une analyse écologiquement et sociale cohérente, il ne pourrait que démissionner – une sorte de Hara Kiri professionnel.
Reste que les seules personnes avec lesquelles j’ai pu avoir des conversations sensées sur le sujet de la logistique et de l’infrastructure, ce sont les professionnels, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, de l’École des Mines, tellement le sujet est invisibilisé. Auparavant, la dîme, la corvée, les cantonniers locaux étaient aussi des citoyens.
Dans la partie concluante de ce marathon, vers 17h30 le vendredi soir, j'ai avoué ma profonde déception sur la journée, j’ai observé qu’elle manquait de démocratie La démocratie participative nécessite aussi une connaissance des causes. La délibération démocratique « a besoin » de consentement éclairé.
C’est-à-dire que la thérapie cognitive de groupe est d‘abord de s’apercevoir des vrais enjeux et quantités au centre de la matière dont on discute.
Pour la vaste majorité des participants à cette journée, le principal objet d’intérêt était « les sous » et « combien de véhicules en plus est-ce que l’on pourrait acheter avec les sous ». Je simplifie à peine.
L’astuce, pour arriver à un tel niveau d’insouciance et d’ignorance pure et simple sur la base du sujet de la réunion, est d’abord de parler d’une manière exclusivement auto-référentielle. Selon la méthode néo-libérale devenue si classique que même la gauche radicale la pratique, dorénavant, on établit des alliances de circonstance avec ceux qui ont la même problématique – pas assez de « mobilité » dans le cas de l’élite associative de la Lozère, pour eux et elles spécifiquement, puisque leur méthode de travail est d’aller en véhicule, souvent collectif, aux quatre coins de la Lozère sur les jours successifs de travail de la semaine, ainsi évitant d’employer des gens dans ces coins perdus. Chaque nouveau venant doit être équipé pareil, dans le meilleur des cas, selon cette vision.
J’ai eu une vision personnelle de plusieurs professionnels et fonctionnaires qui se décident qu’au lieu de faire une vidéo-conférence, cette fois-ci, ils viendront faire un pique-nique sur le Mont Lozère. La scène est de deux douzaines de mini-buses à gazole venus des extrémités de la Lozère, en cercle, en coupe-vent, avec leurs conducteurs, un par véhicule, au centre du cercle. Le titre de la composition pourrait être « Faune du Parc Naturel de la Lozère ».
Je note à la table de « mobilité Lozère », que vivre dans une ville comme Florac, c’est vivre dans un endroit où tous les fonctionnaires se vident à la fin de la journée ouvrable. Les forces vives ayant évacué les lieux, la ville est raide morte, le soir, hors saison. L'infrastructure et les résidences secondaires stagnent, gentiment, pendant que les SDFs et les immigrés se gèlent, dehors.
La manière des élites locales « de fait » de manigancer les opérations de telle manière qu’ils ne fréquentent jamais en groupe participatif les populations théoriquement desservies, préférant systématiquement des « ones on one », des interviews personnalisés d’insertion sociale, des « projets personnels », ne cesse de m’étonner, c'est tellement flagrant. Nous n'avons qu'à demander nos subventions - mais sommes-nous assez riches pour en avoir ?
Cela ne peut pas se passer autrement, si nous continuons d’exporter tous les sous que nous gagnons en dehors de la Lozère, en pétrole, en bitume, en portables, en véhicules. Le mieux que nous pouvons espérer, c’est que les impôts récupérés sur le pétrole par les autorités centrales nous reviennent – notre élite décisionnaire doit aussi avoir du pouvoir dans l’exécutif central.
Tout bon fonctionnaire, associatif, et la pléthore des accompagnants nécessaires, doit donc se dresser vers l’échelon supérieur pour attendre les miettes qui tombent de la table, les « gens du coin » ne comptent pour rien, sauf en termes de problématique, les transients ont comme fonction de justifier les salaires de ceux qui les soignent.
D’où l’inconfort visible de cette élite « mobilité lozérienne » de ne pouvoir compter que deux personnes, là, avec comme seul titre « usager du système ». Encore plus tragique, ni l’un ni l’autre était Lozérien, ils n’étaient même pas « résidents », mais « dépendants » de l’une des associations qui a lancé la journée. Pas très gai, si l’on voulait se faire passer pour représentatif de quoi que ce soit, au niveau de la population locale, pas d’échantillon très convainquant de la démographie locale réelle.
Malgré les apparences, bien sûr, on apprend vite que comme pour les
entreprises fossiles comme Total, tout est rose et on fait le mieux
qu’on peut, dans la sincérité la plus absolue, bref, une autre
forme de greenwashing (grooming) mutuelle.
Témoigne l’attitude désabusé total des deux « usagers », le « vote blanc » habituel, quoi, le rejet habituel de la politique politicienne habituelle.
Le problème avec les élites locales rurales en France, je n’ai pu que le noter, c’est qu’ils ne s’identifient pas du tout comme faisant partie de l’élite. Ce qui donne parfois des conversations totalement surréelles. Comme tout le monde, ils se trouvent attrapés dans une logique infernale d’auto-justification sans fin, cherchant désespérément des potes pour pouvoir se décontracter socialement – ce qui mène tout naturellement à ce genre d’entre-soi exclusiviste. La seule chose qui m’a vraiment frappé – et à beaucoup d’autres je le crois bien, c’est un chiffre, 1 pour cent et demi de la population lozérienne utilise le réseau de transport collectif public (les bus).
Tout ça pour ça. C’est vraiment très peu, un pour cent et demie, j'ai du mal à le croire.
Ne s’identifiant pas comme élitaires, dans leurs pensées, ils paraissent ne pas noter qu’avec les catégories macroniennes – devenues courantes dans la mentalité corporatiste de l’époque Macron, il suffit d’allouer des catégories échelonnées, tels que « bénéficiaire », emploi aidé, conseiller, professionnel, bénévole, CDI, etc., pour parvenir à des niveaux de pouvoir sur le sort des autres qui ne ressemblent à rien de plus que le pire des stratifications sociales du 18iême ou 19iême siècle.
Pour obtenir des biens de subsistance primaires, logement et nourriture, tu dois accepter l’« accompagnement » sur un « parcours d’insertion sociale » ou, pire, un « projet personnel d’insertion professionnelle ». Ce qui veut dire que tu vas toucher des sous de l'état. Si tu refuse cet arrangement faustien, tu es sans intérêt. Ce qui veut dire que tu te trouves devant quelqu’un de 25 ans qui peut te rayer de la carte s’il ne t’aime pas. Tout le monde, sauf celui qui détient le pouvoir, essaie d’être très poli à ce moment-là. Il est intéressant de noter les abus de pouvoir, l’insolence, je dirais, de ces petits fonctionnaires, renaître, dans le confort de leurs rôles indémontables institutionnels. Il faut peu d’avantage social pour que l’être humain moyen devienne un vrai facho.
Comme s’ils n’avaient pas compris, qu’ils ne voulaient pas comprendre, que seulement ceux qui étaient assez riches pour se payer un véhicule et l’essence qui va dedans pouvaient vivre en campagne. Que l’utilisation réelle du transport collectif était si pitoyablement, abysmalement réduite parce qu’il ne restait à vivre ici que des riches – des riches qui se sentent pauvres, puisque au moins 8000 euros par an (véhicule légal plus carburant, annuel) est le seuil d’entrée à cette société, aujourd’hui.
Et vous en voulez plus ! Rassurez-vous que les cas sociaux qui alimentent les professionnels, ils ne pourront plus tenir pied dans une telle configuration socio-économique, sauf s’ils attirent des tonnes de subventions, des doubles-RSA. Le travailleur agricole, il ne peut plus tenir, logiquement – il n’y a que des machines qui font le travail, en tous cas, la tribu de chasseurs à quatre quatre, autre élite rurale, se pavane.
jeudi-vendredi 8 / 9 juin 2023
Je suis en train de rouler sur une route, dans l’occurrence l’avenue de Toulouse, à Montpellier. A vélo. Une colonne de trafic monte lentement la côté vers le grand M, il fait chaud, humide, la pollution est au max.
Je regarde par habitude le bord de route, où je trouve de temps en temps des toutes petites pièces, en cuivre. Je les ai toujours trouvé magiques et distrayantes, les bords de route, les lisières, ce sont comme des livres ouverts sur les histoires des « habitants » défilants. Plus rarement, des pièces en bronze. Très rarement, bimétalliques. Je me demande si leur rareté est dûe principalement à leur valeur relative, leur poids, leur visibilité, il y a sans doute une courbe de distribution qui s’explique par plusieurs facteurs, ce qui n’empêche pas qu’il y ait un ou eux facteurs qui sortent du lot, en termes de prévision.
Mes errances doivent paraître assez bizarres, du point de vu des conducteurs de voiture. Je m’arrête, j’attends que le file se mette en motion, je rebrousse chemin, je récupère, tout en essayant de n’avoir l’air de rien, comme le paysage. Je ne sais pas si c’est par pudeur, mais c’est une route que je fréquente, à des horaires assez habituels. Il se peut que je suis un personnage connu, dans les parages, pour cette seule tendance, alors que les autres véhicules restent mutuellement peu familiers, surtout que les couleurs noir et blanc et les formes très similaires rendent la tâche d’identification sans intérêt.
Mes errances vont plus loin. Je vois une rue parallèle sur laquelle je ne me suis pas encore aventuré, je m’y lance. C’est comme ça que j’ai trouvé une pièce de 2, oui je dis bien DEUX euros, sur une route que je n’ai jamais fréquenté auparavant. Juste parce que je suis allé voir ! Est-ce que je suis le seul collecteur de pièces comme ça, et qu’il eût fallu que moi, j’y passe, pour récupérer la pièce, restée plusieurs semaines sur place ?
Peut-être les détecteurs de métaux seront les premiers à utiliser des robots pour "tout prendre" et qu'ils ne sont pas passés par là parce que ce n'est pas sur google, encore.
Peut-être vaudrait-il mieux le considérer du point de vu de la volonté des parsemeurs de pièces – on les jette, on les perd, mais si la valeur est suffisante, on est plus attentif, on les retient et on les récupère. Dans des milliers de co-locs, un pot à pièces permet de condenser les pièces les plus humbles, comme leçon de vie, pour, dans un cas d’urgence, les compter et aller emmerder le commerçant du coin. Mais sinon, on les jette, on les perd, partout où on va. Quelle insouciance !
Mes errances, je le ressens, ressembleront probablement aux errances des fourmis ou des autres animaux qui cherchent du fourrage. Peut-être pas aux patrouilles des prédateurs, autour de leurs territoires – qui chercheront plutôt des points panoramiques, où l’on peut faire le guet, sentir le vent, écouter les sons. Ce sont, en tous cas, des « search patterns », ce qui n'est pas le cas pour les colonnes de voitures régimentées.
La route majeure sur laquelle je me trouve est dédiée à l’expédition à destination du maximum de véhicules par heure. Des « échoppes » essaient de choper le trafic au passage, en rajoutant des ronds-points aux ronds-points, des drives aux parkings, comme du camouflage culturel. Le rond-point du grand M a aussi son petit M, le Macdonalds, trois supermarchés, une salle de sports, un magasin de bricolage, … Le vacarme est terrible, jour et nuit les infra-sons nous vibrent.
Est-ce que, dans le monde non-artificialisé, il y avait de telles affluences, de telles populations mixtes ? Il y a le bruit des marées, des orages, des cascades et rapides, eau assourdissante à la longue, le bruit de la pluie sur la tôle, symptômes de l’entropisation et des franges d’interférence déchaînées.
Ou est-ce juste une folie passagère, d’essayer de faire se côtoyer des voitures, des camions, des bus, des motos, des vélos, des trottinettes ? On voit le stress que cela induit, de par la multiplication et la ségrégation des voies : trottoir, piste cyclable, voie de bus, route à voitures. Dans la version de luxe, on rajoute un ou deux tramways. La surface latérale devient tout simplement démesurée, jusqu’à cent mètres de large – ces voies prennent plus de place que leurs destinations, mais sans aucun but d'efficacité productive en perspective. La fin justifie les moyens, les moyens la fin … à perte d'horizons. On amène de la glace aux tropiques.
Niveau temps de parcours, il se passe quelque chose d’intéressant, c’est souvent le vélo qui prime. Les gens se plaignent que les vélos – et d’autant plus les trottinettes – ignorent le code de la route, ce qui est idiot – tout le monde ignore conscientieusement le code de la route, y inclus ceux qui la construisent – surtout ceux qui la construisent, par observation.
Sur l’avenue de Toulouse, on voit par exemple que la règle d’un mètre et demie de distance entre les voitures et les vélos varie – parfois la piste vélo s’arrête, coup net, comme si l’on avait abandonné la partie. Parfois on cohabite avec les bus, parfois non. On m’a expliqué que les voies de bus et pistes cyclables en rose, sont de couleur rose pour ne pas trop offenser les automobilistes – ils auraient l’impression qu’on les avaient envahi et volé « leur » route, si c’était du jaune. Petit à petit, on me dit, avec un sourire malicieux.
On « ignore » le code de la route pour des raisons de sécurité – si on ne l’ignorait pas, on mettrait tout le monde en insécurité. Chantier oblige.
Dans ce monde de flux circulatoires, ce sont les agents individuels – les voitures, les vélos, qui prennent les décisions. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de règles, au contraire, mais ce n’est pas le code de la route, tel qu’il est écrit, qui gouverne – cela est juste le début de l’affaire.
Et observablement, cela marche assez bien, il y a très peu de signes d’agressivité, dans un contexte qui est plutôt fait pour en créer. Les vélos et les piétons, on leur laisse la place, on ne les klaxonne pas. Peut-être le code de la route, il a servi à cela, au moins, à inculquer des valeurs, des valeurs aspirationnelles, de côtoiement sans fraternisation. Et les accidents, on les évite … c’est très dangereux, tu peux perdre ton permis, tu peux être démasqué. On pourrait même dire que sans culpabilité, sans peur d’être découvert, le système ne fonctionnerait même pas.
Mais ce qui se passe sur le trottoir est encore plus auto-réglant. Entre le bâti et le trottoir il existe des fissures. Et ces fissures servent d’autoroute pour les fourmis. Surtout à cette époque, d’essaimage et de division de colonies, dans la chaleur et l’humidité, l’activité est à son comble. Il y a plusieurs fois plus de fourmis, qui courent dans les deux sens, sur ces voies uniques, que de véhicules humains à leurs côtés. En les observant, tu te rends compte qu’ils ne décélèrent pas, mais qu’ils font des déviations, à toute allure, ce qui fait l’effet d’un débordement, sur les côtés, là où il pourrait exister blocage. Mais gare à l’humain qui fait ça, il risque d’être très mal vu !
C’est cependant un peu ce qui se passe lorsque tu as plusieurs types de véhicules sur la même route, ils adaptent leurs parcours, de seconde en seconde, dans des équations et des calculs vectoriels chaque fois plus complexes, en apparence, mais qui obligent, à partir d’une certaine saturation, à réduire la vitesse, jusqu’à ce qu’elle s’approxime à celle des plus lents. La monoculture de la haute vitesse se plie à la monoculture de la vitesse constante, comme avec les fourmis, dans une certaine harmonie rythmique.
Il n’est donc pas par pur hasard que le vélo devient le véhicule le plus rapide, dans ce contexte. Il est le plus rapide si, dans le système globale « route », son existence est accommodée. Sans oublier les fourmis, qui avancent peut-être aussi rapidement que les voitures, en termes réelles, aux heures de pointe.
Après le grand M, cela devient une autre affaire, qui se ressemble à une voie express, qui s’attache à un autre rond-point où des vraies voies express et des vraies autoroutes commencent à s’établir.
Ici, les règles changent dramatiquement, le vélo n’a pas plus lieu d’être sur ces voies qu’un véhicule en contre-sens. L’affluent devient fleuve, à la confluence.
Ici, je décris une sorte d’écosystème qui émerge du seul diktat « route », route à voitures, route à faire que les voitures, elles roulent. Le reste, c’est du bric-à-brac, des vaines tentative de faire que la monoculture « voitures » existe encore, mais qui mettent en évidence tellement de variables externes que dans son expression même, la route ne ressemble plus guère à son objectif déclaré.
Maintenant, tournons le regard sur les variables quantifiées, parce qu’ici, de nouveau, les objectifs ont été subvertis. Les véhicules font pleuvoir des déchets sur la route, elles écrabouillent et rendent en poussière et en fumée des parties d’elles-mêmes, principalement les pneus et toutes les autres parties mouvantes, son essence. Celles-ci s’accumulent, s’incrustent dans la matière même de la route, créent des vernis, tuent les voisins, ce sont les « externalités » du système « route » qui deviennent, néanmoins et cumulativement, ce qu’est la route, noyée dans ses déchets.
Pour moi, ce sont des pièces de 2 centimes. Pour les fourmis, ce sont des miettes. Bien que j’ai vu une fourmis en train de manœuvrer une plume de vingt fois sa taille, cet après-midi, je méconnais les raisons, je ne sais pas ce qu’elle voulait en faire, de la plume. Mais je sais que les objets d’intérêt, pour une fourmi, sont tout autres que pour moi, au point que pour moi, ils sont invisibles.
Dans un contexte naturel, une piste, une route, un chemin, c’est un « centre de broyage ». Du fait, tout simplement, que l’on marche dessus, qu’on la piétine. Des êtres vivants se sont saisis de cette opportunité pour faire communauté. Les tubercules du trèfle, comprimés et piétinés, dégagent de l’azote, ce qui intensifie, avec les déjections des animaux, la fertilité aux deux lisières du chemin. On voit le même phénomène en archéologie. Dans les anciens habitats humains, on peut connaître les périmètres d’une hutte du fait que le sol est plus riche et noir – c’est ici qu’ont atterri les détritus de la vie de ses habitants.
Fatalement, sans plan, mais avec des résultats plutôt très utiles pour tout le monde. Il faut chercher dans les choses les plus banales et prosaïques, comme l’accumulation de débris autour des axes d’activité, la base d’écosystèmes et de formes de vie les plus complexes. Plus ça brasse, plus ça produit.
Plus c’est une route, plus ça produit, aux marges.
Sur un sentier, par exemple, on verra, à la bonne époque, des quantités innombrables de petits monts de granules – de sable, d’argile, avec des cratères. Ce sont les œuvres des fourmilions, qui se nourrissent des fourmis qui tombent dedans.
On se demande comment toutes ces bestioles arrivent à éviter d’être écrasées par les pieds de ceux qui passent. De nouveau, en étudiant les réactions des fourmis, comme celles des moustiques ou des mouches, on se rend compte compte du point auquel leurs jugements et leurs réactions sont finement jugés. Pour eux, le geste le plus rapide humain est d’une lenteur telle qu’il est facile de le prédire et de l’esquiver. La seule manière de leur tromper dans leur réactivité est de faire approcher l’objet – la main, le pied, de tous bords pareil, ce qui empêche le calcul d’un vecteur d’échappement, avant qu’il ne soit trop tard pour l’exécuter. La tue-mouches, blanche, avec ses plusieurs petits trous, profite du même phénomène – la mouche est obligé de calculer les plusieurs potentiels trous de secours, objets amovibles, pour s’y échapper, avant de se rendre compte que ces trous, malheureusement, sont trop petits pour elle. On l’a débordé d’information, pour la piéger.
La théorie des catégories, dans la mesure que je la capte, ne parle pas d’échelle, mais de catégorie – dont l’échelle n’est que l’un des aspects déterminants potentiels.
La globalisation est devenue un sujet de plus en plus en vue, dans les deux dernières décennies.
Il y a un entre deux – entre : « analyse catégorielle » et « analyse scalaire », que j’appelle « cohérences » - désolé s’il se trouve que c’est devenue toute une discipline, dont je n’ai rien entendu. En tous cas, l’échelle – la magnitude, la quantité des choses, d’un endroit à autre, est largement insuffisant comme trame d’analyse et les « scalars » (les mesures de volume, de vitesse, de masse, etc. ) servent, mathématiquement, comme bases pour une analyse vectorielle d’un système – ils sont les paramètres fixes qui permettent de mesurer la performance du système en mouvement, tout comme la route est la base statique qui permet le mouvement, les flux.
La globalisation est devenue un sujet brûlant parce qu’on a vu que le cumul des plusieurs choses que l’on fait à plus petite échelle, qui ont des impacts de plus en plus forts, potentiellement catastrophiques, au niveau global, c’est-à-dire pour nous tous.
D’autres mots qui s’invitent dans ce contexte, sont des mots comme « holiste » ou « dynamique », des analyses qui ont plusieurs référents, plusieurs échelles, des mailles, des nœuds, des interactions – ici on s’approche de la raison d’être d’une théorie des catégories.
En fait, une analyse « top-down », une analyse « réductionniste », une analyse avec des tenants et des aboutissants imbriqués dans sa définition, prenons l’exemple d’une « route à voitures », ce genre d’analyse et de projet est, on le voit bien maintenant, voué à l’échec. Tout ce qui a été considéré comme secondaire ou marginal au but central ne cesse d’accumuler – et de poser problème, de devenir LE problème.
De poser problème, surtout pour nous. La route, elle est clé, elle concentre l’accumulation de problèmes, elle est surtout une axe d’évolution rapide, où l’aptitude (« la survie du plus apte ») compte réellement pour quelque chose. On ne sait ni comment ni pourquoi, exactement, mais on sait que les fourmis choisissent de se mettre dans les fissures au bord non-route du trottoir, par exemple. Pour elles, cela évite de se faire écraser et cela donne l’accès aux deux côtés, aux surfaces des deux côtés de leur autoroute à elles. Il y a quelque chose de hypnotique à voir ces rubans d’apparence tressée, composées de milliers d’individus qui courent, la moitié à la verticale, sur les murs, et avec aplomb.
Mais c’est peut-être pour une raison tout autre, et plus fondamentale encore, qu’elles ont choisi le trottoir, côté maisons. C’est à cause de la gestion de l’eau – de l’humidité. La route est construite de telle manière qu’elle est supposée étanche, depuis le début du dix-neuvième siècle. L’eau de ruissellement pénètre dans les fissures au bord de la partie imperméable et c’est donc là que tout devient possible, niveau « vie », d’autant plus qu’il y a l’abri au sec, sous la route, tant recherché par les insectes. Ils se sont placées à la frange, à l’interface entre ces deux mondes, le seul accident de terrain qui compte, dans un écosystème route.
Les fourmilions (environ 2000 espèces d’insecte dans la famille névroptère des Myrméléontidés) donnent la contre-partie – de toute apparence, ils acceptent le risque et se distribuent là où ils peuvent, étant sédentaires, et s’il y a beaucoup de trafic, ils vont, fatalement, on pourrait dire, ceux qui survivent, se trouver plutôt aux bords du chemin, c’est la mérite d’être marginal. Si c’est elles qui sont là et pas quelqu’un d’autre, c’est que leurs trous donnent quand même un peu de protection contre la compaction des pas, et elles ont une source prolifique de nourriture (les fourmis). Leur cycle de vie, dont l’état larvaire ne fait qu’une partie, est rythmée aux cycles de pluie et de beau temps.
Au bord du chemin, le détritus, le sable, les nombreux éclats de verre, le kératine des milliards d’insectes brisées, le calcaire des escargots, l’hémoglobine du sang, s’accumule avec chaque crissement de pneus, pour devenir, grâce aux intervenants, terreau fertile, mobilisé, métabolisé. La vie se construit au bord des chemins et donc des routes, qui ont toujours été des broyeuses, des brasseuses de la vie et de la mort.
On peut voir que, en prônant une technique et pas une autre, pour accepter les charges chaque fois plus imposantes de nos véhicules sur nos routes, la technique du bitume et du calcaire zéro trente qu’est devenue cette technologie, bref, cette création d’une monoculture de fait a radicalement altéré l’« écosystème route », sans aucune intention de le faire et avec des conséquences, pour l’équilibre de cette vie des bords de route, tout à fait non-anticipées – ignorées ou dépréciées par les décisionnaires.
L’écosystème « route », je le dis, sachant qu’aucune reconnaissance officielle est accordée à ce concept, parce qu’elle n’est pas assez « matérielle ».
Si la seule finalité d’une route était d’expédier des véhicules avec de plus en plus de réussite, parce que de plus en plus efficaces, rapides et sécurisés, entre point A et point B, si c’était celui-là, le seul but de la route, elle serait comme elle est, on me dirait. Autrefois c’était pareil, on n’avait pas les moyens d’aujourd’hui.
Eh bin ? On a les quantités. L’artificialisation des sols, c’est la route. L’artificialisation des bords de route, d’autant plus. On dit que l’on vit dans l’Anthropocène, parce que c’est l’anthropos – l’Homme, qui a l’impact le plus dominant et durable sur la géologie – sur la Terre – il est devenu une « force naturelle majeure ». Du genre qu’on ne paye même pas les assurances pour ses dégâts ( ! ), ce qui relève de la déresponsabilisation collective, par incohérence. « L’être humain est comme ça, n’y a rien à y faire, … ».
Eh bin ? En termes physiques, c’est au bord de la route que se trouvent la plupart des impacts des humains sur l’environnement. Dans la mesure que l’on étend son rayon d’action, sa fréquence, sa vitesse, on multiplie la magnitude des conséquences, des impacts, de ses actes.
Je parle au singulier, mais les routes, c’est un effort conscient de démultiplier ces actes.
L’objectif des routes, c’est de faciliter le distanciel. L’écosystème « routes », existe parce que cette volonté démultiplicative existe. Et chaque point sur ces routes, ces réseaux routiers, est moulé autant par cette raison d’être que par sa réalité physique si transitoire.
On n’a qu’à considérer la culture romaine – connue pour son usage de béton et ses routes pavées et droites, toujours dans le but de connecter, à des distances de plus en plus grandes, à des échelles de plus en plus vastes, sa logistique de commande.
« Si la seule finalité d’une route était d’expédier des véhicules
avec de plus en plus de réussite, parce que de plus en plus efficaces,
rapides et sécurisés, [ … ] »
Je l’ai dit et je le répètes ici.
Parce que, très clairement, cela ne peut pas être le seul but. La globalisation veut dire « ça ». Comme un intrus à la fête.
C’est une manière de dire que tout est multifactoriel, et qu’il faut en tenir compte, lorsqu’on construit des infrastructures, surtout des infrastructures qui entretiennent ou font émerger une « monoculture ». On ne peut pas s’abstenir du débat, lorsqu’on se trouve face à une monoculture meurtrière.
Je peux convertir cette idée en termes dites « physiques » ou « concrètes » ou tangibles », avec des mots comme « biomasse », des volumes, des statistiques – mais est-ce que je dois vraiment le faire ? Est-ce que je n’ai pas déjà assez dit pour que l’on voit qu’une petite chose, une bifurcation dans l’évolution des fourmis qui les permet de choisir le trottoir, côté maisons, peut permettre à la « biomasse » des fourmis de monter, par des tonnes et des tonnes, et avoir son effet, également démesurée, sur l’infrastructure dite « route » ? On m’a raconté qu’à danser toute la nuit sur de la terre battue, une foule a baissé le niveau de cette terre par dix centimètres. Essayez une fois de vous placer près d’une route où passent des camions, allongés dans le sens de la route. Vous sentirez la terre fléchir, à chaque passage, de chaque essieu.
Ne ferais-je pas mieux d’étudier, de très près, les fourmis, si mon objet était de comprendre le fonctionnement de l’écosystème « route » ? Peut-être que oui, peut-être que non – les fourmis, mais quoi en dire des bactéries, ou des virus (!) ou de toutes les matières transportées, ou emportées, d’un lieu à autre, comme par une rivière ? Que dire du vent ? La liste de candidats est longue, aussi longue que la route, qui devient centrale à l’activité de la biote. N’oublions pas que la route, c’est aussi « les routes », là où des formes de vie ou de non-vie établissent un axe de mouvement, il y en a d’autres qui le parcourent et les humains, avec leurs œuvres routières, comme avec leurs chemins de fer et leurs canaux, ouvrent ou créent d’autres écosystèmes, dont profitent d’autres formes de vie.
Il y a enchevêtrement des cadres logiques d’analyse, et répercussions entre échelles, cela est clair.
Mais concentrons-nous sur les effets de l’humain. Heureusement, elles sont concentrées auprès des routes – si elles étaient également distribuées partout sur la terre, le défi serait d’autant plus grand, mais dans l’occurrence, la proportion de débris dans les sous-strates atteint des niveaux où il est possible de les miner – de les extraire. La pollution que nous avons créée, nous avons toute possibilité de la traiter, parce qu’elle est surtout aux bords des routes. Il est plus que probable que des formes de vie, comme les fourmis, sont déjà en train de faire ce sale boulot pour nous – pourquoi réinventer la roue ?
Traiter cette lisière comme un écosystème, c’est tout-à-fait logique. Cela positivise l’affaire – on refait vivre, on assainit dans le but de refaire vivre, avec toutes les réserves possible sur le sens de ce mot « assainir ».
Et où se trouve la voiture, dans ce mixte de priorités ? J’ai envie de dire « nulle part ». Ses atouts majeurs, telle qu’elles sont conçues actuellement, deviennent, écologiquement parlant, ses défauts principaux.
Elle va trop vite. Elle ignore tout sauf la destination. Elle ne fait pas partie, au contraire, elle coupe à travers l’écosystème, alors qu’avant, elle en était la force motrice, ce couloir de vie qui s’appelle une chemin, une voie, avec deux lisières.
La faute, notre faute d’intelligence collective, jusqu’à là, a été de considérer les écosystèmes comme des unités surfaciques, non-vectorielles, alors que tout indique le contraire – les surfaces s’étalent à partir des lignes – des trajets des êtres vivants – et rien n’empêche les surfaces elles-mêmes de bouger, de s’étaler, de se transposer d’un lieu à d'autres. Une réserve naturelle ne sert plus si elle est débordée de tous les côtés par un sol artificialisé.
Pour cette raison on parle de « corridors », de couloirs écologiques, qui permettent à se rejoindre aux îlots de biodiversité. On analyse la migration des oiseaux sous l’optique des gîtes de passage qui leur permettent de continuer ces rotations. Etc. Un exemple d’une réserve de biodiversité, c’est le mangrove, un écosystème très riche, très distinctive, qui protège les côtes de l’érosion.
A Toulouse, et dans d’autres villes, on essaie de récupérer les rives des rivières pour la ripisylve – « l’ensemble des formations boisées [ … ] qui se trouvent au bord des cours d’eau ». Ce sont, après tout, des voies publiques écologiques, ces rubans de végétation ininterrompus, au bord des flux d'eau. Dans un autre article ( textes des rives ), j’examine ces mêmes cours d’eau en tant que véritables routes ( thoroughfares - artères ) multifonctionnelles. Dans ce cas, c’est le milieu, l’eau elle-même qui bouge, constamment – il n’existe pas de plan d’eau – de l’eau qui stagne – sans qu’elle ait préalablement bougé.
Que les rivières, marais, anciens bassins de captage des moulins d'eau et autres milieux aquatiques ne soient pas un "ensemble d'écosystèmes à défendre", dans toute leurs diversités et complexités, ... comment ne pourraient-ils pas l'être, imbriquées comme ils le sont dans le paysage, enveloppées dans leurs ripisylves ?
Une mégabassine, dans cette analyse, est un archaïsme. Il est là pour "capter" des mêtres cubes d'eau, les enlever de tout dialogue avec le milieu. Comme les tuyauteries qui les abbreuvent, ils contiennent de l'eau morte.
Ce sont des véritables mètres cubes: la seule raison d'être de ces "conteneurs" est de contenir des volumes d'eau.
Sur un autre sujet, pas si anodyn, il y a la question de la production alimentaire - nourrir le monde - pour lequel l'accès à l'eau devient LE sujet à penser, avant tout. On parle de l'agroécologie. Mais c'est un peu comme le terme exploitant agricole, ou "agroforestrie", une contradiction dans ses termes. Une autre agriculture n'est pas possible, elle est à ce moment-là mal-nommée.
C'est du jardinage que ça traite, pas de la culture des champs mais de la culture des petits espaces, pas nécessairement horizontaux, des clairières, par exemple. On peut dire horticulture, si l'on veut (hortus=jardin) y mettre un mot en latin. Rien n'empêche, ..., mais pas agriculture, qui est une autre histoire.
Larzac est un bon causse parce que c'est comme s'il avait subi toutes les affres du destin et il est encore là. Toutes ces interventions de l'humain, en terre maigre et sèche, plein de cailloux. Et, dès qu'il y a un creux, de la vie enrichie. Les routes à voiture sont austères, droites, exposées aux éléments, dominent maintenant le paysage par leur horizontalité.
C'est de la fin de l'agriculture que ça traite, dans ces terres à la fois agricoles et jardinées. Plus de présence humaine ici produirait plus de par-vents, plus d'humidité, plus de milieux de vie, y inclu celui de l'eau à l'état liquide. Issue de notre ingéniosité, la vie est dure gagnée sur le Larzac, depuis des siécles.
Pour cela qu'ici, c'est le paysage même qui nous donne des indices et des prémonitions sur l'aridité et la garrigue qui nous attend, à l'avenir, ailleurs en France métropolitaine. Si l'écologie est une guerre, mieux vaut former les soldats écologiques dans ce terrain d'entraînement que le laisser à la zone militaire, c'est une question de vie et de mort !
... est une appellation officielle permettant l'opération d'"expériences écologiques" exemptées du cadre réglementaire normatif, pour des raisons de recherche et d'expérimentation. Cela permet l'étude, par exemple, d'habitats jardinés par des jardiniers de passage, avec des refuges de jardinage, analogues aux réfuges de montagne ou aux huttes de chantier dans leur fonctionnalité.
La mobilité douce ainsi proposée permet de tester ces habitats productifs adaptés à ces types de mouvement, à pied et à vélo. Une infrastructure écologique est une infrastructure qui a un bilan positif, écologiquement, et en particulier en termes de son bilan énergétique et dépendance industrielle.
vendred 13 / samedi 14 octobre 2023
Le lecteur attentif saura déjà de quoi on parle : de l’automobile. C’est à partir de lui que l’auto-ségregation se détermine. Il décide non seulement de la présence ou l’absence des gens dans des lieux déterminés, mais aussi de qui déterminera et qui se soumettra à cette détermination. Les riches en mobilité détermineront. L’autonomie ou « auto-mobilité » des uns deviendra l’esclavitude spatio-temporel des autres.
L’erreur que l’on peut faire, dans l’analyse de ces phénomènes, et de séparer les flux (les automobiles et les routes) des lieux (les soi-disants « centres »). Tout lieu est un lieu, chaque mètre carré de route aussi. Les communications vont d’un lieu à autre, en passant par des lieux. On a maintenant plusieurs lieux qui sont sous-utilisés, surtout « utilisés » par des membres de l’élite. Il faut analyser flux et lieux en même temps pour comprendre comment ça marche. Il existe un outil pour cela : le vecteur.
*nota – les églises et temples – les lieux de culte, restent vides la plupart du temps, actuellement. Ces lieux sont souvent sujets au pouvoir décisionnaire des communes dans lesquelles ils se trouvent. Le blocage de ces lieux est un précurseur et révèle le problème du "sens" - que v-a-t-on faire d'un lieu désigné pour un usage, pour lequel il n'est plus utilisé?
On pense ici tout de suite aux virus, des objets tangibles, qui « se déploient » ou qui sont déplacés à des vitesses et des distances variables (répansion).
Mais le virus n’est « que » de l’information. Il in-forme, il promeut ou il déclenche de l’activité.
*nota – j’ai entendu un reportage ce matin sur l’assainissement de l’air extérieur dans une cour d’école moyennant des extracteurs de particules fines - mais de quelles particules se traîte-il ? Par exemple, le levain dépend des ferments naturels, des levures qui se trouvent dans l’air. Comment discriminer les particules que l’on élimine de celles que l’on retient ? Tenant en compte que les particules vivantes ont déjà des plans d’action là-dessus ?
Entanglement (intrication, emmèlement, enchevêtrement). Pour désemmèler un nœud complexe dans une corde, nous avons l’habitude de chercher à tirer des bouts du noeud en extension pour mieux voir celui qui va où, le faire passer dans l’autre sens, jusqu’à ce que la ou les cordes soient désemmèlés (unravelled) de nouveau.
Une partie du phénomène de blocage vient du fait qu’un fil (corde, ficelle) ne paraît pas avoir beaucoup de propriétés à part celle d’être linéaire et tensile, en extension, mais dans un nœud son épaisseur, sa flexibilité assument de nouveau une importance critique. Ces propriétés sont bien physiques, dépendent bien de l’organisation de la matière physique et peuvent facilement se voir de l’oeil humain. Si je dis ceci, c’est pour rappeler qu’il y a les métaphores et il y a les phénomènes réels. La matière physique n’est pas juste une question de quantité, mais d’organisation, à toute échelle. Pour autant que je sache, la description d’un filet comme « une quantité de noeuds » manque de valeur explicative.
Il est étrange et signifiant, pour moi, que l’on peut noter, à partir de 2013, une montée de l’importance et un subtile changement du sens des mots « facile » et « confort ». Facile devient l’antonyme de compliqué, pas difficile. Le confort s’associe fortement avec la facilité. Ce duad est vu non seulement de manière positive, mais de plus en plus comme essentiel.
Mon hypothèse serait que la surcharge mentale et le manque d’autonomie de choix n’ont pas été les premières concernes des humains pendant la plupart de leur histoire sur terre, et ceci, pour une raison assez simple, la prise en charge de la plupart des problématiques était déjà déterminée par « le paysage », par nos interactions avec celui-ci.
Mon hypothèse est que les affres de la vie moderne sont arrivées à un pic où, comme des nœuds dans le flux informationnel, les problèmes qu’elles représentent sont à la fois vitales, iressolvables et sans fin - des « flux tendus ». On perd donc de l’autonomie et du contrôle, dans sa vie réelle. Le rétablissement de cette auto-détermination et cette « tranquilité » devient le but central. Le conflit essentiel est entre la priorité individuelle et celle du collectif. Les plus fortes associations d’individus sont celles qui ont comme but de favoriser l’autonomie individuelle de leurs membres.
Chacun décide – c’est l’axiome du marché libre, mais le « goulet d’étranglement » est devenu l’accès à l’hyperconsommation, plutôt que l’auto-déterminisme par le transport de son corps soi-même, en rélation avec d’autres corps, comme dans le cas du virus. L’information déterminante, par rapport à sa sécurité, sa liberté d’association est déterminée par l’accès à une panoplie de ressources, un paysage, un environnement, qui n’a que très peu de relationnement avec son pouvoir physique, sinon ses pouvoirs extensiles, apportés par des machines personnelles. Le prix d’entrée dans cette économie de choix devient de plus en plus élevé.
L’analyse spatio-temporel de cette économie est révélatrice, elle montre que c’est l’espace-temps qui s’est trouvé asujetti à des flux vectoriels qui ont de moins en moins de rapport avec les faits sur le terrain. Notre poursuite de la richesse qui nous achète l’autonomie devient elle-même la cause de notre déroute. Il faut peut-être mentionner que cette analyse démontre que l’essentiel, pour nous, reste le même, le cadre reste l’espace-temps, ce qui est recherché – la motivation, également.
Les instruments d’analyse que j’emploie sont familiers, touchant à plusieurs disciplines, la mathématique pure, l’urbanisme, le numérique, les sciences du vivant, la logistique, la physique, le physique, pour commencer. Mais ce cadre analytique permet d’expliquer dans une trame unique d’analyse le lien causal direct entre la crise écologique et la crise sociale. Les résultats sont directement mesurables – la manière d’occuper la terre des riches crée des espaces désoccupés, par les humains et par le vivant en général, ensemble. Ce n’est que lorsque l’analyse devient « vectorielle », traitant de l’espace en fonction des mouvements dans le temps, que le signal devient clair. La campagne, le silence. Les hectares de sol nu, pulverisé, occupé par des fines couches d’herbe, ou par des monocultures. Des réserves, des mégabassines, des lieux bâtis, tous en attente, … des riches. Pour qu’ils n’y fassent, … essentiellement rien, ou rien de bon.
Notre campagne est devenue celle-ci.
dimanche 8 octobre 2023
Je vais la décrire, aux cartographes de la réaliser.
Je rajoute ici le lien envers une carte que m'a fait grok.com que, si j'ai le temps, je vais développer.
Carte de l'Espace-Temps à Florac-Trois-Rivières
Cliquez sur les cercles pour voir un peu l'idée. Grok m'a dit, avant de tomber en panne, qu'il pouvait, à travers des sites comme l'insee ou le cadastre, potentiellement calculer l'empreinte "présentiel" par rapport aux revenus, par parcelle. ChatGPT était beaucoup moins fûté et n'arrêtait pas dementir, j'ai abandonné. Je ne sais pas pourquoi grok s'appelle grok, mais chez nous "grok", cela voulait dire "touriste."
Je m’excuse pour le mode constatationnaire de l’écrit, c’est plus court et plus clair comme ça. C’est juste un effet de style pragmatique pour l’écrivain, pas pour le lecteur, qui peut le trouver exaspérant, sans doute. Certaines fautes cardinales ont été commises pour intimer que c’est peut-être une IA malajustée qui l’a écrit. A vous de juger, si vous voulez bien.
La carte principale consiste en une série de cercles de taille, remplissage et couleurs divergeants, parfois superposées et représentant l’occupation réelle humaine des lieux, tout lieu, en fonction des critères de temps d’occupation, profile des occupants, et ainsi de suite. Un bureau ne sera utilisé que pendant la journée ouvrable, par exemple. Un accueil de nuit ne sera ouvert qu’à l’hébergement du titulaire – autre exemple. La catégorie socio-économique des occupants de l’espace burotique sera celle de fonctionnaire moyen, etc. Le bureau aura un taux d’occupation de 20 % du tout-temps, disons, dans le meilleur des cas. Une salle de fêtes aura, typiquement, un taux d’occupation de proche de Zéro, même quand on rajoute le co-efficient Karaoke, ou, encore plus impressionant, Bingo.
On pourrait toujours diviser le temps d’une journée en diurne et nocturne, suivant l’hypothèse que même un super-riche, endormi, n’a pas besoin de plus de place que celle qu’il occupe allongé pendant la durée de son sommeil. Cela pourrait donner des résultats plus productifs et réalistiques de l’espace occupé par rapport aux besoins. Je pense aux masures des paysans, à l’ancienne, qui ne s’utilisaient que pour dormir, puisque on était toute la journée dehors. Qui est dehors ? – autre question potentiellement fructueuse. Faut pas juger la qualité de ces habitats d’antan par les mêmes critères que celleux d’un?e troglodyte moderne nocturne, comme nous le sommes toustes devenu/es. A intégrer au calcul.
Un café spécialisé « habitués » et ouvert sans pause, lui, aura un taux d’occupation plutôt respectable, de l’ordre de 50 %. Il y a intérêt à faire figurer le nombre d’occupants à une période donnée et donc la densité d’occupation sera représentée aussi, je ne sais pas exactement comment. La taille du cercle réprésentatif augmentera ou diminuera, comme sur n’importe quelle carte pulsante qui tente de représenter la taille rélative des métropoles au niveau mondial, par exemple.
N’oublions pas que chaque carte est orientée autour d’un but défini, mais que chaque carte dépend aussi des données collatées et disponibles. Le census national, par exemple, à part le fait qu’il est presque toujours surannée, d’autant plus en période de fort changement climatique (fuites des réfugiés, catastrophes naturelles, etc.) fait que le taux d’occupation, ou de résidence, ou de domiciliation créent la vision de qui est chez soi, à la campagne – la population rurale supposée. La carte que je propose montrera que ces mesures sont caduques, parce qu’elles ne réflètent aucunement la réalité de cette occupation. C’est important, les revenus disponibles pour desservir les communautés de communes dépendent de ces chiffres qui sont susceptibles d’être manipulés, dans un sens ou un autre.
Et puis viennent les co-efficients. On peut correler la richesse – le revenu par exemple, des occupants de l’espace-temps de la petite ville. On verra que les bars centraux sont peuplés de personnes rélativements opulents, par exemple, et que les demeures de ces derniers auront un taux d’occupation de presque zéro, puisque quand ils ne sont pas au café, ils occupent plus l’espace-temps de leurs voitures, leurs voisins, lieux de travail et lieux de visite que leurs domiciles devenus assez théoriques, finalement. Même à domicile, au travail et en véhicule, ils ne sont pas strictement là, ils sont au monde connecté. Là, c’est simple, on a un coéfficient « heures sur écran ».
Leurs véhicules leur permettent de visiter, toujours plus vite, plus loin – ces véhicules divers faisant, eux aussi, partie des occupations d’espace-temps représentées sur la carte. L’espace d’une voiture est relativement petite, elle en dispose, pourtant, d’énormément d’espace, sur ses trajectoires. Et en fait, cet espace occupé non-occupé, la chaussée, est maintenue vide pour qu’elle passe, ce n’est pas rien. Une route a une largeur et une lisière, c’est plus un ruban qu’une ligne, quelle est sa dimension latérale ? Quelle allocation donner à l’occupation de cet espace-temps linéaire rubanesque, sur une graphique ? La grande majorité du temps, la chaussée, c’est de l’espace mort, dédié à pratiquement un seul type d’usage, le passage voituresque, parfois qu’une ou deux fois par jour. Comment interpreter cela, sur une carte ? Est-ce que le vide de cet espace l’occupe, comme le vide d’un parc régional naturel s’occupe de rien, sauf ses gîtes désoccupés ? Comment justifier la construction de quelques kilomètres d’autoroute pour l’usage de quelques voitures ? N’y-a-t-il pas la possibilité que la vraie utilisation de cet espace, c’est de fournir un prétexte pour augmenter la consommation, côté production, prétexte récréation, à la marge : transport ?
Les routes rurales auront donc en général une occupation proche de zéro aussi. La corrélation de richesse et d’occupation en révèlera, des choses. L’espace-temps du désert rural, il transparaîtra, est « occupé », très largement, par des habitants qui ne sont pas là. Curieux. Ils occupent sans occuper. Où sont-ils ? Peut-on les représenter comme des étoiles filantes, un peu partout à la fois, au hasard ?
N’est-ce pas qu’une zone inoccupée présente moins de problématiques par rapport à la liberté d’action estatale et privée qu’une zone saturée de gens ? Y-a-t-il lieu pour la création d’une carte de liberté relative, rélative à l’occupation d’espace-temps localisé dans un lieu donné, pour discerner bien le profile socio-économique des populations qui en bénéficient le plus de cette liberté ? Comme cela on peut s’attaquer à la question sensible d’autonomie de choix. Qui a vraiment le choix ?
Une étude rapprochée indiquera que le riches réussissent à relever le défi, malgré cette abondance de moyens, de l’occupation la plus dense de petits espaces dans les grands espaces qui leur sont disponibles, pour établir l’encadrement social qui leur permet d’appliquer un rapport de force, des points de condensation soudaine comme dans le Blitzkrieg. Pour cela qu’ils ont l’impression de l’insupportabilité de la foule pressante, alors que les pauvres ont l’impression inverse, d’être dans un monde de non-sollicitation de leurs dons. Ce sont des mondes parallèles, où les pauvres vivent « chez » les riches, « grâce » à leur générosité, en se taisant, pour ne pas gèner. Qui vit chez qui, comment cela se définit ?
Là où il y a le moins de taux d’occupation, mesuré sur l’axe de l’espace-temps, ils y seront, groupés, les riches, mais seulement de temps en temps. Leur boulot principal ? De construire de plus en plus d’endroits d’espace-temps, magnifiquement approvisionnés en tout ce qu’il faut, ateliers, fablabs, bicycleries, cafétières, chaises, tables, ... qui restent résolument vides la plupart du temps, mais qui témoignent, passivement, de l’influx de riches, venant coïncider sporadiquement de nulle part en « locale », par la magie des téléphones portables et des transports inter-city. Là il y a plein de liens improbables qui se visibiliseront s’ils sont représentés sur la carte.
La sporadicité des mouvements des riches est nécessaire d’abord pour aligner les forces. Les pauvres sont obligé de les chasser à ce moment-là. Un bon indice de ce phénomène pourrait être de calculer qui attend pour combien de temps une visite urgente chez le dentiste, et à combien de kilomètres de chez lui? L’arrhythmicité des actes présentielles des riches se fait aussi parce que, sinon, on risquerait de voir des noyaux durs d’occupation, de libre association et de communication entre pauvres, sapant le pouvoir rélatif qui définit et établit le riche en selle.
La dépériodisation ou dérégulation est donc une autre facette de cette trame de pouvoir nécessaire pour la protection et le renforcement du pouvoir des riches – et leurs attendants, moyennant la précarisation et la dérégularisation des activités en commun en général, pour les rendre ponctuelles et ciblées. On peut aussi appeler ce phénomène l’événémentialisation progressive de toute rencontre.
Un exemple de ce phénomène en marche que j’ai vu récemment est l’affichage des horaires de permanence régulière d’une association sur la porte de leur nouveau lieu d’accueil, extensif et luxurieux, suivi de cinq jours de non-apparence et de fermeture du dit lieu d’accueil pendant ces horaires. Explication/décodage : événementiel/ciblage. Les membres de l’association sont allés chaque jour en visite, ailleurs, sans signaler que ce ne serait pas ouvert.
Les seuls lieux sur lesquels on peut compter pour en tenir à la regularité de leurs horaires, ce sont des magasins pour lesquels la présence d’un clientèle localisé est essentiel, sinon ils ferment. Je ne sais pas comment on pourrait représenter cela cartographiquement, peut-être en établissant les lieux où les horaires de permanence sont mis en valeur, correlées avec la réalité des lignes de force. Le problème serait qu’il est probable que les lieux d’ouverture stable, les lieux « fréquentables », n’auront même pas d’horaires affichés et ne seront que difficilement identifiables. C’est la première loi de l’information : si vous voulez la vérité, ne demandez jamais au bureau qui en est responsable de vous en informer. Allez plutôt demander dans le bureau d'à côté.
Une cartographie qui permet de réfléchir à ce phénomène, croissant, il me semble, serait également facile à représenter, partiellement, moyennant la carte générale de l’occupation de l’espace-temps. Il reste clair qu’un désert rural est la production d’une population riche, qui a l’objectif de le rendre encore plus désertique, tout en assurant le maximum de services réservés à leur seule utilisation, ou munificence d’affichage. La distance parcourue pour obtenir une corbeille de services est donc un indicateur du profile plutonique d’un lieu donné.
Les riches forment des nœuds, des concentrations sporadiques, dans les principaux et plus vastes espaces, mais, physiquement, ils provoquent des clusters, des files d’attente, des embouteillages, là où ils affluent, un peu comme le faisaient les cours ambulants des monarques itinérants du temps passé, les Macrons du présent, ou n’importe quel événement programmé pour les riches, qui crée vite des goulets d’étranglement (des embouteillages) presque insupérables. Ceci s’applique indifféremment aux raves, aux festivals en tout genre et aux actions militantes des Soulèvements de la Terre ou de la CGT. Le dénominateur commun est qu’ils sont tous plus riches que les vrais pauvres, sinon il n’y aurait pas embouteillage.
Comme je l’ai dit, le reste du temps, la vacuïté de ces lieux est assurée par des cadenas, des clés, des patrouilles, des équipes de sécurité et de surveillance numérique. Le plus simple, c’est que rien ne bouge, donc, personne. Cela évite de regarder des heures et des heures de vidéo. Les humains, à ces moments-là – de « temps mort », sont vus comme des encombrants – des risques sécuritaires – puisqu’ils réquièrent toute une complexité très cher payée d’organisation et ils ne contribuent rien à l’organigramme de la possession contrôleuse qui maintient la structure à flot. Les horaires erratiques et imprédisibles aident dans ce désencombrement, là où les clés accessibles aux seuls adhérents cessent de fonctionner comme force dissuasive, mais la clé et sa possession, ou la combinaison, est en général décisive. Une étude de géographie rurale comparative pourrait établir la fréquence de cadenas par kilomètre carré, factorisée par la densité de population de chaque endroit surfacique.
Ces mosaïques d’espace-temps, reliées par des couloirs de flux, les routes, également inoccupées et d’autant plus que les voitures roulent plus vite, paraissent avoir un seul but, celui d’en exclure la plupart des habitants ou non-habitants, présents ou potentiellement présents. Non sans raison, les véritables habitants ruraux voient ça plutôt de mauvais œil, mais ce problème est en grande partie résolu, de manière pratique et convaincant. Ils n’y sont plus. On peut parler d’auto-nettoyage éthnique. Typiquement, ils se trouvent en péri-urbain, ayant revendu ou loué profitablement leurs maisons à des néo-ruraux citadins (résidences secondaires). La vaste majorité de l’espace-temps campagnard est géré par des flux tendus de gens pressés, qui n’ont pas le temps d’occuper les espaces qu’ils ont prévus pour le cas où. C'est pour cela, d'ailleurs, que les ruines cadastrées sont bien vues - cela représente l'idéal, des endroits de consommation de l'espace-temps à la retraite, pleins de latence.
L’exercise paraît être de créer le maximum de brassage, mesuré en distance parcourue et énergie dépensée par kilomètre de déplacement, pour réaliser le minimum de résultats en termes d’occupation productive efficiente. Ou, si l’on veut le voir d’une autre manière, de produire énormément de latence, de points de chute, de sécurité éventuelle, en prévoyant toutes les possibles usages qui ne sont presque jamais, en réalité, réalisés.
Pendant quelques années cette révelation m’est venue croissante, devenue patente pendant les années de ségrégation et de confinement covides. A ce moment-là, les mots présentiel, distanciel, physico-socialisation, viséo-conference, virtuel, ont vraiment pris leur essor. Il est devenu une nécessité de créer un vocabulaire pour décrire des phénomènes bien manifestes.
Il n’y avait plus personne dans les salles prévues pour leur congrégation, une sorte de silence embarrassé les a remplacé.
Pour rejoindre les deux bouts, donc, de cette pensée analytique, la richesse et le statut social se sont combinés pour présenter un signal fort. L’espace-temps de la libre-association et de la voie publique, dans son accessibilité, sera dorénavant clos à la plupart des habitants de la terre, et ceci, par un étroit contrôle de leurs mouvements. Dans ce monde, en pauvre, on sera obligé de se déclarer sédentaire, raison : inclusion (insertion) sociale, tandis que le droit de bouger ne s’accorde qu’à ceux qui se sont déjà déserrés (accès aux clés). Eux, devenus maîtres de l’espace-temps et de la congrégation, ne seront pas là où ils « sont », mais accessibles exclusivement à ceux auxquels ils accordent le droit de la congrégation. Malin.
La croissance du pouvoir des associations, elle, est réservée à l’usage des « adhérents » (bénévoles, bénéficiaires). Visiblement, les bénéficiaires ne sont là, quand ils sont là – les horaires autorisés de présence sont strictement minimales – que pour justifier les frais énormes de leurs gérants, subventionnés par le gouvernement. Les « responsables » (salariés) se donnent très largement le temps pour l’entre-soi, par contre, restreignant les activités du groupe « clientèle » (patientèle) à des « one-on-one » (accompagnements).
Et tout cela se révèle dans une carte bien ficellée de l’occupation de l’espace-temps, de manière vectorielle, comme pour n’importe quel processus de prédation sociale. Notons que cela a toujours été le cas, on dit depuis l’aube du temps mais moi je dirais plutôt depuis l’avènement de la civilisation, ou de la sédentarisation, qui permettent de moduler ou museler la libre-association.
Civilisation, sédentarisation, colonialisation, c’est un peu la même chose, du point de vue moderniste. Peut-être cela a toujours existé, au moins en embryon ? Les riches, eux, sont autorisés à bouger, les pauvres, cloués sur place. Les pauvres n’ont l’autorité de la bougeotte que dans la retenue et au service des riches, c’est même la seule source de salut, pour eux. Longtemps j’ai été puzzlé par ces incronguïtés apparentes. Pourquoi un riche qui n’est jamais là s’acharne-t-il autant à prétendre qu’il est de souche, et cela depuis toujours ?
Ce qui a changé, entretemps, c’est l’automisation (atomisation, fragmentation), dite de la révolution numérique, dirons : la révolution des riches, de l’accaparemment chaque fois plus grand de l’espace-temps.
Ce qui a changé, d’ici en amont, est le grand remplacement, de fonctions humaines par celles des machines, qui rélève la question : pour qui et pour quand ? La réponse est clair : pour les riches, toujours !
Ce qui a changé, dorénavant, c’est l’emploi de l’espace-temps. La principale tâche étant de strier le terrain pour s’assurer de sa non-occupation. Il n’y a rien à y faire ! Même un état entier peut être mis hors courant à l’instant même (Gaza Strip, maintenant). La productivité humaine, mesurée objectivement, a cessé d’exister, celle de ses machines a augmenté en proportion, jusqu’à ce qu’il vire dans une autre dimension. La gestion des ressources veut dire leur immobilisation (sauf en cas d’usage de riche possédant). Et on se demande pourquoi tout ça à l’air de nous rendre malades, nous qui n’avons plus de fonction ?!
L’idée est relativement simple : je propose d’être payé pour mon occupation de l’espace-temps des lieux prévus à cet effet, mais qui seraient sinon fermés et non-accessibles (la plupart du temps) aux populations desservies (théoriquement). Mon paiement, ce serait mon occupation, ma récupération de l’espace-temps, ma permanence permettant à d’autres la co-utilisation de l’espace (grégarienisme). Cette tentative d’entreprise socialement utile permettrait au moins de faire une sorte de sondage des raisons affichées pour refuser mes services.
Il y a similitude de cette attitude avec le concept du voyage lent, le ralentissement du temps augmente l’occupation de l’espace par des êtres sentients et ainsi les possibilités d’interaction non-léthale avec des créatures qui ne bougent pas à la vitesse de la lumière (ou de la voiture). L’affaire est relativement solide en termes de computation. Cela donne des co-efficients d’efficacité de l’occupation de l’espace-temps, vectoriellement parlant. L’idée est de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le mouvement, l’occupation, l’association ont tous leurs rôles, calculables de surcroît, mais ne sont plus des simples quantités, sinon des produits factoriels des relations entre plusieurs. La mesure indexe étant toujours le niveau d’occupation de l’espace-temps (en "corps humains").
Celui qui dit relation dit auto-organisation. Celui qui dit auto-organisation dit organisation toute courte. L’organisation des relations la plus efficace se fait par les organismes eux-mêmes dans les plus compacts coordinations spatio-temporelles réalisables, minimisant l’utilisation nécessaire de ressources énergetiques. Il y a donc urgence à appréhender que la capacité d’allumer ou éteindre un pays entier, avec un seul bouton, est un critère d’excellence organisationnelle qui se fourvoie. L’idéal organisatif, entropiquement, serait que l’individu avec son doigt sur le bouton rouge serait entièrement impuissant, les événements passant à de toutes autres échelles et par de tous autres détours et machinations.
Nous avons eu, longtemps, l’habitude de voir l’occupation de l’espace en termes de sa productivité. Les fiefs des seigneurs cumulés, cadastrés, équivalaient à telle quantité de blé, de bois, de richesse. C’est d’ailleurs du capital qu’on parle, à l’origine.
Mais une chose quéruleuse s’est passée, entretemps. La marque du riche est devenue sa capacité d’« occuper » l’espace – le terme est abusif du sens – pour ne rien y faire. Ou bien, pour y faire quelque chose de temps en temps, sporadiquement, de nouveau. On ne sait jamais quand viendra l’homme, avec son tracteur, sa girobroyeuse, sa chevrotine son chien, on sait juste que c’est une mauvaise nouvelle – tout doit disparaître, comme dans les soldes.
Sa solde, en effet, c’est la valeur de son bien, cash – ou bien « plastique », c’est une valeur plastique, un art plastique, la conversion de biens en stipends (paie).
Tout cela pour dire que si l’objectif premier de cette affaire, la propriété, était productif, elle est devenue maintenant purement relative, elle ne peut plus rien produire, en termes physiques, et tant mieux, elle fait fonctionne de pouvoir, cet avoir, et rien de plus. Elle est virtuelle – et sa physicité aussi. C’est ce qu’on appelle la dématérialisation, mais où est partie toute cette matière ? Elle a toute l’apparence de s’être vaporisée. Si la richesse, c’est le sol, nous vivons une époque ou l’atmosphère et les fonds des océans prennent tout, ne nous laissant rien. A quoi bon, donc, la propriété ? C’est peut-être pour cela que l’axe de mouvement de la civilisation est correlé à l’existence, purement notionnelle, de la propriété – et ensuite l’accès à la propriété, notionnellement pré-occupée.
On se prépare pour le pire, le moment où la propriété peut de nouveau valoir quelque chose, en termes de production concrète (VER - valeur écologique rajoutée).
Vous pouvez me faire l’observation, avec une part de raison sans doute, que la propriété, de quelque type qu’elle soit, mais surtout du type « rapport de force » et non pas usager, vaut déjà notre alimentation, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que cette propriété vaut si peu, dans les pays où elle vaut encore quelque chose, les pays pauvres ? Par rapport aux pays riches, par mêtre carré, elle ne vaut rien du tout. Elle vaut d’être conquise, et "mise en valeur".
Il est légitime, donc, de dire que la valeur est purement rélative, elle ne fait que symboliser le rapport de force que l’on tente de créer entre êtres humains, y inclus l’entretien de peu de valeur où la plupart de la valeur est produite, et beaucoup de valeur là où le moins de valeur est réellement produite, y inclus tous les moyens matériels non-humains qu’on a trouvé, principalement les machines, pour que ce soit ainsi, les industries tertiaires, les armements, la securité, qui renforcent ces valeurs tordues, puisque qui mange le pétrole, le petrole qui fait 70 % pour cent de notre production, mais qui le mange, vraiment ? C’est dégueulasse, vous avez essayé ? C’est l’un des principes favoris des écolos, de dire qu’on peut vivre du prana, tellement peu qu’ils nous faut pour vivre, tandis que pour un capitaliste pure souche, le monde entier ne suffit plus pour produire le « nécessaire » (confort, facilité, réalisme).
Cette multiplication de moyens qui ne servent strictement à rien, moins deux et comptants, qui nous amène gracieusement vers la chute libre pour l’éternité écourtée. Disons que l’efficience énergétique est devenue contre-productive, dans l’économie de la production-consommation, puisque ce qui n’est pas produite ne peut pas être consommée, et ce qui ne se consomme pas n’a pas de raison d’être produite. Bien entendu que la production, dans ce cas, c’est la production de survalue, d’intérêts et de l’or, le reste est immatériel.
Plus le riche produit donc, à sa façon, plus il a de pouvoir, même s’il n’a pouvoir sur rien de tangible, de telle manière que sa production est devenue, peu à peu, purement sociale (=anti-sociable).
En cela il ne divague pas du principe de l’organisation de la matière, qui trouve sa meilleure expression dans le concept « jardin ». Il ne faut pas oublier que l’inception de l’humanité, version civilisée, a eu lieu … dans un jardin, selon les rapportages de l’époque.
Dans un jardin, au contraire de l’agriculture, le but est de faire qu’il se fasse le maximum, sans presque rien faire soi-même, idéalement. Cela paraît conra-intuitif. N’est-ce pas que le jardinage, c’est du boulot, du boulot physique, en contact avec la terre, et que les justes récompenses de cette labour, ce sont les fruits de cette terre, cette terre « cultivée » ?
Absolument pas. Le meilleur jardinier, c’est celui qui investit la plupart de son temps à observer (surveillance), assis sur un banc, un talus ou au milieu de sa parcelle, à mâcher sa paille et regarder le temps passer. Il observe une limace, en train de dévorer ses jeunes pousses, il la chope et il la jette, et en ceci il ne fait ni plus ni moins que le capitaliste qui surveille son royaume pour repousser tout intrant.
Il enlève les mauvaises herbes pour laisser prospérer les bonnes, bonnes pour lui, mais par des circuits parfois très indirects. En fait, il fait un travail surtout intellectuel, plus il a de connaissance des espèces et de leurs interactions, moins il aura de travail à faire lui-même. Il lui suffira de leur assurer leur place et de la nier au nuisibles. S’il fait encore mieux son travail, les plantes auront déjà trouvé leur place, il n’aura même pas à les planter. Pour cela aussi que tout ce qui se fait dans le jardin peut être réduit à un processus de tri : favoriser, défavoriser, mettre à l’ombre, au soleil, protéger du givre, exposer aux éléments, déssècher, réhumidifier, mais finalement, si le dessein est bon, cela se fait « tout seul », c’est-à-dire, le vrai travail n’est fait que par ceux qui ne le considèrent pas un travail, est qui consiste en …
Vous n’allez pas me dire que manger, c’est un travail, quand même ? Cependant, notre devoir citoyen paraît de plus en plus être « consommer ». Il est vu comme déloyal de ne pas consommer, dans une économie de pays riche. On demande les moyens. On nous subventionne. Le vrai travail d’une vache est de ruminer, ne l’oublions pas. Mangeons les fruits du jardin, nous aussi, c'est un ordre.
Dans un jardin, donc, le travail n’est pas le travail, la loi du moindre effort domine et sans manger, il ne se produira rien – un peu comme dans le désert rural français. Les pauvres agriculteurs prennent le contre-pied et vivent des vies d’enfer, entourés de machines et d’insalubriété industrielle, sans jamais sortir de leurs machinosphère, dans des paradis terrestres qu’ils n’ont pas le temps, ni l’espace d’apprécier. Ce sont des travailleurs, et par tous les comptes rendus, des travailleurs malheureux. Le travail qu’ils exécutent est un vrai travail – c’est de la torture, ce qui explique, sans doute, qu’ils en veulent terriblement aux fainéants, ceux qui mangent sans travailler et avec plaisir. Eux, leur boulot, c’est de détruire la terre, ils ne peuvent même pas s’aimer, pour cela, ce qu’ils aiment, c’est donc le masochisme et la souffrance productive – le travail.
Comme cela a été dit, l’agriculture est un cas social rural à part et n’a rien à voir avec le jardinage – les buts ne sont pas les mêmes. En tous cas, c’est une analyse plutôt historique qui est faite ici. Les agriculteurs ne font plus partie, sauf en nombre infime, du paysage fonctionnel rural – ils sont déjà disparus, comme les hobbits et homo florensis. Bientôt, si les choses continuent comme ça, les machines les remplaceront entièrement, dans un travail duquel on demande à quoi ça sert ?
Par exemple, en Ariège, il suffit d’un seul opératif humain, qui passe la plupart de son temps en voiture, pour desservir plusieurs carrières. En Lozère, j’ai moi-même vu un ouvrier arriver dans une entreprise Lafarge, au petit matin, pour accomplir un seul geste. Il a appuyé sur un bouton et l’usine entière s’est mise en marche. Et oui, cette opération a bien des parallèles dans la technique « jardin ». Les carrières « mangent » le paysage, tout le paysage, si on les laisse faire. Coïncidence ? Par contre, les machines agricoles, plus proche philologiquement des valeurs du jardinage, ne font que l’aplanir, avant de procéder à l’élimination de toute végétation et de toute vie. Ceci donne un mauvais exemple aux jardiniers susceptibles.
Les écologistes qui aiment bien regarder ce paysage sans y toucher (ce sont principalement des « hors sols ») sont très agités, qu’est-ce qu’ils feront s’il n’est plus là ? C’est vrai que les grosses machines des carrières mangent déjà beaucoup de paysages. Mais je pense que ces écolos voient le monde à l’envers. C’est parce qu’eux, ils prennent tous des voitures pour aller regarder le paysage que le paysage disparaît. Aller voir, il faut qu’ils arrêtent ça, déjà. Je suis sûr que c’est l’argument que déployera, sans hésitation, le seul carriériste restant en Ariège. Son sale boulot, s’il ne le faisait pas, quelqu’un d’autre le ferait, et en tous cas, ce n’est pas de sa faute si la demande est là.
L’individualisation des responsabilités et leur démarcation est une étape importante dans l’étayage d’une philosophie d’exculpation et résignation individuelles (l’écologie profonde). Dans un monde industriel, cette stratégie d’irresponsabilisation, des fins du mois, est presque obligatoire, sinon rien ne va. On la voit partout, cette philosophie décrite et analysée par Anna Rhendt, notamment, dans les camps de concentration, dans les hiérarchies gérantes, à chaque échelon de la société. « J’ai juste fait mon boulot », comme une machine.
Ben, maintenant, c’en est, une machine. Qui le fait ? Il est un peu normal qu’on ne sait plus qui fait quoi, ni pourquoi. Ca se fait pas, ou plus, en général. Des mitraillettes qui se tirent dessus toutes seules, des tronçonneuses qui tronçonnent, des voitures électriques qui se transportent, des conteneurs qui se transportent et qui se rangent, la terre est devenue un énorme jardin (parking lot - lots of parking) pour que les machines se mangent pour nous. Bien sûr que ça ne marche pas, mais c’est ainsi conçu. En réalité, ça marche, mais pas pour nous. Les machines ne s’entre-mangent pas – c’était l’erreur délibérée dans la phrase précédente – ils nous mangent. Le pouvoir vertical humain se coupe l’herbe sous ses pieds, scie-mment, parce qu’il est fait pour cela et il ne sait pas faire autrement.
Je pense que les gens pensent qu’il est incroyable d’avoir une vision si négative, si dépréciative, du monde dans lequel nous vivons, mais dans mon jardin, tout allait bien, jusqu’à ce qu’on vînt briser l’ensemble, le collectif, dans son entièreté, pour m’atteindre à moi, pour établir la « propriété » en le rasant.
C’était le positif, qui me remplissait de joie. Je pense positif, le négatif que je décris est un effort de description à but de l’évitement des crimes contre la terre comme des crimes contre l’humanité – il est important de se ressentir ensemble. J’espère convaincre, en montrant d’un côté comment ça marche, en mourant, de l’autre comment ça marche bien, en vivant. Qu’on me dise que je ne suis pas pro-négatif, je le veux bien, j’en suis flatté, même, de la reconnaissance.
Qu’on me dise qu’on voit le vert plutôt à moitié plein, je crie : « aux armes ! » Quel vert ? Celui des riches ? Quelle terre, celle des pauvres ? Si je tente de migrer chez les riches, ils n’en veulent pas de moi. Si je retourne à la terre, je suis mort. Quel verre à moitié plein ? Quelle terre ? On me la mange sans que j’en mange, comment puis-j’en être content ? Ma terre, elle n’est pas à moi, elle n'est pas là.
Quand je dis « riches », ou « pauvres », il faut reconnaître que je ne suis pas du tout content de cette terminologie et encore moins de mon usage des concepts. Par exemple, tout-à-l’heure, j’ai du inventer un lien : « les dépendants des riches », un autre « la retenue des riches », pour accommoder le fait qu’il y a des gens attachés aux riches, d’une manière ou autre, susceptibles de soutenir les valeurs des riches et qui, si l’on votait, feraient le poids électoral qui faisaient gagner les pro-riches dans les élections. Qui ne sont pas, eux-mêmes, riches, j’ai hâte de rajouter, s’il y avait un doute - juste coincés.
Les riches eux-mêmes, étant par définition numériquement inférieurs aux pauvres et ceci d’autant moins qu’ils sont plus riches, ne font même pas le poids, aux élections, pour gagner, et peuvent même voter contre leur camp, pour des questions de conviction plutôt que d’intérêt. Il arrive qu’un riche, il ne s’aime pas, parce qu’il est riche, c’est même assez fréquent et je le comprends. Ce qui peut expliquer qu’une bonne partie de leur richesse est investie dans le dupage des pauvres et les pauvres riches pour qu’ils votent contre leurs propres intérêts. Si les pauvres ne sont pas dupes, il y a toujours la menace.
Pour les pays riches – les pays dits riches, c’est à peu près le même scénario vis-à-vis les pays pauvres. Les populations civiles (c’est un peu comme une guerre en continu), le peuple, quoi, des pays riches sont plus ou moins clients de la richesse de leurs pays – des dépendants, assistés, même si la plupart de l’assistance sociale est réservée au classes médianes, encore des riches. Pour prendre la mesure de ce phénomène, je dirai au hasard que la probabilité qu’une population migrante des pays pauvres vote en faveur de politiques qui favorisent les pauvres est proche de zéro, ils voteront pour la richesse, yeux rivés vivement vers le haut. En ceci, ils ne feront ni plus ni moins que ce qu’ils ont fait ou feraient dans leurs pays d’origine, étant donné qu’ils viennent, majoritairement, des élites et oligarchies de ces pays, pour lesquels il y a toujours plus haut, plus loin. Et oui, ces effets se passent à plusieurs échelles fractales à la fois, et de manière souvent interconnectée.
On pourrait dire qu’ils sont plus conservateurs, en général, que la population hôte. Que la gauche est soutenue, aujourd’hui, plus par des personnes d’origine socio-éducative haute que basse, par rapport à la droite. Que c’est dorénavant l’extrème-droite qui reçoit le vote populaire, ouvrier et immigré intégral.
Et qui peut donner tort à tous ces gens ? Ce qu’ils font est assez logique. Les jardiniers de la politique, les Ellen Musks, Présidents Poutines, etc., essaient d’exacerber ces tendances, en enflammant de nouveaux fronts, anti-intellectuel, anti-pacifiste, anti-faible, anti-groupes minoritaires, pour bien pourrir la situation et pour éviter la création de foyers humanisto-idéologiques qui pourraient leur faire face. Ils jardinent industriellement, bien sûr, avec tous les nouveaux gadgets, en sillonant régulièrement les vastes champs de désaccord pourque aucune mauvaise herbe de décence humaine ne puisse jamais prendre racine.
Il doit y avoir des analyses beaucoup plus fines, sociologiquement, que celle que je viens de faire, mais attention, la sociologie industrielle n’est pas fine, elle broie tout, indifféremment. Comme tout procédé industriel, la complexité non-ordonné (par soi) est perçue comme une menace, broyée et réconstituée, pour que l'on puisse en être sûr que « ça marche ». « Ça », c’est le processus qu’on a prévu, n’importe lequel, c’est la confiance dans sa capacité de nuisance qui compte, à ce stade-là. La meilleure manière de prédire l’avenir est de l’exécuter, d'après tout, selon la mentalité industrielle. C’est pour cela que dans une situation d’emprise industrielle, la disruption des plans viendra toujours d’un cumul de marginaux – de « non-prises en compte » qui s’accumulent aux bords du champs de bataille. Il est rélativement facile de déstabiliser un processus industriel, c’est pour cela que la plupart de l’effort industriel est dédié à éliminer la capacité d’auto-organisation de ces marges, pour prevenir, justement.
La campagne est vaste. Elle est difficilement contrôlable. La meilleure solution industrielle à ce potentielle menace est de la coloniser avec des pro-industriels qui défendront les intérêts des riches, qui ne sont qu’infréquemment là, qui défendent ce qu’ils imaginent être leurs propres intérêts – leur propriété. Les diasporas, ce sont les coloniaux, habituellement bien plus socialement conservateurs que ceux qui sont restés dans le pays d’origine. Et tous ces gens, pour les encapsuler, on utilise la rubrique « hors sol », dans le contexte industrio-numérique actuel.
Ou bien les riches et leurs dépendants, même s’ils sont en réalité pauvres. Ils restent les dépendants des riches.
Peut-être la menace idéologique la plus profonde à ces intérêts très marqués, c’est la menace d’une politique stable « pro-pauvre ». Il faut cependant établir le sens précis de cette expression, même si le sens est sans nuance et bien exacte dans la phrase donnée. Une politique pro-pauvre est une politique qui favorise la pauvreté, pas une politique qui rend les pauvres plus riches. Il détruit le pouvoir des riches, jusqu’au point où il n’y a plus aucun intérêt social ou économique à être riche.
A ce moment-là, certains esprits bien avisés diront « Aah ! Là je sens des propositions bien révolutionnaires ! » Le pape François, le Saint François et Jésus lui-même n’ont pourtant pas cessé de promulguer la doctrine qu’il est plus difficile pour un homme riche de passer au paradis que pour un chameau de passer par le chas d’une aiguille. Si c’est révolutionnaire, cela ne date pas d’hier.
La héresie moderne est en effet de suggérer que tout le monde n’a pas son prix. La tâche des tortureurs de Big Brother en 1984 était, après tout, de trouver le cauchemar individuel qu’ils allaient administrer sur chaque détenu, pour le faire parler, pour le soumettre.
Renoncer à la richesse, c’est renoncer à son prix d’achat, se rendre insoumissible, se refuser au rapport de force. Est-ce vraiment si révolutionnaire que cela ? Et pourquoi est-ce que cela provoque autant d’hostilité chez les friands de la liberté ?
A cette dernière question rhétorique il y a une réponse rhétorique. C’est un chemin envers la liberté qui menace le leur. Un pauvre, selon cette doctrine, est quelqu’un qui manque la capacité d’être riche. Il est moins performant et moins apte à la survie. Il est limite fardeau, il ne porte pas son propre poids, il est probablement parasitaire, sur les efforts, capacités et performances des bons bosseurs. Il est bon à rien – il vous sort le pain de la bouche. Il est contre le progrès, l’inventivité, le développement, tant personnel que civilisationnel. Il vit dans sa crasse, étant trop fainéant, même, pour se dépasser, ou se respecter. Un pauvre, en somme, n’a même pas lieu d’être là, là ou un riche, dans son plein droit, occupe la place qu’il a gagné de par ses talents, son courage et sa perserverance.
Comme vous pouvez le constater, cette doctrine est non seulement parlante, étincelante d’expressions et d’idées reçues qui nous sont toutes familières, mais elle a même l’air de contenir des notes de vérité. On peut tolérer les pauvres, mais seulement jusqu’à un certain point. Ce point est celui où ils nous menacent dans notre richesse - et notre aspirtion à la richesse, qu'ils traînent dans la boue.
La tâche intellectuelle et idéologique d’honorer la pauvresse est donc difficilement lançable. Cette difficulté naît d'une confusion entre deux états différents. La pauvreté digne et solidaire / la pauvreté précaire et involontaire. Excusez-moi la pauvreté de mon élocution, je ne suis pas intellectuellement équipé pour m’exprimer mieux que ça. La déterioration de mon état mental se démontre par l’appauvrissement de mon expression. Mes ressources sont maigres. Pour démontrer jusqu'à quel point la stigmatisation de la pauvreté est imbriquée dans notre langue de tous les jours.
On dit que personne ne veut vraiment être pauvre, en ciblant la deuxième catégorie, la pauvreté involontaire, chemin faisant, la servitude volontaire. On fait l’amalgame des deux, en disant que sans capital, sans réserves, on manque de résilience (pensée survivaliste). On remarque que la pauvreté est dans la tête, comme si on était personnellement responsable pour son état pitoyable, qu’on peut être riche tout en étant pauvre et l’inverse, que cela dépend de la définition de ce qu’est un pauvre. Son héritage.
À une époque où le statut des machines, par rapport aux humains, est si fort, l'humain tout seul sans avoirs, sans biens, a moins de statut que celui qui est accompagné, par un véhicule, par un portable. Avant, ses accompagnants, c'étaient des hommes, des femmes, des bêtes.
Qu’est-ce qui se passe si la pyramide socio-économique s’aplanit, si la différence riche-pauvre commence à diminuer ? Toutes les vociférations ci-dessus deviennent bien moins importantes, on n’y prête plus beaucoup d’attention – il y a d’autres choses dans la vie que l’argent. C’est assez clair et net, nous venons de vivre une époque où c’était le cas, la pyramide du pouvoir a été la plus plate vers 1973, paraît-il. Les idées de cette époque, on constate, sont justement associées avec l’indifférence à l’argent, l’aspiration à l’épanouissement personnel et social, plutôt qu’à l’enrichissement, jusqu'à la rupture du lien, perçu aujourd’hui comme nécessaire, entre l’argent et le pouvoir.
On commence à entrevoir quelques réponses. La pauvreté, non-stigmatisée, assumée, permet de penser à d’autres priorités que celle d’assurer, d’abord, ses propres bases (la charité commence chez soi).
Au contraire, elle permet de s’assurer que les bases des autres sont aussi solides que les siennes (solidarité). Cette assurance se mutualise, humainement. Le rapport de force perd du terrain. Toute une gamme de mesures sécuritaires et préventives deviennent innécessaires.
• abritage • foyage • fourrage • foirage • teufage • adelphage • couchage
L'idée est d'établir des lieux de portage, de stockage et de ravitaillement stratégiquement placés sur les parcours réguliers qu'on tente d'installer. Des groupes en kayak passent de lieu en lieu pendant la semaine pour préparer les lieux de passage pour ceux qui vont faire le portage. Ce sont des efforts de coordination collective, qui visent reclamer la voie publique par des méthodes de transport sobres et coordonnées, dignes de l'effort écologique qui nous est demandé.
voir questionnaire : portage au fil de l’eau
le but est de créer des espaces de libre-association pour s'épanouir dans les actes – ce sont des recettes de contagion sociale.
On constate que les projets d’écologie existants n’ont pas franchi le seuil de la réussite sociale à grande échelle, ne se sont pas déteints sur la société dans toute sa largeur.
De telle manière qu'on associe l’écologie avec la bien-pensance d’une petite minorité de privilégiés.
Or, si on ne prend pas à bras le corps l'écologie, nous sommes tous cuits, de la viande rotie.
On a conseillé à la direction du projet InÉcoDyn – – d’y aller doucement en composant des petits groupes de personnes qui font déjà des choses comme des fromages de brebis et du shamanisme.
Ces conseils ont été rigidement ignorés. Au contraire, faut pas dépendre totalement des bons voeux de petits groupes de gens qui n’ont pas, dans le passé, opéré des changements à l'échelle nécessaire, politique et sociale.
Si ce n’est en faisant soi-même, en soutenant ceux qui font. Plus de procrastination. Pourquoi essayer d'apaiser les sentiments, alors qu'il n'y a rien d'apaisant dans les faits devant nous ? Comment s'opposer au ricanement, dans un tel cas ? Pourquoi se mentir, sans ironie ? Pourquoi contribuer à l'hébétitude d'une société qui a déjà du mal à sortir de son carcan (bordel) ?
On critique les politiciens quand ils renvoient toujours au lendemain les actes déterminants, comme l’abandon des pesticides, des pipelines ou de l’agriculture industrielle.
Est-ce que nous pourrions parvenir à nous critiquer de face, manque pas de miroirs ? Est-ce que l'on fait vraiment mieux, à l'échelle de nos vies personnelles, que les jetsetters ? N'avons-nous pas les politiciens que nous méritons ? Continuons comme ça, ils seront bientôt tous d’extrême droite.
Cela fait plus d'une décennie que les extrèmes parodient la pensée la plus caricaturielle de monsieur et madame Toutlemonde. Le mal toujours au delà de l'entre-soi. Mais le mal est bien là - même si, à la campagne française de moins en moins belle, on continue de conduire des voitures, de consommer du gaz et des produits locaux d'excellente qualité.
La tension ne cesse de monter, parce que les biens-pensants sont un peu ceux qui sont en train de tuer le monde à tous, en le vivant bien, autour du barbecue familial.
Le premier mur d’encerclement à casser, c’est celui avec lequel nous nous entourons nous-mêmes - nous avons besoin de faciliter le passage et le travail d'autrui, de partager l'intelligence collective.
La libre-association est la capacité de s'ouvrir à l’autre. Un désert rural est une campagne fermée – mais nous ne pourrons pas mener une révolution verte tous seuls. Il faut des milliers et des millions de gens sur place, investis dans le bio-sphère là où il se trouve. A consommation réduite. Tout de suite. Il est impossible de donner des leçons aux autres si on pratique l'inverse soi-même.
Chaque pas en avant de chaque individu doit être pris en pleine conscience des conséquences – est-ce qu’on le fait que pour soi ou pour les autres ? Est-ce qu’on forme d’autres gens pour prendre le relai ? Est-ce que le projet auquel on participe peut être facilement repliqué ailleurs ? Parce que, sinon, ce n’est pas une petite minorité à la campagne qui va changer quoi que ce soit.
voir fly : portage au fil de l’eau
aspirations
à l’autonomie des ensembles
au courage des timides
au soutien pas puritain
à l'économie du geste
dimanche 11 décembre 2022
Il y eut une fois un déclic. On arrêtait de se projeter à la place de ceux qui y étaient, alors qu'on n'y était pas, et on commençait à soutenir ceux qui y étaient, avec la logistique nécessaire.
Une série de formats qui permettent de vivre à un dépens carbone réduit - moins d’une tonne par personne par an. En « bande organisée », pas juste tout seul, tranquilo dans son coin.
Chacun fait sa part, c’est sûr, mais le mot « infrastructure » implique un ensemble qui dépasse la chose purement individuelle. « Toi tu prends ton chemin, moi le mien » ce n'est pas ça. On fait un bout de chemin ensemble quand même. Cette infrastructure vise le déplacement sans énergie rajoutée et sans édulcorants.
– Pas de dépendance sur le fossile-électrique. On réfocalise l'affaire sur l'énergie du corps et de l'esprit. Si c'est eux qui font le transport, c'est eux qui doivent avoir la forme - on se recentre sur l'entretien des ressources humaines et sociales.
On ne manque pas de moyens, ici. Nous sommes des sur-consommateurs. Mais le partage est très inégal. Nous voulons dégager des énergies déjà existantes.
Savoir communiquer, savoir cartographier, savoir wikipédier, pour mettre les gens sur la route.
Mais pas pour leur rendre le statut de pions dans un jeu d'échecs sur tablette. Tout savoir numérique sert à l'engagement physique. Le numérique, il est aux ordres des marcheurs.
« domicilié boucle » est une devise qui vise à capturer le maximum de catégories de ceux qui bougent, sans distinction. Qu'on soit nomade, lent, sans domicile fixe, réfugié, migrant, ruminant, divaguant. Même ceux qui se définissent sédentaires bougent un peu encore.
L'opportunité d'un travail utile. C’est exactement ce que cherche à établir une filiature comme: « Portage au fil de l’eau » ou « la Boucle des Marchés ». Les interactions fonctionnelles, de bénéfice mutuelle, qui mettent les atouts de l’un à côté des atouts de l’autre.
Donner un cadre déchiffrable qui peut stimuler la confiance entre les deux populations. A l'échellle locale, entre individus qui se connaissent et qui se rencontrent, cela donne de bien meilleures occasions pour l'intérêt mutuel.
C'est vrai que c'est très ambitieux, à l’inverse des utopies collectives qui dépendent, au fond, de la possession de biens terrestres et de bâtons magiques. On peut donner sa chance au bien être, peut-être, à la liberté de mouvement et d'action humaines.
C’est pour dire que les moyens existent ! Comment dégager l'enthousiasme, renforcer les forces agissantes, chercher la démarche écologique optimale, ici, maintenant?.
Sports créatifs, avenirs constructifs, engagements directs.
Écologique, cela veut dire « rapide ». Le temps planétaire nous est compté. "Maintenant", c'est déjà un très bon moment pour agir.
On économise l’énergie dépensée, au max. On essaie de faire avec tous, boule de neige, ...
Cela dépasse les activistes, pour déborder dans la population générale.
Un mouvement populaire de grande envergure qui nait.
c. mardi 17 mai 2022

Voilà, je suis encore là, dans les Cévennes, mais de justesse. Ceci est un petit message pour expliquer l'évolution du projet "Randonnées" décrit en bas, qui me paraît tout aussi légitime comme démarche écologique qu'avant, mais que j'ai délaissé pour entreprendre l'assaut d'autres sommets cévennols. J'ai roulé jusqu'à en Lozère, par col, montagne et ravine. Les randonnées citées ci-dessous, je les ai pratiquées pendant un mois, sans pour autant attirer la moindre attention ou intérêt. J'ai donc pris d'autre chemins pour mieux voir les caractères de ces montagnes, ces collines, d'une complexité topologique et botanique époustouflante dans laquelle s'imbrique une population rurale profondément héteroclite.

Le problème essentiel par rapport à la présence humaine des "pro-lifes écologiques", c'est que le milieu - le contexte rural est devenue résolument "anti-life", surtout au cours des derniers cinq ans. C'est la gentrification caractérisée de cette campagne - de cette nature, de ce vivant, qui la tue - c'est les riches qui consomment le monde, surtout dans les milieux ruraux des pays riches. Il en émerge une sorte de cohésion, sinon complicité, entre diverses élites rurales - l'omerta devient possible.
Que l'on tienne bien en compte que ces élites ne se reconnaissent souvent même pas. Est-ce que l'achat d'une maison destinée à ses enfants, avec l'argent gagné par une vie de travail, est-ce cela qui détermine la richesse ? Tout-à-fait. Des jeunes gens avec des familles, vivant en yourte et en camion ? Est-ce que leur style de vie est anti-écologique ? Mais bien sûr qu'il l'est. On parle de l'impossibilité de vivre sans voiture à la campagne, ... Mais si on est assez riche - ou le dépendant, le serviteur des riches, on peut. Et le touriste, il bénéficie des deux mondes.
On se trouve de plus en plus dans le scénario de collectivités qui réquierent, comme préalable, de l'argent, que l'argent devient l'émolument, le lubrifiant, l'objet nécessaire à cette échange sociale rurale.
Les véhicules et les portables donnent de l'autonomie à ceux qui en ont, rendant moins onéreux la présence et le passage de ces gens. On n'a même pas à "caser" ces gens. L'autonomie que donne l'argent, la "maison-voiture", le portable font que les gens s'occupent d'eux-mêmes. Le "bénévolat" fait barrière à ceux qui nécessitent rémunération pour leur travail. L'artisan payé 35 euros de l'heure qui vit "en camion" de manière "autonome" en est parfaitement conscient. Le bénévolat évite des dizaines de milliers d'euros de salaire, donne préférence à des gens de moyens indépendants. La valeur d'un investissement immobilier peut être multiplié, pour représenter plusieurs centaines de milliers d'euros de profit.
Dans ce climat surchauffé (!), le humble jardinier a parfois du mal à trouver sa place.
c. mercredi 9 mars 2022
contact email: inecodyn@singularity.fr
site web: www.cv09.toile-libre.org
On lance une expérience en transport écologique, une transhumance hebdomadaire régulière. Nous voulons ainsi développer un réseau fiable d'accueil et d'activité utile pour ceux qui traversent le pays par des moyens purement non-mécaniques, à pied, à vélo, etc. La visée est de se faire solidaires, de donner des pistes aussi pour l'intégration des réfugiés et de ceux qui nous visitent.
La première semaine (à partir de vendredi 18 mars 2021), on a marché du marché de Ganges, par Sumène sur la voie verte jusqu'au marché du Vigan. Ensuite on est passé par Saint Bresson jusquà Saint-Laurent-le-Minier. On répète l'expérience à partir du vendredi 25 mars 2021, rendez-vous sur le marché de Ganges pour ceux qui veulent! Nous cherchons à mieux sceller les liens forts au niveau local et engager les énergies de tout le monde.
En ce faisant, nous voulons provoquer la renaissance de l’esprit de l’accueil et de la mobilité humaine – des aspects plus que jamais critiques de notre humanité collective. Que nous soyons des réfugiés, des nomades, des migrants ou des habitants, nous sommes tous LÀ.
Sur les marchés, sur la voie publique, en vif et en direct, nous proposon un espace de partage. Tenus sur chaque marché par des gens désireux de promouvoir le libre flux de gens, d’information et de produits, ils donnent des lieux génériques et ouverts à tous pour le rencontre, l’accueil et l’orientation vers les plusieurs associations, groupes et individus de plus en plus actifs et productifs au niveau local … et plus loin.
Tout cela, bien sûr, dans un cadre où nos dépenses énergétiques et donc une grosse partie de nos empreintes écologiques individuelles « rentrent dans les clous » … de notre survie collective.
C’est une aventure – une expérience. Si nous réussissons à recréer des passages viables et réguliers à pied, nous pouvons en toute sincérité dire que les voitures et les routes bitumées ne sont pas obligatoires à la campagne. Nous mettons en valeur, très littéralement, une première ébauche de chemin vers l’avenir.
La seul chose qi bloque, c’est nos habitudes - notre conservatisme industriel. Il est vrai que les voitures donnent plus d’indépendance d’autrui – mais est-ce que cette autonomie de nos pairs humains est vraiment ce que nous désirons ? Le prix est chaque fois plus excessif, ne serait-ce qu’au niveau financier. Pour une personne pauvre la voiture représente au moins 4 mois de salaire à l’année (5000€). Qu’est-ce qui vaut mieux : aller au supermarché en voiture pour rentrer chez soi, ou passer la nuit une fois par semaine dans une auberge conviviale, dans la présence de ses compagnons de route, après avoir exercé son corps et son esprit en marchant par des lieux de beauté ?
D’ailleurs, s’il y a quelque chose que l’être humain sait faire, sans finance et sans réunions, c’est marcher, seul, accompagné, au choix.
La marche régulière nous enrichit à plusieurs niveaux. On peut planter, cueillir, entretenir les chemins, tout en approfondissant sa connaissance du pays et de ses habitants. En recréant des lieux de stockage en coopération avec le voisinage, on peut colporter des colis et des messages, de personne à personne, de porte à porte. Plus l’accueil et la coordination sont adéquates, plus on a de place sur le dos pour autre chose. En soi-même on devient porteur de savoir faire, de sociabilité et de force de travail. Ce genre de circuit est un cadre idéal permettant aux actifs d’apporter leurs énergies directement là où on en a besoin, à moindre coût pour nous et pour l’environnement.
La seule question qui reste: veut-on devenir libre, ou s’inféoder jusqu’à l’éternité aux machines qui sont en train de détruire notre monde ? Une autre industrie est possible.
mercredi 8 décembre 2021
Lorsque j’y réfléchis, en attribuant la valeur « friche » à un endroit, on
l’abandonne, en lui conférant le statut de « nature »,
sous le label de « réserve
de la nature », il n'est pas de notre monde, sinon celui des experts. Mais le jardin, on continue de le cultiver, pareil.

En ceci, les anglais et les japonais varient quelque peu : ils soignent « la nature » mais toujours dans le but de la rendre plus « naturelle » ; « wilderness » est la catégorie anglaise de la nature non-soignée.
En écrivant ceci, je pense à un sous-bois, au bord du Canal de Midi, où j’ai été horrifié de trouver un campement abandonné contenant tous les déchets et immondices du monde moderne, à quelques encâblures d’un collectif dédié à l’économie circulaire – le recyclage des déchets.
Tellement j’en étais dégoûté que j’ai passé des journées entières à désincruster piles et batteries du sol, à ramasser des fragments de plastique, à enlever des couches sanitaires, des slips souillés, des seringues … et ainsi de suite.
Comment se faisait-il qu’on avait laissé pourrir sur place si longtemps ces objets – au moins deux ans selon l’étendue de la mousse et du feuillage qui s’y étaient superposés ?
Dans ce bois de beauté en régénération ? Comme le secret honteux du coin ? En fait, je perçois que c’étaient des déchets, des rebus, cela n’existait plus, comme une crime enfouie dans l’amnésie – la mémoire traumatique. « Nettoie ta merde, ce n’est pas la mienne, je l’abjure », quelque chose de la sorte.
On fait pareil, finalement, dans plusieurs domaines, la pollution sonore cesse d’avoir de l’importance hors monde humain, les périmètres de l’intolérable rétrécissent, la nature ne réclame pas ses droits, noyée dans le vacarme du transport routier.
Si chacun prend sa petite responsabilité, le monde s’améliorera, n’est-ce pas, petit colibris, petite merde ?
En fait non. La friche, c’est la rage contre l’inachevé des autres, la culpabilité non-reconnue de l’échouage collectif. C’est la liberté de faire ce qu’on veut, cette friche-nature. Y attirer l’attention, c’est inviter des emmerdes.
Le recyclage de l'industriel est en train de devenir une industrie en soi, la recyclerie via la ressourcerie. Elle bénéficie de beaucoup d'espace dans l'ancien industriel, les hangars et usines, et de subventions d'état.
Cependant, il ne faut qu'un moment de reflection pour constater que tout ne brille pas dans ce monde apparemment vertueux. En favorisant l'essor d'un nouveau champs industriel - la récup et remise en forme de matériaux industriels, on crée un nouveau marché pour l'industriel. On perpétue l'industriel.
Deuxio, l'amplification de ce secteur, au dépens d'autres secteurs, exemple : l'humble potager à légumes, peut faire perdurer l'industrialisme, là où nos intérêts écologiques tirent plus vers notre réintégration à une vie moins industrialisée. Or, on risque de retrouver à cette époque critique bien peu de jardiniers mèlés avec beaucoup de bricoleurs, de maçons, de charpentiers, d'éléctriciens, tous avec des savoirs faires et des intérêts dans l'industriel et le toujours plus.
La voix de la nature se fait entendre dans la voix des jardiniers expérimentaux, qui sont si peu et si peu soutenus, lorsque l'industriel et ses succursales prennent presque tout. Les jardiniers sont des connaisseurs intimes de la nature, qu'ils sachent aménager la terre (écologiquement, hydrologiquement, à main) ou qu'ils connaissent la culture des plantes. Où est leur voix? Ces métiers, plus ceux de la transformation et la mise sur le marché des produits de la terre, doivent croître, surtout à petite échelle et au niveau local.
C'est dans cette infrastructure écologique dynamique que nous pouvons trouver les plus grandes transferts de l'industriel, avec ses énormes surcoûts énergiques, au post-industriel - l'usage intelligent de ressources naturels qui viennent de notre milieu de vie. Nous ne pouvons pas, en toute bonne conscience, continuer de gonfler artificiellement nos besoins physiques en énergie, alors qu'en utilisant notre intelligente coopération collective nous pourrions nous en sortir avec plusieurs fois moins.
vendredi 29 octobre 2021
« Montaigne n’était pas humaniste ». Bizarre.
Science Fiction as against Fiction
« Peur du totalitarisme » contre « Peur écologique »
Preuve de l’existence de l’espace-temps, l’avenir n’est plus un refuge à l’usage exclusif des technophiles. Une autre science est dorénavant possible.
Les pays lointains, imaginaires, d'ailleurs, du passé, de l’avenir s’imposent, se sur-imposent sur les « affres du présent ».
« Mène ta bonne guerre dans le corps et l’esprit d’Arnold Schwarzenneger ». Crée ta réalité, ton metavers ».
« La déliquescence sociale généralisée » avec des compléments techniques [et mafieux]. »

« Qu’y a-t-il après un éffondrement sociétal ? »
Optimiste, constructiviste, pas fermé
Là, je vais passer à la vitesse supérieure
A la radio, j’entends 2 nouvelles garanties à nuire à tout optimisme, ils sont doués pour cela.
Le cerveau de l’être humain a commencé à rétrécir il y a 300 000 ans, selon des analyses plus repoussés. On a pensé auparavant que ce rétrécissement est venu avec le néolithique, il y a 10 000 ou 3 000 ans.
Les machines produisent 200 fois plus que les humains. C’est-à-dire, il faudrait 200 humains à la place d’une, sans machines. Sous-entendu qu’on devrait travailler comme des bougres pour avoir le même niveau de vie qu’aujourd’hui, s l’on perdait l’usage des machines.
J’adore ce genre de statistique, … pas. Si c’était une question d’intelligence collective, comment se fait-il que sur les médias ils parlent de « productivité » de cette manière, comme si c’étaient des fait avérés, incontestables ?
Au contraire, on vit avec la productivité comme avec un mauvais voisin, de plus en plus. Depuis quand la productivité ne se mesure-t-elle qu’en unités énergiques ? La machine humaine « pèse » soixante watts. Elle produit soixante watts. Elle peut faire un tas de choses, à moindre prix énergétique que la machine machine.
Comme moins voyager, ou voyager moins loin, par exemple. Ou bien plus. Une bonne promenade, au moins une fois par jour, fait généralement du bien. Plus de voiture, encore plus de bien. La réduction du dépens énergétique nécessaire à l’existence de chaque humain serait énorme si cela eut lieu.
Qu’est-ce que produisent exactement les machines ? Plus de travail pour les machines, peut-être, mais qu’est-ce que cela a à voir avec nous alors ?
Quel est le « coût-bénéfice » (cost-benefit) – à qui se rapporte-t-il ?
Si j’achète une voiture, je fais la bénéfice de ceux qui font et vendent les voitures, ceux qui font les routes mais à moi-même ? La bénéfice est de rouler en voiture. De pouvoir se déplacer plus loin. A quel but ? Ces pistes de réflexion ne révèlent aucune bénéfice énergétique pour l’humain, par le sur-usage des machines. Les statistiques révèlent une surproduction est une surconsommation d’énergie massives, mais la logique de leur utilité, pour nous, est une logique de l’économie circulaire des machines, on produit des voitures pour aller plus loin, on consomme donc plus d’énergie pour aller plus loin, mais « il faudrait 200 humains pour aller aussi loin, avec autant de poids sur le dos » ou « on ne pourrait pas vivre comme maintenant, dans des maisons en parpaings et béton, sans le transport routier ».
Le lien causal n’est pas démontré, ni même tenté entre le « coût » de l’usage des machines et la « bénéfice » à nous, humains, il est basé sur une auto-référence, créant ainsi une définition de la croissance économique sans base sociale. Les cadres de référence logiques sont choisis pour la mise en valeur de la machine. La tentative de rattacher ce monde de logique circulaire au monde physique humain se fait par le mot « productivité » – l’homme fait « plus » avec une machine entre les mains – plus de quoi, pour qui ?
Pour compléter cet analyse, non sans intentionnalité ironique, je retourne l’idée de ma petite tête, face aux géants intellectuels d’antan. Cela me fait doucement rire. L’hypothèse qui s’est présenté, c’est qu’il leur fallait faire avec plus, parce qu’ils avaient moins d’entre-nous. Et puis … ?
jeudi 9 septembre 2021

Si l’on ne s’aime pas, comment vouloir se défendre ?
Est-ce
qu’il y a des bonnes raisons pour vouloir se défendre ?
Pas encore …
Les gens vivent cachés. Pas de signe visible de vie … et son revers qui resurgit, le clannisme ostentatoire, des fois qu’on ose, ...
La place publique déserte, que des voitures et leurs intendants sur la voie publique. L’espace privé, un autre monde. À huis clos on s’épanouit, on se le défend, férocement. Les foules réprimées, l’ordre publique entretenu comme une pelouse sans accident.
Chez soi, la subjectivité tout embrassante, donc. L’autodéfonce contre les excès, les abus du toucher, objets brûlants du dernier renfort.
L’entre-soi à part, la séparation consolidée. Il n’y a pas de retissage social possible, juste des isolats pragmatiques qui attendent la reliure qui ne vient pas d’ailleurs.
Les franco-résidents ne sont pas racistes. Tout individu, vert, noir ou blanc, peut attirer leurs foudres – a-t-il lieu d’être, ici ? Ôte ton ombre de ma lumière !
vendredi 27 août 2021
Je pense aux mouvements monastiques du treizième, quatorzième siècles. La modernité est un concept vieillot.
Et la langue humaine, contre la pensée en parallèle des ordinateurs, est-elle devenue caduque ? Sommes-nous « surplus to requirements » ?
Plus que Plein Emploi
Ce n’est pas nous, mais la civilisation proto-industrielle et industrielle qui disparaîtra.
Une longue fleuve agitée. Neutraliser l’espace n’est pas efficace. Le temps ne s’arrête plus pour nous.
Les Trailblazers découvrent et balisent les chemins de la nouvelle économie, au concret.
Le sous-emploi sous-traitant, obtenu par la sur-classification des millions de citoyens en « sans emploi », handicapés, maladifs de longue durée, fragiles, retraités, se verra remplacé par le travail humain d’« exister », non-assisté, de reconnexion terratoriale.
(09h04 8.9.21 : « défense des piétons en ville » … entre banlieues … finalement ils ont compris … et à la campagne les carrossopelléteuses feront briller notre nature?)
Le système de « voies vertes » aura comme critère le bilan écologique et énergétique net positif des œuvres.
L’air est pesant de l’odeur de la récolte – des effluves de maïs, de fourrage, tout azote, de masse de raisins, de pommes pressées.
On parle de la Belle France à la radio. Je n’ai jamais vu autant de laideur. La beauté ne se manifeste qu’en ruination, incrustation, lichenisation, émoussement, végétalisation, mais les dessins architecturaux monumentaux, les milliards de parpaings, le crépis, la dalle – qu’ils crèvent, tous !
samedi 28 août 2021
Le Tarn, grand et gros. Je n’ai pas mentionné la Cathédrale d’Auch, qui me semble un rare exemple du réussi dans le genre bâti, avec ses colonnes mi-doriques élancées, massives, quiètes.
Je suis devant d’autres massifs d’artifice – à Villemur-sur-Tarn, son pont en suspension, son château en briques.Le bâti, manifestation physique de la dominance humaine, dépassée par les événements, reste largement et longtemps inusitée, attend sans lendemain.
Devant ce château, sous un saule pleureux, je vois, amusé, une rectangle non-fauchée non-fardée, où poussent toutes les adventices du coin, comme des hooligans, la chicorée, le chardon, le larbin. On parle de parcs naturels URBAINS à la radio. Architectes, démissionnez !
Le mouvement du décrépit, des squats, des photographes de l’abandon, fait naître la question des sans-abris, complices en désuétude.
Qui le veut ? Le mobilhome utérin attire la vieille génération comme une exosquelette, la camion/nette les âges moyennes, les trentenaires, les quadragénaires, dans leurs délires « travellers » du grunge. Les jeunes ne s’y retrouvent nulle part, la mode réfugié – portable, chaussures de sport, pantalon de sport, T-shirt, trottinette et basta – surgit des cendres. Comme les ruminants, ils trouveront de quoi s'en sortir, sur le chemin, à l'arrache.
Après tout, le bonheur se troue dans les interstices du croisement des réseaux sociaux – plus que désincarnés, très humains, réduits à l’essensoriel – on n’aspire plus au massif matériel sinon à la liberté corporelle sans attaches visibles. La liberté mentale est déjà acquise, dans la seule « possession » qui compte, l’appui social, sa secrétaire soumise, le téléphone portable, sans lequel on n’existe nulle part.
La réphysicalisation qui se propose, d’urgence, existe dans ce contexte d'un monde contenu dans un petit objet de pouvoir. L’espoir est que la dynamie restante nous devienne le bien le plus plus précieux – comme pour les réfugiés. Pour qu’un réfugié se sente chez lui, la voie est claire – il lui faut de l’accueil – où qu’il va – ce facteur lui devient gouvernant. À défaut d'autre solution, l'essence lui achète l'autarcie illusoire en forme de voiture-bulle.
Le téléphone portable va-t-il arriver à relever le défi, face aux détenteurs de propriété et de biens massifs terrestres, des lits, des lieux, de la voirie?
Une vie simple, en mouvement, par contre, celle d’un réfugié climatique, offre cette condition nécessaire. C’est déjà beaucoup pour cette génération naissante, bloquée de tous bords par ces vieux hippies irrécupérés de la surconsommation, de la malbouffe, de la toxicomanie. Si les jeunes à la rue s’invisibilisent – et les confinements ont servi de bon entraînement à cette fin, c’est que leurs portables, jumeaux siamois, les permettent des associations, des rassemblements de cœurs – un tissu social – malgré ce qui ne peut qu’être aperçu comme une volonté de fer en velours de la part de leurs aînés de les « encadrer », de les insérer comme des ampoules dans une société d’aliènes. Sans GPS, où sont-ils?
Soumis en extérieur, ils s’en fichent à l’intérieur : « Never a frown, with golden brown » serait l’expression équivalente de la génération « punk psychédélique » qui régit nos vies actuelles.
On peut plausiblement s’imaginer une future vélorution sur ces bases. Des routes devenues des pistes minuscules, peuplées de trotinettistes en relais, en « snatch » social passager, relié ou non par des cordes invisibles.
Comme le cam des soixante-huitards, le portable de la génération CoVIDE n’est qu’un véhicule à passager des fantaisies modèles. Ce n’est pas qu’on veut abandonner sa drogue, c’est qu’il se peut qu’elle ne sera plus de mise. Bouger son cul fait plaisir en soi. Et au proche avenir, qui voudra un portable, si on l’a, tout entier, dans sa boucle d’oreille – au plus près de sa tête ? Le visuel, l’écran mental, est assurément matériel encore, mais l’auditif en est un autre mental, en ondes.
Pour cela, par analogie, la régie « dynamie » prend toute sa résonance avec le proche-avenir probable.
On aime voir et caresser les choses qui nous sont chères, mais pour entendre, pour transmettre, on a besoin d’être audible et caresser avec sa voix.
L’écran tyrannise et inflige. Il permet peu la lecture – les mots redeviennent sigles – des signes visibles, des simulacres de substance. On redevient jaloux des oiseaux libres dans leur envol – je vois des pigeons percher au grès sur un tronc coincé au coin de la retenue riparienne. Ils sirotent les eaux poissonneuses à délice.
Il m’arrive de penser qu’à l’époque du portable, ce serait plutôt mieux d’afficher sur le front un petit panneau « non-disponible » que de le mettre sur le téléphone, comme cela on ne risquerait pas de parler avec quelqu’un en présentiel lorsque sa pensée était avec les virtuels. Juste en termes de politesse et de clarté ...
Nous sommes qui pour ne pas être jaloux des drones ? Lorsque la vie réelle de sédentaire statique devient insupportable, il faut se faire bouger dans ce bel monde. Belmondo pirouette en patinant sur le mur de la retenue, tout en grâce, vers la fabrique en briques, 1930 écrit dessus, sifflant sa fierté hydraulique d’industrielle insoumise.
Il faut mentionner ces bruits. Les bruits de l’industrie. J’ai entendu toute une émission sur la nuisance sonore, qualifiée par ses décibels, comme si l’on pouvait qualifier la puanteur de la merde en points sur l‘échelle de Richter !
C’est quand qu’un bruit devient insupportable ? Chaque voiture qui me dépasse m’offre un son devenu insurmontable, crée des milliers de concaténations de caoutchouc contre granulés bitumineux. Le pays tapi de goudron et d’échardes de terre brûlée ! Je veux le velours de la prairie douce, prête à caresser mes plantes de pied souples et nues. La nature, je me la veux douce, même dans sa sauvagerie.
Je veux renoncer à être exploitant, destructeur, pour devenir intégrateur, fédérateur, ensemble avec mes pairs.
Pourquoi ne peut exister cette Utopie ? Qui dit non ? Elle ne vient pas de nulle part, elle est juste malaxée partout.
Ces Utopies non-brutes deviennent l’aspiration – la mode – c’est en cours. En France métropolitaine – la vaste métropole rurale urbanisante que nous nous sommes créée, comme des cons, peut devenir notre monde à l’infini de demain. On peut la mesurer dans la transformation de notre bâti en harmonie et en intelligence naturelles, pas en délimiteur artifice-nature.
Nous sommes « en quête de savoir »
Diary dimanche 18 juillet 2021
À célébrer ? J’ai dormi auprès d’un lac à Le Fauga, en route à Toulouse. Que des bétonniers, / trains / autoroutes / truites / moustiques – et la chaleur. Il y a trois jours j'étais près de Sentein, à 1800 mètres. Ah, la plaine!
Diary lundi 19 juillet 2021
Là, j’arrive au Pum. Des énormes hangars pas loin de Compans-Cafarelli. Cela me fait penser à un squat où j’ai passé la nuit à Bilbao. Avec un autre, on était enfermé pour la durée dans un énorme local. Peut-être en 2002. On nous a essentiellement laissé occuper l’espace, sans direction. Le décor et la manière de faire sont à peu près identiques ici - mais il y a des gens chaleureux. En réalité ce lieu est dans sa sénescence, il attend le coup fatal de l'expulsion, il reste l'équipe de veille. J’ai été reçu par quelqu’un qui a ensuite disparu, il est en train de soutenir une conversation marathon avec sa sœur dans un pays de l’Est. Plus tard, malgré la barrière de la langue, j’ai tenté de lui avancer la thèse que l’écologie est incarnée, physique, mais que nous, nous sommes devenus des machines à rayon indiscriminé. Il en va de son séjour en France – s’il ne connaît ni la langue, ni l’histoire du pays dans lequel il se trouve, il risque de se faire virer, avec ces nouvelles épreuves chauvines. Mais si les réfugiés sont malaxés par l'administration, ils ont toujours le recours à leur communauté humaine - les outils virtuels les soudent parce qu'ils favorisent le diaspore, tandis que le sédentaire n'a que son manque de paysage humain d'ailleurs. En fait les gens qui se tiennent à distance, surtout dans l'après-virus, subissent l'effet ricochet. Se sentant eux-mêmes isolés, ils s'isolent, pourque la bulle de chaleur humaine perdure mieux dans leurs têtes.
Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas plus remarquer. La culture « squat » est l’une des cultures les plus stables, les plus inchangées, les moins évoluées, depuis au moins les années 1970. Je n’y comprends pas grand-chose – pourquoi des lieux qui se veulent progressistes, développementaux, où toute liberté est assurément donnée à créer et à innover, est-ce que le résultat est si copié-collé? Peut-être on se laisse influencer, opprimer même? Et les moyens de bord sont à peu près pareils. On m'accuse de présomptivité. Il est vrai que ces observations pourraient provoquer de la colère, alors que je suis plutôt souriant du plaisir de la retrouvaille de lieux si familiers. L'engagement que j'apporte est, de ce fait, d'abord critique.
On peut faire des hypothèses. L’Intelligence Collective, décrite par Joseph Henrich (Harvard, 2016) et que je préfère appeler la stupidité collective (l’une ne va pas sans l’autre) a besoin de « turnover », de brassage, de traces lissées. Or, le désir et l’enthousiasme des nouveaux squatteurs est de faire eux-mêmes, comme les enfants qui construisent des cabanes dans les bois. Le caractère d’un squat est d’accumuler de vastes quantités de matériel, de récup et de bouffe, de l’organiser dans l’espace, de commencer des œuvres d’art qui, étant donner le caractère impermanent d’un squat, sont éphémères. L’intelligence collective n’existe que dans la transmission de la technique "loge", avec les moyens à bord. Le collectif n’est, dan les faits, pas collectif. Le savoir de la bricole - et que de la bricole - se transmet de la génération d’avant, sans opposition – c’est le seul savoir cohérent. Il en surgit des chefs d'oeuvres, un dialecte, des futurs systèmes sociaux, par des bribes et des brins. Et l’adolescence est à perpétuité, amen.
En arrière-pensée, je sais que ces mêmes gens, s'ils se trouvent dans un lieu de savoirs fementés, un jardin par exemple, où les plantes poussent sans craindre l'abattage, ils s'appliqueront aussitôt aux exigences du devenir de ce lieu-là, qui n'est pas plus figé qu'un squat, mais qui a sa propre temporalité. Il est difficile de s'avouer qu'on est touché par les traces visibles de l'impermanence, de la destruction anticipée. Mais j'ai une conviction croissante que c'est de cela que ça traite - notre destruction de notre environnement est codifiée, comme une expiation céremoniale des traumatismes récurrents. Le squat est une oeuvre à clef.
Diary mardi 20 juillet 2021
L’infrastructure dont il se traite est une infrastructure écologique dynamique – qui remplace de manère incrémentale l’infrastructure routière et industrielle présente. Il y a des écrits détaillés à ce propos ici : www.cv09.toile-libre.org mais il faut avouer que cela se passe dix fois mieux à vive voix et en actes. Ces écrits de référence donnent un coup de pouce aux flux de communication dynamiquement stables - le prérequis du consentement informé.
Le but, étant ici sur Toulouse, est de chercher des co-activistes. Avec un bon sens du timing : c’est précisément le moment où tout le monde se sauve à la campagne. Peut-être qu’il ne reste que des inactifs, des décrépits et des frustrés ! On se fera bonne compagnie. Le progrès se fait toujours aux marges.
Il faut s’imaginer qu’il y a un ferment d’énergies sociales réprimées – qu’à la campagne se fera le point rencontre de rupture, en cet été urbain co-vidé. Mais moi, je ne me fies pas aux apparences, je veux des preuves ! Je pense à ma ville balnéaire d’enfance – Swanage dans l’occurrence – qui pullulait d’ados français d’une impolitesse exécrable en été – et qui, en hiver, devenait le lieu de rencontre par excellence des jeunes du coin. On avait un nom pour les touristes estivants : les groks. Je n'ai pas l'impression qu'ils arrivaient à faire quoi que ce soit pour retisser des liens durables, pas basés sur l'appât du gain.
Cette transhumance en meute – une affaire de porcins plus que d’ovins. "Si tu subis ou tu es témoin d'une oppression, permets-toi de casser l'ambiance - elle est sûrement déjà pourrie". C'est une citation de pancarte qui se trouve ici - je me permets de vous offenser sur cette base de non-affabilité amicale.
J’essaie d’y mettre un tilt. Un pas de côté. Les lignes de force sont extensibles, même en été. Pourrions-nous faire de nos voyages individuels des retissages de réseau, cette fois-ci pour donner une vraie place aux pauvres, aux voyageurs et aux frugaux - les pratiquants de l’économie écologique à venir ? Laisser des traces positives derrière nous, pour tous ceux qui suivent dans nos pas ? Sans être figés nous-mêmes, est-ce que nous pourrions bâtir les fondations d’un entre-nous qui permette à tout le monde de voyager, de travailler, de trouver sa place en mouvement, en non-sédentarité ? Il suffit de si peu de choses, maintenant, pour que cela devienne réalité.
J’espère que la crispation de ma voix en symboles ne se fait pas trop sentir. Cela fait des années que je travaille à ce but. Je vois des signes d’espoir, beaucoup d’espoir, en ce moment-même. Les gens bougent – ils s’éparpillent partout. La difficulté primaire, de réfléchir ensemble sur un projet, d’en décider et finalement de se mettre en chemin, enfin de se déconfiner, n’est plus de jour. Là, il faut sauter sur le cheval à galop.
Le plus difficile pour moi est de narrer le banal – banal pour moi, inconnu des autres encore. Pour arriver à contester une infrastructure – l’industriel dans lequel on nous a macéré ces longues années, il en faut une autre, sans industriel, qui se tienne. Cela se fait par des actes d'accueil, des préparations de chantier pour les autres - l'homme à tout faire n'étant pas de mise.
Pour une bonne partie d’entre nous, c’est à peu près à ce point-là que surgit la phrase « mais on ne peut pas revenir en arrière comme ça ».
Pour moi, le passé est industriel, mécanique, fait de pétrole, de métal, de superhéros mécaniquement assistés. L’avenir se trouve dans les sciences du vivant, de la mixité, d'un domaine dans lequel les avancées ne cessent de croître, tandis que le mécano-physique est plutôt dans une période de stagnation. Il se peut que bientôt même nos outils informatiques seront construits d’ADN – ou plutôt auto-construits, ou « poussés ». Le physique, c’est le vivant, maintenant plus que jamais. Il y a cette convergence, là où il n'y avait que divergence.
Notre civilisation se caractérise par la surconsommation d’énergie, jusqu’à il y a peu doctement inépuisable. En regardant de plus près le vivant, on observe l’adresse avec laquelle il économise ses moyens, l’élégance des solutions qu’il trouve face aux obstacles. Nous en faisons partie. Nous en faisons dorénavant la plus grande partie, nous et nos bêtes, nous et nos céréales. Il en va, maintenant, du monde du vivant, dont nous, dont nous surtout.
L’industriel est déjà du passé, il ne peut nous donner des réponses satisfaisantes à l’avenir. C'est une divorce sans faute, mais nécessaire à nos vies. Si l’on dit « un autre industriel est possible », sûrement, on ne jette pas le bébé avec l’eau du bain. Mais c’est un industriel qui risque d’être méconnaissable sinon l’antithèse de ce qui existe à présent. C’est-à-dire qui respecte l’échelle du vivant, qui rephysicalise nos rapports, dans un mosaïque de contacts entre échelles, puisque nous, êtres physiques, vivons interpénétrés d'une nature également physique dans toutes ses dimensions, une réalité que nos artifices nous épargnent sans rien résoudre.
L’industriel nous a invité, selon l'expression bien connue, à faire « des économies d’échelle ». Je traduis : il est prêt à tout niveler, tout uniformiser, pour la plus grande utilité de machines chaque fois plus gargantuesques, ou en tous cas plus ubiquiteuses, qui nous remplacent, qui mutile et rend inutile la majorité vivante.
De manière plus indirecte, insidieuse, nos déplacements et nos communications à distance font le boulot de l’industriel en nous détachant des réalités physiques des êtres naturelles qui nous entourent, autant humains que non-humains. Les groupes sont statiques, pas dynamiques, dans ce monde de course poursuite à haute vitesse.
Prenons l’exemple d’un village type de cent habitants à la campagne. 30 font la navette chaque jour à des boulots à 50km autour, sinon plus loin, en voiture. Ils ne connaissent que les noms des bleds par lesquels ils passent, en chronomètrage. 10 font du télétravail – ils ne sortent guère de chez eux. 30 sont des retraités ou des malades chroniques – auxquels on donne de l’aide à domicile, venu de loin, en voiture. L’école primaire est dans le prochain bled – on y va en voiture. Les ados sont en pensionnat, au lycée pendant la semaine - c'est le car. Tout le monde va aux grandes surfaces – à 30 kilomètres de là. 5 personnes cultivent la terre et en gagnent leur vie, il n’en faut pas plus pour servir les machines qui fournissent le gros du travail. Une partie des maisons reste inoccupée neuf mois sur douze, ce sont les maisons de campagne des riches urbains.
Et tout le monde, mais tout le monde, dans ses heures libres, fait tourner la débroussailleuse pour réduire sa nature à des proportions gérables. Le jardinage se rédéfinit, à son tour, à un seul geste. En fait, la débroussailleuse, elle broie plus qu’elle ne coupe. Peu sont les insectes – et leurs œufs – qui s’échapperont du carnage. Une faucille, une faux, elle ne fait pas ça. Je note qu’il y a de plus en plus de machines qui broient – qui déstructurent et gazent la vie. Que les nuisances sonores, surtout en pleine campagne, se déchaînent, comme si l’humain avait horreur de la nature qui s’écoute.
La révolution post-industrielle sera donc composée fatalement de notre silence mécanique, pour que la nature retrouve sa voix - et nous notre chant, notre chantier, notre sentier de vie.
mardi 20 juin 2021
On aurait du le voir venir. On, c’est au moins moi, bien entendu. Avec tous ces verbes censés faire du sens, singuliers, pluriels, faits pour interpeller et instrumentaliser, il n’est pas facile de se fondre dans la masse. Et pourtant, on fait masse, peut-être comme jamais auparavant. On n’a que peu de prise sur la masse, finalement. Les chiffres ne font pas masse, mais blocs et tendances. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas plus remarquer (si je le sais je ne le dis pas). Les chiffres sont quand même à la base de notre démocratie. Peut-être c’est pour ne pas être accusé d’hérésie qu’on ne le dit pas ? D’un côté, les riches et les puissants, qui avec leur libre arbitre décident, de l’autre côté « les masses », faisant offre chiffrée. Les élections passent. Avec étonnement las, les commentateurs notent qu’ils ont de nouveau totalement foiré les prédictions de tendance. Lorsque le modèle ne fonctionne plus, est-ce que l’on peut se permettre d’en inventer un autre ?
J’en ai un ! La vie est exponentielle. D’un moins que rien, tout peut naître – la singularité peut vite devenir la norme. Les tendances ne fonctionnent, tant soi peu, que lorsque le vaisseau atteint sa vitesse de croisière. Toute autre interprétation est tendancieuse.
Si l’on y réfléchit un peu, une masse d’humains numérotés est composée de petits amalgames sociaux, ce ne sont pas des atomes, mais des grains. On les divise avant de reconstituer la masse à une échelle supérieure, la gagne-pain que l'on appelle la démocratie, mais dans la vérité historique, ces mêmes humains ont eu plutôt tendance à agir en « bandes organisées » qui se cumulent pour passer au prochain rang. Tandis qu'émane de la démocratie une sorte d'absence de structure sociale définie. Selon la rhétorique unitaire, la liberté est absolue parce qu'individuelle, mais dans ce cas, on a une machine à broyer l’humain social. Si l’on y rajoute des portables et des identifiants universels uniques (les « prime keys » des bases de données), on s’est créé un monde où la résilience et l’autonomie sociales sont mortes. L'individu est massifié, son identité, aussi unique qu'elle soit, ne l'est que par rapport aux géants. Si l'on devient obsédé par les catégories sociales, c'est plus comme stigmates qu'en donneuses d'une autonomie quelconque.
Il est assez facile de prédire, à partir de cette analyse, nos comportements actuels, d’apparence autonomes, dans leur réalité plus dépendants que jamais. L'enfant se sent libre, mais est-il observé par un adulte? Ce n’est absolument pas au plus grand nombre de décider – les choix qui lui sont présentés sont infiniment peu divergents des normes en vigueur. La démocratie aménuise et amortit le risque de divergences politiques. Le corps social débat par tête parlante interposée, les têtes sont interchangeables, font une, même dans leur diversité.
lundi 9 septembre 2019
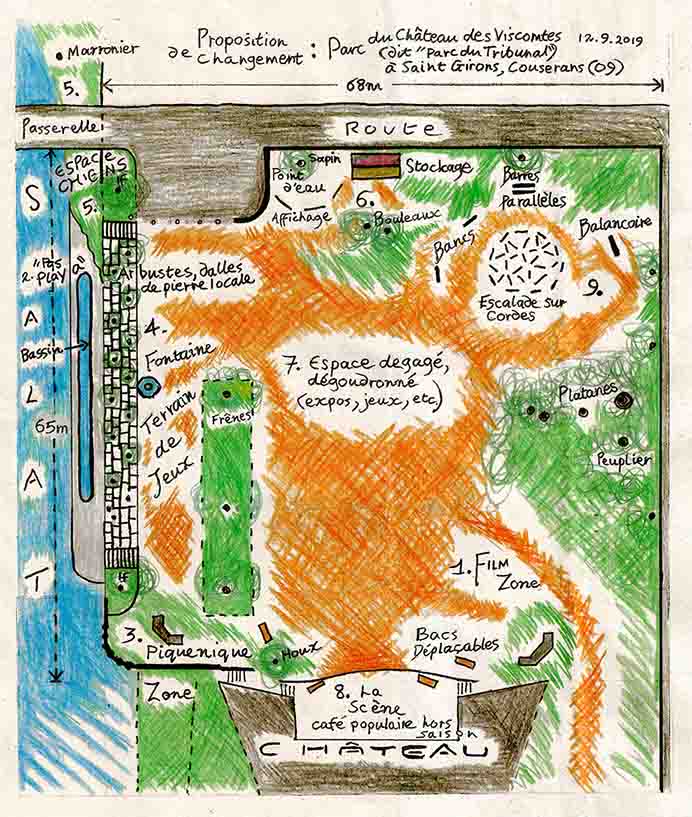
Sur les rivières de montagne au centre du Portugal il existe des playas (plages) qui servent de lieux de recréation très agréables et très fréquentés, surtout en période de canicule. A Saint Girons, l'été que l'on vient de vivre démontre la nécessité de lieux frais, naturels et ombragés en centre ville – la rivière sert pour refroidir la température ambiante, sans clime.
1 avril 2020
au lecteur : cette proposition tient dans sa logique, si vous voulez promouvoir des solutions écologiques non-techniques qui sont aussi des solutions sociales à la Crise des virus, aidez-moi à la promouvoir. Si elle a été ignorée au début, elle devient chaque fois plus logique pour chaque fois plus de monde, vu le développement de notre intelligence collective.
Il est proposé d’embaucher des gens pour faire face à la pénurie alimentaire et économique, pour nous ré-insuffler la confiance en notre capacité de travailler en entreprise commune et solidaire, en raisonnant ensemble nos différends et en les résolvant avec toute la dignité humaine qui nous est possible.
En ralentissant et en localisant nos déplacements – en les humanisant, par voie pédestre et à vélo – nous nous permettons d’identifier et d’arrêter à temps les contagions virales, tout en gardant notre liberté de mouvement. Pour normaliser ces modes de transport, il nous faut des terrains susceptibles d’être employés à la fois pour le maraîchage collectif parcellaire et pour l’accueil des gens et des denrées qui s’acheminent par ces voies lentes.
Situés près des centres de population rurale, ces jardins partagés servent aux gens qui les occupent, administrent et travaillent, qui ensuite expédient, transportent et acheminent leurs produits, aussi bien que ceux des gens du pays avec lesquels ils se relient.
Il va de soi que cette approche sans essence, sans machines auto-mobiles se construit localement, à vive voix, pour couper les voies de transmission virale et les dépendances sur le ravitaillement à longue distance.
Cette diffusion lente ralentit et permet d’attraper à temps la ré-émergence de foyers d’infection débordants. Ceux qui travaillent et se déplacent ensemble sauront qu’ils ne sont pas mutuellement contaminants et peuvent relier des gens isolés et en confinement qui le savent, eux aussi. Pas à pas, la vie collective reprend son cours, au fur et à mesure que ce réseau public se renforce et s’étale, en partant de plusieurs points ou « nœuds » de contact sûrs. Il est à noter que plus on est isolé, plus on est apte à cette tâche d’intérêt collectif.
A noter aussi : cette méthode est frugale, faisable avec très peu de ressources – mettant en valeur l’énergie et la bonne santé humaines. Elle n’exclut pas les méthodes industrielles de l’avant-crise Corona, puisqu’elle ne fait aucune concurrence pour les ressources industrielles, mais fonctionne en parallèle.
On peut observer que cette proposition de système souple et humain est très propice aux valeurs de liberté d’association, de non-surveillance et de non-oppression – pour que de nouveau la démocratie libre et non-autoritaire existe. Il est vrai que nous sommes tous devenus un peu toxicomanes du confort et de l’aisance que nous pourvoit l’inépuisable énergie de la machine et de son alter-égo, l’argent. Le confinement, est-ce qu’il a servi pour ébranler notre foi dans ces solutions techniques – détachées de nos réalités corporelles et environnementales ? Il a en tous cas donné beaucoup de place pour la réflexion, permettant que de nouveaux modèles de vie en commun prennent leur essor. Il devient clair que notre engagement humain s’applique à toute la surface de la terre – il ne suffit pas de laisser la campagne aux machines et à la nature – dont nous faisons nous-mêmes partie.
septembre 2018
Je suis en train de pratiquer l'infrastructure écologique nécessaire. Depuis six ans, je vis totalement sans essence, créant des espaces de partage et des gîtes de passage. Je me déplace à vélo, de marché en marché – une rotation hebdomadaire des marchés – en Ariège. Cela s'appelle « la Boucle des Marchés » - infrastructure intrahumaine, et les nœuds sur chaque boucle se rattachent à d'autres marchés dans les départements voisins. Cela permet aux gens qui font leur propre voyage d'avancer en laissant des traces positives à l'échelle du pays qu'ils traversent.
Cela fonctionne dans un cadre de détox informatique, sans argent sans essence – par voie humaine.
Une parenthèse – j'essaie de m'appliquer à créer de nouveaux éléments de langage pour mieux articuler la pensée, souvent nouvelle, écologique. Ne m'en voulez pas trop ! A vous de changer cette parole, afin qu'elle devienne plus intelligible. Cette idée de créer de l'infrastructure écologique « pour du vrai » est structurée par la théorie de l'information, appliquée à la vie – une sorte de topologie dynamique, une topographie vectorielle qui engage l'agencement humain. …
Je la pratique, je la modélise, en étude longitudinale, depuis six ans – c'est donc faisable, concrètement. J'ai pensé nécessaire et utile :
Je peux ainsi dire que ce système ne coûte aucun argent, et que la structure routière en France, si on la récupérait pour la culture écologique, en elle seule fournirait des jardins, des universités et des écoles linéaires pour nourrir toute la population. Cela change les valeurs de base. Un jardin – ou une école linéaire, c'est une manière de dire que c'est au bord de la route et qu'on y passe, régulièrement, à pied, à vélo, avec des ânes peut-être.
Les routes, c'est l’État. Ce n'est pas une question de les acheter aux particuliers. Les contrats communaux des cantonniers actuels peuvent devenir des fonctions de cantonnier vert, si la commune ou la communauté de communes le veut bien.
La décision politique clé se divisera entre contrôle sociale hiérarchique et emploi humain. Sans engagement de la masse de la population sur le gros de la surface, il n'y aura pas de vote écologiquement informé – il n'y aura plus du tout de démocratie participative à la Mendès France.
Il est donc critique d'évoluer les modèles d'engagement avec le territoire – ce modèle de « boucles » à l'échelle humaine ne coûte pas cher – sa mise-en-œuvre peut être immédiate.
J'entends des cris désabusés : « mais c'est où, le modèle concret du 'Big Bang écologique' dans un délai de 10 ans' ? »
C'est sous vos nez, en Ariège, en France. Sous le radar. Par rapport au mécontentement rural et péri-urbain, j'attaque les mêmes problèmes, mais par l'autre bout. En étant parfaitement pauvre, en vrai désert rural, je peux confirmer que si nous ne sommes pas riches, nous pouvons être en grande difficulté pour vivre.
Mais cela parce qu'il n'y a presque aucune infrastructure pour les pauvres – plutôt de l'hostilité. Par contre, des routes pour les riches, il y en a.
Si les groupes écologiques cherchent des vrais projets écologiques d’aménagement du territoire, venez. Il faut que vous soyez crédibles. Pas d'hélicoptère. Que de l'intérêt général. Il faut accepter que la vie est partout – parler des villes en avance sur la campagne, c'est illusoire. Notre engagement avec la Nature est sur toute la surface – c'est pour cela qu'il ne manque pas d'emploi humain rémunéré dans un monde avec des valeurs écologiques.
Les oppositions sont conventionnels. Les élites locales sont définies par leur sédentarité. Pour créer un autre modèle, nous avons besoin que les gens de la ville viennent à la campagne aussi.
Être « domicilié Boucle » - c'est-à-dire 'qui bouge sur un circuit chaque semaine' permet de satisfaire à l'équilibre délicat entre ceux qui y passent et ceux qui y résident. Cela permet la présence plus dense de populations humaines – et un soin plus détaillé de de la biodiversité que ce qui est possible par l'économie d'échelle et la machine industrielle.
Je trouve que nous devrions en parler sur les médias – que ce serait une signe de volonté de changement réel, permettant le débat public autour de modèles tangibles de transformation écologique de l'infrastructure.
Ce qui manque, c'est le détail du témoignage de ceux qui ont vraiment fait – cela nous fait gagner des années précieuses à cette époque critique.
Parlons-en. C'est pour cela que je fais cette démarche – pour essayer de faire ma part, pour créer cette légitimité écologique qui nous fait tant défaut jusque-là.
janvier 2021
Nous nous trouvons tous face à des bouleversements systémiques du monde connu jusqu’alors. Ces secousses profondes nécessitent des changements de comportement sociétaux à leurs mesure.
Qui dit « société » dit « infrastructure ». Dans la campagne, conservatrice de par sa nature, nous avons l’avantage que rien, ou presque rien, n’a été fait jusqu’à maintenant pour changer de modèle. La production locale de fruits et légumes en quantité suffisante pour fournir la région n’a guère commencé. En Ariège, le modèle pastoral domine encore.
Citation de « Le Journal d'Ici » fait à Massat le 27 mars 2020 :
en 2010 le Massatois comprend 2268 ha en SAU (Surface Agricole Utilisée), dont 2248 ha en herbe à bétail, 10 ha en terres arables et 5 ha en cultures pérennes (fruits).
Le nouveau conseiller municipal vert à Massat, Andy Gründel, a lancé un projet personnel de maraîchage (2020), de transformation et de vente de ses produits (bio) sur un demi-hectare (5000m²). Les projections de revenus annuels estimés, en fruits et légumes seuls, sans inclure la valeur ajoutée de la transformation, sont de l’ordre de 20 000 euros. Le travail est très largement humain et manuel.
A Saint Lizier, pendant quelques années (2010-15), il a existé un projet connu localement sous le nom de « Terres de Cocagne » qui a servi pour embaucher des gens dans une entreprise similaire. A la suite, dans l’absence de suivi de la subvention de ces emplois, les jardins ont été repris par l’un des meneurs du projet, à titre privé de nouveau.
Il est proposé ici que vu les potentiels profits énoncés ci-dessus et les changements socio-politiques en cours, avec un élan manifeste vers la relocalisation et le « Made in France », le problème qui nous fait face est :
« comment former, héberger et soutenir l’emploi des plusieurs personnes dont il y a besoin pour faire fructifier ce secteur dans le futur immédiat, sans que la remède ne soit pire (en termes de bio-diversité et de gazes à effets de serre) que le problème auquel elle est adressée ? »
Il est proposé ici que les ingrédients de base de la solution sont dynamiques – il faut que les jardiniers soient « mobiles » et ceci avec une consommation d’énergie par personne qui correspond à l’empreinte écologique vastement réduite qui nous est absolument nécessaire. Des ouvriers horticulturels non seulement « auto »-mobiles, mais avec une mobilité en résonance avec les besoins et à l’échelle du pays qu’ils parcourent.
Et ils peuvent vivre, au passage, dans et autour des jardins qu’ils entretiennent, en apprenant les techniques d’écoconstruction qui permettent de maintenir une profile énergique basse. La décision de passer à l’acte collectif est en soi pédagogique, puisqu’il engendre une réflexion concrétisée, appliquée. Ceux qui participent à ces entreprises peuvent aussi entretenir des jardins linéaires au bord des routes et des chemins publics qu’ils parcourent, et donner un essor aux activités naissantes d’entretien et de production des transports à vélo et aux gîtes et ateliers d’étape qui leurs seront nécessaires. Tout est possible lorsqu’on adapte les moyens de transport aux aptitudes et efficiences humaines plutôt que de faire plier l’humain aux exigences des machines hyperconsommatrices. Le défi en campagne est grand – au moins en apparence - et la réussite face à ce défi sera d’autant plus appréciée et moralement stimulante à cette époque critique où nous avons tant besoin de soutenance morale.
Ce tourisme fonctionnel, productif, peut remplacer le tourisme dépensier et consommateur auquel nos stratégies étaient adaptées avant le Covid. Il permet de donner de l’emploi et du sens aux vies des jeunes actifs, surtout concentrés dans les banlieues des grandes villes comme Toulouse, qui se trouvent actuellement face à la pénurie et au désœuvrement massif, sans porte de sortie. La frugalité de la vie de travail proposée permet aux employés d’épargner beaucoup plus que s’ils étaient obligés d’entretenir véhicules et maisons privées sur place. Cette possibilité de réduction des frais de nos vies, plutôt que la hausse de nos salaires, est une possible solution basée sur une vérité banale dans la gestion du bilan de toute entreprise. Si on est accablé de dettes pour acheter sa voiture, si on ne mange que des pâtes pour la fournir en essence et en assurance, on ne vit pas mieux, c’est évident. Les solutions existent au niveau d’une infrastructure totalement remodelée.
Pour que ce soit clair, ces propositions sont faites pour viser une synthèse ville-campagne vivable et avantageuse à toutes les parties concernées. Ce que certains appellent déjà « la Guerre écologique » se mène sur toute la surface de la terre – et il est d’une importance indéniable de donner des exemples de coopération à bénéfice mutuelle à des populations qui peuvent sinon se retrouver dans des positions de repli sur soi ou de sélectivité élitiste.
A ce but, il est nécessaire de concevoir des villes, des communes – des communautés de communes comme des rouages dans l’entreprise d’un monde en mouvement et pas comme des entités politico-sociaux statiques. C’est une question d’intérêt mutuel qui dépasse très largement les positionnements politiques conventionnels.
Le paradoxe qui nous fait face est que le tout (l’infrastructure) est tout autre que la somme des parts qui l’intègrent (nos vies individualisées et en groupe d’affinité). Nous avons besoin, surtout là où les distances sont plus grandes (en campagne) et la consommation par personne par conséquence plus lourde, de nous pencher sur ces problèmes de l’entre-nous (l’infrastructure) et non pas sur la vie individualisée et virtualisée. Il y a besoin de chiffrer notre consommation moyenne réelle, plutôt que de faire des gestes symboliques écologiques alors que le gros de nos biens de consommation vient de loin, à vaste coût énergique, induisant des dépendances sur les machines et sur l’infrastructure industrielle qui dépassent très largement celles des habitants urbains, eux qui ne sont pas entourés de nature dont ils pourraient vivre.
Il est vrai que l’attrait de la vie « dans la nature » assume des proportions tout-à-fait démesurées de nos jours et que par les lois du marché même, ceci met une prime sur l’occupation des territoires ruraux qui exacerbe la tendance à l’exclusion des pauvres de ces mêmes zones rurales. L’exemple donné – d’une vie de riche – est inatteignable pour la vaste majorité de nos concitoyens. Cette tension démographique est aussi une tension démocratique – les couches plus pauvres qui ne résident pas en zone rurale ne votent pas en zone rurale et n’ont pas d’intérêt personnel dans sa survivance – mais elles sont majoritaires dans le pays.
Cela fait du bon sens d’évoluer des plans d’accueil et d’accommodation en bon ordre des gens qui veulent apprendre l’écologie là où cela se passe, sur la vaste majorité de la surface du territoire, avant que cela ne devienne un péri-urbain irrépressible et ingérable.
Il y a déjà des partenariats potentiels à exploiter. Pendant la période de déconfinement relatif, pendant l’été de 2020, la ville de Toulouse a déjà envoyé beaucoup de monde dans les anciennes colonies de vacances restantes - à Aulus les Bains, par exemple. Le Maire de Toulouse a aussi chapeauté la consultation sur un plan d’urbanisation pour la commune d’Allières, prés de la Bastide de Sérou. Il ne manque ni d’intérêt, ni de liaison, entre nos grandes conurbations et les département qui les entourent, à l’échelle de l’élite administrative et politique. L’aménagement du territoire est un sujet qui leur est tout-à-fait familier.
L’appel d’air qui s’appelle Airbus, avec dans son train l’aéro-spatial et les plusieurs industries annexes, ont permis au Sud-Ouest de la France d’être en relative aisance économique pendant les dernières décennies, par rapport au reste de la France. La chimère de la croissance basée exclusivement sur le modèle industriel mondialisé a paru plausible, d’autant plus que la demande de services (le gros des autres emplois disponibles) est issue des employés dans ce secteur florissant.
Il faut savoir que depuis la venue du Covid, le chiffre d’affaires d’Airbus s’est réduit à un dixième du chiffre précédent et que cette réduction est inouïe, elle impacte de fonte en comble l’économie d’au moins deux régions du Sud-Ouest. Un autre modèle économique est non seulement nécessaire mais essentiel dorénavant – ce qui fait que les exigences écologiques auxquelles nous avons étés si longtemps volontairement aveugles, dans ce pays « sous-développé » sauf dans les industries de pointe, hyper-consommatrices d’énergie fossile, coïncident maintenant avec nos intérêts économiques.
Du point de vu de notre survie collective et donc individuelle, c’est une opportunité à ne pas rater. Notre campagne, notre région, n’étant pas encore totalement détruite, n’ayant pas encore subie de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique, a une latence cumulée et une capacité énorme de progrès, justement parce que son usage comme terrain de jeu et de repos pour les travailleurs de ces industries technologiques n’est plus à l’ordre du jour.
A Moulis, le CNRS vient de réaliser un investissement de plusieurs millions d’euros avec la possibilité d’accommoder jusqu’à 100 nouveaux chercheurs. La conversion à des entreprises bio-constructives des ingénieurs auparavant dédiés à la croissance d’industries qui ne pouvaient qu’accélérer la destruction de note biosphère est tout-à-fait faisable – elle est déjà en cours. Nous avons, en train d’arriver dans le Couserans, le matériel humain nécessaire à cette tâche. Les problèmes de rigidité hiérarchique du CNRS ont été récemment soulignés – l’existence de cette succursale renaissante dans le pays des libres penseurs est de bonne augure, s’il y a suffisamment d’engagement et de perspectives donnés au niveau local.
L’art de ce mouvement et de commencer à rouler – ou à marcher – déjà, sans attendre que les autres se mettent en branle – c’est un effet d’entraînement et d’action physiques qui font montre de faisabilité et qui ouvrent les esprits fermés. Pour cela, la démocratie participative est la condition même qui rend la démocratie représentative.
été 2020
Dépolluer, débétonniser, démystifions-le, c'est le boulot devant nous. Dans le domaine publique, sur les bords de chaque route, dans l’agrégat de ses sous-couches et le branchage de ses haies, la pollution s’est accumulée pendant des décennies, parfois des siècles.
Comment faire, donc ?
Il est proposé d’allouer des kilomètres de route à des équipes de cantonniers verts, qui d’abord observent, ensuite mesurent, ensuite constatent l’état de la route qu’ils fréquentent et les possibilité de faire revivre ses lisières, sa biodiversité.
Est-ce qu’il s’y trouve des espèces invasives, tel le Balsam de l’Himalaya ? Y-a-t-il des sources et des points d’eau sur le parcours ? Dans quel état sont-ils ? Le laboratoire d’analyses nous le dira.
L’appi « Jardinage linéaire » servira pour la mise en commun de cette information, permettant à chacun d’y participer à son échelle.
Peut-on arriver à un engagement de la part des autorités locales pour nous donner des contrats d’entretien – récompensés par les fruits de notre labour ? Des contrats qui servent à donner un cadre stable pour planter des arbres et des arbustes fruitiers - ou protéger de la fauche les adventices qui s’y trouvent déjà ? Peut-on aménager ces bords de route pour qu’ils servent de pâture ou d'ambiance productrice de bio-diversité ? Peut-on remplacer les machines faucheuses (très coûteuses) par des emplois humains et le travail des bêtes ?
Sur le terrain, on trouvera et on partagera les réponses. L’appi « jardinage linéaire » sera au service de l’humain qui travaille, il ne le remplace pas, l’inverse – il lui donne du travail et des compétences là où nous en avons le plus besoin, dans notre engagement avec la Nature.
mardi 9 mars 2021
C'est un petit livre – 100 pages, qui donne l'impression d'avoir été écrit hâtivement, peut-être dans le train ou après des séances au parlement européen, dans un certain état d'exaltation de la parole, avec les présuppositions « socialistes » qui font encore jour au niveau de l'Europe, si en France ou en Angleterre on est déjà passé à autre chose.
Les paroles et la politique de Jean Monnet, dans l'immédiat après-guerre 1939-45, exprimant le besoin d'avoir le peuple et les corps sociaux pleinement investis dans des projets de longue haleine, d'investissement dans l'infrastructure, sont récupérées pour une application de nos jours dans la « transition » écologique. D'autres lumières, connues surtout des socialistes, sont mis en avant, un tel Hyman Minsky (1919-1996) qui a proposé que lors de crises il faut embaucher tout le monde au salaire minimum.
On le veut bien, on ne dit pas non. Le problème étant que la version « moderne » de cette idée pourtant simple, est d'embaucher les gens à un, deux ou trois jours par semaine dans des contrats très limités et surtout qui ne donnent pas de quoi vivre, au gré du fonctionnaire qui le décide, sur des travaux qui ne font qu'intensifier la crise écologique. Ce n'est pas la parole d'une écologiste motivée à Strasbourg qui va changer la donne. L'administration est devenue plus forte que la loi - elle fait ses propres lois, en fait.
Si l'on veut isoler les raisons pour lesquels Jean Monnet a cru possible d'embaucher les gens de bonne volonté sur des travaux d'intérêt général, c'est que la guerre les a habitué a participer à des efforts coordonnés de grande échelle, dans un esprit foncièrement nationaliste, que la galère les a fortement motivés à s'en sortir et que les traditions socio-coopératives de l'époque étaient non seulement la norme mais aussi les techniques progressistes politiques que l'on croyait être de l'avenir. Il suffisait d'arroser le sol fertile avec de l'argent hélicoptère pour que tous les petits chefs du coin se mettent au travail, avec les bons vœux et l'engagement résolu de leurs concitoyens, ou dans le cas obstant, le désir prononcé de s'ammiler à la masse pour mieux passer inaperçus.
En 2021, le tableau n'est pas le même. Notre mot d'ordre dans ce combat mortel est de rester chez nous totalement démobilisés jusqu'à nouvel ordre. Les seuls projets, très amorphes et difficile à lire, qui nous sont offerts sont dans la rénovation thermique (qui paraît plutôt une autre usine à gaz pour les profiteurs) et la mise à jour numérique. Comme projets mobilisateurs du peuple, il manque une petite quelque chose pour capter l'imagination. Aller faire des jardins ci et là, tuer quelques bovins pour la forme, ce n'est pas garanti d'enthousiasmer les masses non plus. Pour entreprendre les changements radicaux de modèle proposés, il y a besoin de mettre les gens en immersion dans un monde où les rapports avec la nature et avec leurs frères et soeurs ont un sens pour eux, individuellement et collectivement - avant de leur proposer des gestes de bâton magique qui contredisent leurs vérités culturelles. Je fais un tour de projets potentiels plus bas dans cet écrit.
De surplus, l'idée même de mettre notre destin dans les mains d'une classe de fonctionnaires, de prétendus entrepreneurs d'entreprise zombie, de petits caïds et de grands brimeurs qui nous ont déjà mené une vie d'enfer ces dernières années, sans jamais chercher à promouvoir l'action écologique réelle, est un peu improbable comme motivateur du peuple. Ils s'en foutent de ce qu'on dit à Bruxelles. Le seul atout de Macron, en fait, c'est qu'il n'était peut-être pas intégré, d'apparence, aux groupes politiques existants, connus et déplorés – une notion dont on est maintenant totalement désabusé – l'élite, on le comprend, c'est tout le monde d'en haut – c'est un cartel, à chaque échelle, où qu'on cherche. Il faut se réformer, se détacher très visiblement de cette perception, pour que chaque tentative de créer d'autres réalités ne s'enlise.
Les preuves d'amour faits au combat dans la deuxième guerre mondiale manquent, de nos jours, dans ceux qui prétendent être les premiers de cordée dans un monde futur. Il y a surtout des preuves de trac du peuple – de peur que « ça déborde ». Il faut aller à l'avant, dans le peuple, avec le peuple. La solidarité à la française qui nécessite une sorte de subordination à chaque échelle à une personnalité dominante crée un genre de retrait de la vie publique de ceux qui n'acceptent pas ces trames de dominance. De ce fait la solidarité se fait surtout chez soi dans l'entre-nous, c'est-à-dire, pas du tout. Cette « boude » nationale fait que lorsqu'il faut agir, les pôles d'attraction théorique servent plutôt de repoussoirs. D'ailleurs, dans ces classes-là, on se méfie des « casse-pieds ». L'innovation n'est pas bien venue. Cela se fait déjà, apparemment, il y a une assoc. pour cela. Étant donné que la Covid a poussé ce désengagement politique et publique aux limites de l'absurde, il est vrai qu'on ne peut que remonter la pente. Mais cela est un constat, ce n'est pas une volonté, encore moins un passage à l'acte.
Des solutions, il y en a, mais même l'expression « solutions écologiques » a mauvais renom, tellement il y a eu de fausses solutions promues. C'est un peu comme chercher quelque chose sur Google, il faut tous les efforts possibles pour trier entre les informations totalement bidons et les cookies qui ne cherchent qu'à vous orienter vers leurs produits. Pour s'en échapper, il y a les services « premium » - c'est-à-dire des vrais services, mais payants, sans pub, ou on a fait l'effort de pré-trier l'information pour qu'elle soit pertinente. Même le Wikipédia devient une enceinte pour les protocolaires intriqués. On rève d'un bon dictionnaire en papier où au moins on n'a pas à se demander si c'est de l'information à peu près sûre.
La solution de base, face à ces contradictions, n'est pas tant d'arroser les gens avec de l'argent, (pour payer à ceux qui nous torturent ?! ) mais de faire que les gens sortent, qu'ils se déplacent physiquement et qu'ils se rencontrent physiquement, qu'ils fassent des choses écologiquement cohérentes ensemble, sans machines – surtout pas de débroussailleuses ou de voitures. Comme ça, c'est clair. L'un des projets pourrait être d'aller cueillir des légumes et préparer à manger, pour ensuite manger ensemble. Cela permet déjà d'établir les potentielles preuves d'amour qui, sinon, n'appartiennent qu'aux logiciels payants. Ces projets pourraient être menés par des chefs et des cuisiniers « des professionnels de la filière restauration » (j'interprète pour les malentendants qui ne parlent plus le français) qui sont, d'après tout, les plus affligés par le confinement et le couvre-feu et les plus motivés pour s'en sortir.
Rappelons-nous que la contagiosité covid est de l'ordre de 80% à l'intérieur en endroit clos, 15% à l'intérieur, mais bien ventilé, et 5% à l'extérieur (France Inter, Matinale, 17.3.21). Normalement, les fonctionnaires, les professeurs, les universitaires et les autres devraient être en train de montrer l'exemple en travaillant dehors, en bougeant à pied et à vélo, en mangeant ensemble dehors et en mettant à disposition du public des ordinateurs portables, des prises de courant et des hotspots - dehors.
La deuxième solution est que les gens qui sont sortis, qui ont mangé ensemble, qui ont réussi dans ces tâches élémentaires, commencent à proposer des solutions pragmatiques dans la même veine – le transport aux marchés des produits locaux dont ils se sont déjà renseignés et servis pour manger ensemble – ils savent donc où il se trouvent, ils peuvent eux-mêmes aller les chercher, ils n'ont pas besoin d'argent pour le transport, juste un peu de coordination et de contact humain avec des vrais gens. A ce moment-là, les « preuves d'amour » de l'administration seraient de ne pas les entraver les pas – même de leur ouvrir le chemin, dans le meilleur possible des mondes. Ces gens payés pour agir dans l'intérêt général pourraient par exemple mettre à la disposition des populations des lieux publics mais dans l'état ... vides, pour faciliter les déplacements, comme s'ils étaient dans un élan d'accueil. Tout cela se ferait sans machines – sans transport motorisé. Ceci démontrerait au moins que l'argent – et surtout l'effort public est en train d'être investi non pas dans les machines, mais dans les gens et dans leur milieu naturel.
Pour suivre donc dans les traces de Jean Monnet, on aura atteint le premier critère de succès potentiel, la motivation et non pas la motorisation d'au moins un secteur du peuple et la croyance que c'est possible, parce qu'on l'a fait. De lancer une telle initiative à partir des corps sociaux intermédiaires existants, y inclus les associations et les ONGs, ce serait déjà de se vouer à l'échec, tellement y en a ras le bol. Ces organismes doivent venir en appui – le monde administratif est encore tel qu'il est, et cela ne change pas du jour au lendemain, on le sait, mais (désolé de le dire) ceux qui sont les mieux placés pour mener de telles initiatives, ce sont les gens qui apprécient la bonne bouffe, qui sont déjà habitués à travailler en équipe, dans des cadres sociaux conviviaux. Des chefs qui ont des raisons d'être des chefs. Des « apolitiques » qui, en réalité, ne font que de la politique, mais pointue – qui n'est autre que le social, l'économie ménagère, l'accueil.
Il faudrait, par contre, à tout coût éviter de mettre dans des positions décisionnaires des spécialistes de l'administration, surtout les économistes, les financiers, les techniciens de l'informatique. C'est un cercle vicieux sinon. De mettre des gens qui ont démontré incontestablement leur coupure du monde physique – qui est celui qui nous fait jouir, prendre plaisir à la vie – dans des positions de pouvoir auxquels leur conditionnement et leur socialisation ne les ont aucunement formées serait un gros faux pas. Ils n'ont tout simplement pas les compétences nécessaires. Si on veut un monde ou il est plus important d'avoir le papier (ou le dossier, ou le cahier de charges, numérisés bien sûr) que le savoir faire de travailler physiquement avec les gens, on n'a qu'à continuer comme ça. Même dans les métiers de la restauration, il y a ceux qui prennent un sac scellé de patates déjà découpées par des machines pour les jeter dans un bac d'huile préchauffé au nucléaire, avec de la viande reconstituée venant de pays étranger comme base. Dans la restauration de l'état et les distributions aux pauvres c'est encore pire - tout est ensuite rescellé dans des conteneurs en plastique jetable individuels pour être rechauffé ensuite - comment veut-on être pris au sérieux quand c'est l'état même qui est le plus grand malfaiteur!? Mais il existe en France encore, de manière transgénérationnelle, une certaine fierté et savoir faire gastronomique, qu'il suffit de fusionner avec des critères écologiques pour réinstaurer un pôle d'attraction qui vaille, basé sur le réel, qui parle aux gens. Il n'y a pas que les Etats Unis qui sont en avance sur nous en termes de développement social (?). Il y a, dans ces domaines de la convivialité, les italiens, même certains espagols.
Ce qui est paradoxal, comme avec toute initiative sincère écologique, c'est que ce genre de cuisine populaire n'a pas vraiment besoin de subvention – il est plutôt générateur d'emploi réel et il utilise plutôt des ressources déjà existantes de manière intelligente et coordonnée. Il encourage le « made in France » - mais vraiment, alors qu'en général le "made in France" consiste en choses faites avec de l'argent et les matériaux premiers piqués des gens qui vivent ailleurs et qui travaillent pour des salaires de misère. Le problème avec cette mesure style : "solution de la singularité écologique" est que justement, il ne consomme pas beaucoup de ressources – la décision de ne pas utiliser des voitures est déjà énorme dans ce sens – et qu'il n'augmente donc pas la PIB – l'outil qui permet à la France de maintenir la confiance des institutions financières dans sa « solvabilité » - sa capacité de payer les dettes qui sont à peu près le seul outil qui reste au gouvernement pour maintenir la société à flot. Mais tant pis, on fera avec - il faut commencer quelque part, et anticiper un peu la probabilité de dislocation, paupérisation et extrèmisation de la vie de "la personne lambda" dans le proche-avenir. C'est vraiment le moins qu'on puisse faire, si on est un responsable politique même un petit peu renseignée sur l'actualité des lambdéens.
C'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas commencer, pour ce genre d'initiative, par rentrer dans le cadre décisionnel habituel – qu'on cherche à sortir les gens de leurs bureaux et de leurs voitures pour les mettre dans des conditions d'association humaine à peu près décentes, de nouveau. Je sais que ce n'est pas facile de mettre des lions qui ont passé toutes leurs vies en captivité à la nature, mais nous sommes supposés être plus "adaptables" que les lions. On y va.
Les habitudes de l'époque industrielle sont collantes. Les habitudes de la visioconférence aussi. Elles le sont d'autant plus qu'il y a l'inertie du non-bouger, d'être contraint dans son espace personnel et sécurisé. Il faut de l'intelligence sociale pour inventer – ou remettre en valeur - des cadres sociaux qui mènent à l'engagement avec l'altérité, multigénérationnels, chaleureux, décontractés, non-exclusifs, basés sur l'ici maintenant. Soyons rassurés que tout le monde, maintenant, a compris que c'est surtout ces groupes supposément hermétiques qui ont fait passer le virus, partout où ils volent, aux classes pauvres qui n'ont pas bougé. On sait qu'ils savent faire des garden parties dans l'entre-soi pour ensuite aller serrer la main du peuple devant les caméras - sinon comment auraient-t-ils pu transmettre le virus? On apprend, sans grand étonnement, que c'est en famille que cela se transmet. Le problème est d'inclure tout le monde, d'en faire une mode accessible. A vrai dire, l'espace publique, dans un traîtement intelligent de ce qui est une situation de maladie chronique, est notre principal atout. Le confinement, dans l'entre-soi, dans les transports publics, est ce qui se révèle le plus contagieux. Quelle drolerie.
Lorsqu'on parle, de manière impossiblement abstraite, du problème de n'être que des rouages dans une commerce internationale qui a pris le pas sur notre autonomie nationale, il faut savoir que le fonctionnariat de la France est également capable de totalement déplacer toute décision qui nous impacte, les mécanismes à l'œuvre s'en foutent de la distance, du lieu et de l'échelle, cela ne change aucunement leur nocivité.
Sans téléphone, en campagne, vous pouvez observer les fonctionnaires dont vous dépendez, qui vivent à côté de chez vous et qui se déplacent à leurs officines chaque jour, ils vous verraient crêver avant de vous saluer. Si vous ne me croyez pas, observez l'attention que l'on prête à la machine dans sa main par rapport à la personne en face de soi. Il est souvent plus sage de conseiller l'usage du téléphoner plutôt que de parler à la personne à vos côtés, si vous voulez vraiment qu'elle vous prête attention. C'est la société du « pas ici, pas maintenant », souvent avec une observation oblique du genre que vous auriez quand même pu noter qu'on est super-occupé au téléphone, à l'ordinateur. Cela se passe au niveau local parce que tout est local. Les gens se retirent parce qu'ils n'ont qu'à se retirer, face à ces indignités.
Mais observons ce qui se passe dans un cadre où les gens marchent ensemble, cueillissent ensemble, transforment, cuisinent et mangent ensemble. On peut observer que la rélocalisation des rapports va de soi. Le fonctionnaire, responsable de la logistique, se trouve, à ce moment-là, face au besoin d'organiser le système d'approvisionnement de ceux qui sont là avec lui, et pas derrière le vitre – un tel peut récupérer telle denrée là-bas - au passage chez lui, un autre se propose pour prendre une commande de pièces nécessaires pour l'atelier vélo qui opère sur place, un autre peut se pointer dans l'équipe qui est actuellement en train de couper les patates, il y a le déplacement des stocks pour la prochaine étape à organiser, pour les mettre dans le lieu de stockage proposé par la mairie, etc.
Tenez, un boulot utile pour un fonctionnaire à ce moment-là serait d'engager les assureurs afin de légitimer l'utilisation de non-fonctionnaires pour, par exemple, "couper les patates", sans poursuite judiciaire. On n'a qu'à se décider – est-ce qu'on veut re-situer nos actes chez nous ou est-ce qu'on veut passer un temps sans fin à parler autour d'une table virtuelle sur la dé-virtualisation, tout cela subventionné par la dette croissante nationale, faite sur le dos des pauvres qui malgré leurs instincts, sont bien obligés de faucher de la forêt vierge pour nous fournir nos aliments de base que nous ne savons plus produire sans polluer la terre - chez nous en plus ?
Ces expressions d'exaspération viennent du fait que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on a déjà compris, de manière abstraite, la racine de nos problèmes, mais on continue de faire les choses qui nous mènent au désastre, les décisionnaires en premier. Les bacs + 5 qui ont déjà compris n'ont d'autre solution à proposer, paraît-il, que de continuer de parler de tout et de rien, en cercle fermée. Ils ont oublié qu'on ne sait vraiment pas où ils vont avec tout ça. Les gens se trouvent démunis, conditionnés à appuyer sur la manivelle qui les donne des subventions. Au moins les machines ne savent pas exprimer leur condescendance, et l'argent à la main, il parle sans mot dire.
Si les gens au pouvoir ne savent plus parler qu'aux gens comme eux, c'est à cause de cette situation d'impuissance d'autonomie des gens plus sains d'esprit qui n'envisagent pas de s'embrigader dans des parcours qui n'affûtent que leur capacité de « parler ordinateur ». Ce n'est même pas la peine de parler si on n'est pas payé pour – encore moins de penser. On pense pour nous, nous n'avons plus à penser pour nous-mêmes. Les écologistes administrateurs ne sont pas les derniers venus à cette table de l'inaction collective, pour eux la nature est ce qu'ils visitent pour l'admirer – une réserve ou on ne rencontre que des touristes venus en voiture - ou bien le petit jardin qu'ils nourrissent comme passe-temps pour se donner bonne conscience, ou le vélo qu'ils utilisent pour aller au travail - ou à l'aéroport. Le gros de leur vie et de leur revenus se produit grâce au téléphone, à la visioconférence, à l'intérieur dans des milieux chauffés, climatisés, en train de lire et de remplir des liasses de papier virtuel.
Et si on appliquait la même attention et effort à notre engagement avec le monde physique du vivant ? Moi, par exemple, j ne serais pas en train d'écrire sur ordinateur, sinon de parler avec les gens – et de parler des actes concrets immédiats que nous sommes en train de mettre en œuvre. Mais je ne veux vraiment pas parler de l'heuristique des fines distinctions ontologiques qui méritent une analyse repoussée! Vous m'en excuserez.
Lorsqu'il y a les rares « remontées du terrain » des « acteurs » engagés dans le faire, ceux qui assument les responsabilités de plus grande envergure cherchent, comme la main d'œuvre sur un chantier, à approvisionner ceux qui font le travail. Ils ne sont plus les chefs, mais les facilitateurs, réactifs fonctionnellement aux besoins matériels des gens qui font, représentatifs de leurs besoins dans leurs propres collaborations avec d'autres coordinateurs. Mais si plus que la bonne moitié de la population n'y est pas engagée, cela ne fait pas l'affaire, cela fait juste quelques affairés.
L'une des choses que les écologistes oublient de mentionner souvent, c'est que le vrai travail écologique a besoin d'énormément de main d'œuvre humain, qu'il n'y a même pas de machines qui peuvent le faire. Prenons un exemple. L'existence de clôtures électriques partout, qui remplacent les haies – foyers essentiels de biodiversité, ne vient pas de nulle part. Entretenir une haie qui ne produit absolument rien directement pour l'être humain concerné coûte en plus énormément d'heures de travail, de travail dans le détail, du travail intelligent. Ah, le joli bocage ! Oui, mais les touristes, qu'est-ce qu'ils donnent à celui qui l'a fait, le travail ? La nature, pour la plupart d'entre eux, c'est ce qui se fait soi-même, comme par miracle. C'est gratos, ou cela devait l'être, pensent-ils.
L'emploi sur les bords de route est une source massive d'emploi de ceux qu'on appelle des en voie d'« insertion sociale » – ou des « TIGistes ». Je suis poli. Ils ont d'autres noms aussi. Mais l'entretien de haies a besoin d'un travail intelligent – savoir plier les arbres, créer de la densité, favoriser certains mélanges d'essences et beaucoup plus. Tandis que les entreprises qui prennent les TIGistes utilisent des débroussailleuses, des tronçonneuses et des camionnettes pour dévaster des milliers de kilomètres de haie chaque année. Leur manque de savoir faire convertit une opération qui pourrait être d'énorme intérêt écologique en opération hyper-consommatrice d'énergie qui continue d'inculquer des valeurs complètement industrielles sur toute une génération d'ouvriers sans formation.
Tout comme dans la proposition d'emploi massif des restaurateurs écolos, pour rétablir les liens fonctionnels humains d'une société – il y a la réserve qu'il faut qu'il y ait une sensibilité écologique qui conditionne ce processus, il est nécessaire d'aborder la question de la réhabilitation des haies avec circonspection. Tenez, on pourrait même en faire un ministère, juste pour les bords de route, tellement le problème il est vaste, à lui seul! Le ministère des bords de route. Ceux qui sont actuellement en place dans le métier ont des valeurs actives totalement à l'antithèse de l'écologie. Ils ne dépendent pas du tout de la production de biodiversité pour leur pain quotidien, sinon de la mise-à-ras de kilomètres linéaires de végétation. Là où ils sont passés, les adventices les mieux adaptées, les ronces, le balsam d'himalaya, les orties, etc. poussent en profusion, les assurant d'encore plus de travail énergivore dans les courtes années à venir. Ce n'est qu'en ville – là où les clôtures électriques rencontreraient quelques résistances humaines et pas seulement bovines - qu'on commence tout juste à aborder sérieusement la question de la bio-diversité aux bords des routes.
Une manière de considérer la conversion écologique de ce métier serait le suivant. D'abord et avant tout de faire que les équipes qui intègrent ce travail aient des formations préalables ou sur le champs sur la biodiversité, la frugalité énergique, l'utilisation d'outils manuels. Deuxio, qu'ils visent vivre des ressources alimentaires et autres créées aux bords des routes et des chemins qu'ils entretiennent – cela les recentre sur l'intérêt de ce qui s'y trouve. C'est-à-dire le lourd boulot de la détection, de la protection et de la sélection de noyers, châtaigners, cerisiers, aubépines, noisetiers, prunelliers, etc. qui y poussent déjà mais qui sont actuellement fauchés à répétition. Et on fait ceci au bord des centaines de milliers et des millions de kilomètres de route et de chemin, à présent abandonnés à la voiture - l'instrument même de notre déroute climatique. Pour ensuite cueillir, transformer et réaliser la valeur de leurs fruits - et de leurs bois – sans les brûler et sans en faire des palettes. Ce n'est pas un mince défi. La pollution des bords de route est énorme, tant en métaux lourds qu‘en poussière de particules fines également nocives qui se collectent dans le feuillage. Oui c'est un problème. Mais on ne peut pas nier qu'il y a déjà la forme d'une solution, dans les gens qui sont déjà là, déjà financés par l'état.
Est-ce qu'on est vraiment sérieux, je me demande, lorsqu'on parle de la transition écologique, assis sur son banc dans le train qui mène à Strasbourg, en train d'écrire les solutions écologiques de demain, toujours demain ? Le fait de s'engager avec la pollution existante, là où elle est la plus concentrée, là où l'être humain, il passe, n'est-ce pas « une preuve d'amour » ? La SNCF commet des atrocités dans ce sens aussi, l'élagage des bords de chemin de fer continue, mais sur les bords de route la mode est d'élargir le trait toujours plus, la stratégie maintenant est d'éliminer les arbres surplombants, si possible à dix mètres de chaque côté de la route (pour que les voitures « voient » le paysage). Cela donne beaucoup de boulot et de bois pour les machines des TIGistes. Le travail de l'homme est réduit à la destruction de toute végétation qui dépasse 10 centimètres du sol – il est impossible, avec la débroussailleuse, de faire autrement. Il y a un manque de culture et de savoir faire tellement grossiers dans les normes de cette profession que ce n'est même pas la peine d'en parler avec eux. Qui, de sincèrement écologique, ferait ce métier, sans de réels besoins d'emploi ? Pour les « CDIs », la crème de la profession, la rentabilisation de l'investissement énorme dans les tracteurs faucheurs qui réduisent la dépendance sur la main d'œuvre est ce qui compte. Ce sont ceux qui dépendent directement du pouvoir public centralisé - que ce soit de la communauté de communes, des conseils généraux ou régionaux. La plupart des conversations tournent autours de l'entretien des machines et l'existence des subventions – tandis qu'à plus basse échelle, il n'est pas facile d'entrer en contact avec la nature lorsqu'on passe des heures entières enveloppé de vêtements de sécurité en fluo avec des casques protecteurs et une machine tellement bruyante qu'elle coupe tout contact avec cette nature - et avec ses camarades de travail.
Si les élagueurs étaient employés à plier les haies, il n'y aurait guère de problème avec des arbres surplombants. Si le cœur de métier était écologique, les particuliers, au lieu de suivre les normes de l'agriculture à taille de tracteur ou de débroussailleuse (ce n'est pas vraiment la taille qu'ils pratiquent, mais plutôt l'arrachage ou la pulverisation), sauraient créer des jardins détaillés, biodivers, qui ne consistent pas seulement en pelouse débroussaillée, deux ou trois arbres parsemés au milieu et un lopin de terre avec quelques oignons et des patates, cassé chaque année au motoculteur. Ce sont en plus des techniques totalement dépassées par les connaissances actuelles en la matière – où est donc la transmission de savoir ?
La tradition et la fierté, pour les cheminots d'antan, s'étalait devant les voyageurs, dans les jardins au bord des rails de chaque petite gare et maison. C'était de la publicité gratuite pour le savoir faire rural "fait main". C'était des jardins, pas des « exploitations » à but lucratif - ceci dit ils étaient plusieurs fois plus productifs par mètre carré que n'importe quelle entreprise industrielle agricole aujord'hui, et ceci sans subvention – au contraire c'est parce que les cheminots n'étaient pas royalement payés qu'ils s'investissaient autant dans le jardinage.
Si les « décideurs » au niveau national et européen ne savent pas mettre des écologistes qui savent cultiver sur le terrain, pour expliquer les nouvelles normes par les actes, comment veulent ils qu'on les croie ? Avec leurs téléphones et leurs ordinateurs portables, ils pourraient même donner l'exemple, en y allant eux-mêmes, en collectif. Cela ferait "événement". Les élites des milieux ruraux sont actuellement totalement dominées par des pratiquants de la « science » du productivisme industriel. L'argent public ne cesse de les raffermir dans leur dogmatisme. Est-ce que les politiciens écologistes osent montrer le contre-exemple ? Ils n'ont rien à perdre, on ne vote pas écologiste en campagne – il faut être riche pour y trouver sa place et la seule manière de remédier à cette situation électorale, c'est de rendre possible un repeuplement écologique, également de gens de classe populaire, susceptibles de ne pas voter à l'extrême ou au « centre » droite et de bien vouloir travailler pour créer une campagne à la taille de leurs rèves.
Mais dans la vie réelle, tout comme en Angleterre, ceux qui ont tendance à repeupler la campagne dans les conditions actuelles sont plutôt des libéraux riches et donnés à l'entre-soi, des gens de la gauche caviar qui a échouée, ces longues années, à faire épanouir l'écologie de masse, justement parce qu'ils pensent surtout à leurs propres libertés et pas à celles des autres, au moins en ce qui concerne leurs préférences électorales et leurs vies privées réelles. Il y a même pire, les plus « écologistes » sont ceux qui font le plus la navette entre leurs boulots « socialement validés » ailleurs et leurs « petits paradis perdus » à la campagne. Ils ont tous des voitures, identifiez l'erreur. Tout comme les députés qui vivent entre Paris, Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles … et les arrière-pays et les arrières-villes où ils ont étés parachutés pour se faire élire. Il faut avoir une très grosse tête pour penser qu'on peut sortir indemne d'une telle programmation sociale, soi-même, par auto-persuasion. Il est évident que dans ce cas, on se sent bien obligé de travailler avec et à travers les élites locales qui ont les réseaux de contacts qu'on ne peut pas entretenir et qu'on apprend, à force, l'impossibilité de l'engagement social sur la plupart de la surface du métropole.
Si, en ville, il y a plus d'espoir, (on y vie, on y travaille et au moins dans sa tête sociale c'est un endroit familier) il est logique de penser à réinvestir la campagne à partir des villes, de rentrer en contact direct avec la nature plutôt que d'y ériger des réserves qui la dépeuplent encore plus. On ne peut pas séparer humain et nature, c'est (presque) tout ce qui nous reste!
lundi 1 mars 2021
Petit Robert 1977
heuristique (1859 : du grec heuriskein « trouver »). Didact. Adjectif : qui sert à la découverte. Nom féminin : partie de la science qui a pour objet la découverte des faits.
heur (heûr et aür vers 1160 ; latin agurium, augurium « présage »). vx. Bonne fortune
Dans la section « abréviations »
didact. - didactique : mot ou emploi qui n’existe que dans la langue savante (livres d’étude, etc.) et non dans la langue parlée ordinaire
vx. - vieux (mot, sens ou emploi de l’ancienne langue, incompréhensible ou peu compréhensible de nos jours et jamais employé, sauf par effet de style : archaïsme).
Sérendipité : tentons ma définition : «par heureuse chance, le fait de tomber sur quelque chose ou quelque compréhension (appréhension)
Définition wiktionnaire : Fait de faire une découverte par hasard et par sagacité alors que l’on cherchait autre chose.
L’origine est « Serendip » un nom pour le Ceylan, 8ième siècle.
Il y a « de bon augure » aussi, évidemment. La chance de tomber sur quelque chose, comme cette piste de sens dans les dictionnaires, est multipliée par le fait de bouger, de croiser des choses sur son chemin, des choses peu-pré-choisies par d’autres, de manière « autonome ».
Je suis en train de lire des livres assez difficiles à avaler. L’Intelligence Collective (Joseph Henrich, de Harvard, 2016) et Quelles sciences pour le monde à venir ? par le Conseil Scientifique de la Fondation Nicholas Hulot, octobre 2020.
Par rapport à la catastrophe écologique en cours, le sujet est « pourquoi est-ce que l’on n’arrive pas à agir en fonction et à la mesure du problème ? » La même question se pose sur l'épidémie de la Covid, qui se présente comme une facette du problème majeure, de manière claire et éducative.
Deux facteurs se révèlent pertinents. Dans les faits, la population des pays riches ou qui risquent de le devenir est massivement hostile. Même si elle en fait des mauvaises rêves oraculaires chaque nuit du confinement, cette population fait beaucoup pour ne pas basculer dans un autre monde écologique. Les solutions qu'on nous propose font avec cette réalité humaine plus qu'avec cette réalité physique envers laquelle on avance, inexorablement. Les solutions plus "brise-modèle" sont encore "tabous". En quelque sorte nous creusons vigoureusement le trou dans lequel nous voulons enfoncer nos têtes d'autruche. On ne peut pas dire (pense-t-on) ni faire ce qu’il faut pour s'en sortir – toujours à cause des autres - même si on ne le fait pas soi-même, par "pragmatisme" et avec résignation (comme "The Walrus and the Carpenter", Lewis Carrol). Il y a besoin de persuasion, pas d’autoritarisme, dit-on.
La teneur des discussions des experts et des portes-paroles à la média est de dire qu’il y a des méchants (multinationales, super-riches, néo-libéraux) qui cassent les pieds de ceux qui veulent faire le bien et que la société est trop égoïste et conservatrice pour accepter les mesures nécessaires (identifiez le non-dit). Des attaques frontales sur la mode de vie de la majorité (donner honte) ne sont pas tolérées et sont supposément contra-productives. Il s'agit sans doute de la honte quand même (salut Greta).
Ces dires non-dits masquent la non-réussite des stratégies "soft power" – et cela depuis des années – tandis que la législation qui est passée nous lie pieds et poings dès que nous tentons des expériences sociales écologiques de petite ou de grande envergure. Sinon, elle tente de les casser. L'état a tendance à produire la précarité. En tous cas, merci m. Sarkozy, pour avoir fait des conneries assez grosses pour être puni [à voir, ne meurs pas avant comme Chirac]. Au pire, on a mis a dos un assez gros segment de la population pour qu'elle soutienne des vraies initiatives écologiques, le temps venu.
La Fondation Nicholas Hulot, ou ses scientifiques au moins, reconnaissent que pour être convaincants ceux qui proposent des solutions doivent les mettre en pratique eux-mêmes – c’est le moins qu’un scientifique puisse faire, d’ailleurs, sinon il n’a ni expérience, ni preuves. Elle reconnaît aussi que c’est notre culture même qui doit changer, être réinventée. Comme ils ne pratiquent pas eux-mêmes des modes de vie radicalement différentes, ils ne proposent pas des modes de vie radicalement différentes (oui, je sais que c’est incohérent, mais c'est comme ça).
Dans la pratique, donc, la fondation ne soutient pas des pratiques et des projets pilotes de société nouvelle sinon se redéfinit comme fin analyste qui ne fait rien. Elle ne propose pas de solutions radicalement différentes et ceux qui l’intègrent ne proposent que des changements quantitatives – sous l’étiquette « développement durable » qui ne s’adressent guère qu’au problème du climat, alors que le problème de l’extinction du vivant, dont nous, crée le problème du réchauffement climatique, plutôt que d’en résulter (attention : cause suivie d’effet).
Pour donner un exemple du cadre de pensée « scientiste » des sciences dures qui régit sur l’analyse (malgré les protestations du contraire et à l’instar de l’analyse des marchands de confusion critiqués dans l’œuvre), la démographie, qui est le résultat de nos choix sociaux, est l’un des problèmes matériels absolument critiques à résoudre. Est-ce que c’est dans le domaine de la science ? Mais bien sûr ! Le sujet le plus non-traité dans l’œuvre : « combien de morts humains, à quelle échéance et comment ? »
Sommaire : la discrimination sociale est transsectionnelle – elle ne peut qu’induire des boucles de retro-action. Si la population cesse d’être socialement mobile, comme dans le cas du confinement Covid et de l’utilisation des technologies qui nous détournent de la place publique (voitures, portables, etc.), elle perd rapidement sa compétence sociale collective et se replie sur des cercles réduits. C’est déjà le cas à la campagne, où il n’est plus possible de vivre en tant qu’être humain sans voiture, portable, argent (au diable les droits de l'humain sans prothèse), à moins d’être le dépendant de quelqu’un de riche (fonctionnaire, cadre d'entreprise zombie) ou de l’état (agriculteur). Les services publiques fonctionnent avec beaucoup de peine, moyennant l’emploi des dites technologies. La société bulle se raffermit.
- Dans un banlieue principalement noire d'origine antillaise en R.U., tous les magasins sont tenus par des personnes d’origine musulmane pakistanaise.
- Un petit enfant allemand a tendance à être réceptif aux enseignements qui viennent de personnes qui parlent sa langue maternelle, voire son dialecte, son accent. Il est punitif envers les transgresseurs du code de son groupe social et tolérant envers les faux pas des étrangers (Intelligence Collective, œuvre citée). (Un petit enfant anglais a plutôt tendance à l’envers, ...)
- Dans les stations scientifiques de l’Antarctique, le mélange de personnel est international, ce qui est plutôt bien toléré, même stimulant, selon témoin.
Cet exemple illustre les contradictions implicites dans l’analyse de Henrich (Intelligence Collective). Si l'on peut se sentir sécurisé par des gens qui parlent sa langue, avec son accent, on peut aussi se sentir insécurisé. Cela dépend des expériences vécues. Si le passage de memes (« gènes » culturelles : "mimétiques") est plus assuré, plus rapide et plus généralisé, plus le groupe d‘individus qui se communique est grand et varié (comme il le dit), à quoi bon extrapoler des théories basées sur des études des petites communautés isolées ou des enfants ? Déjà il y a des questions de spécialisation "relais" ou intermédiaire culturel (exemple: interprète) qui s'interposent.
La non-familiarité, le plaisir de la découverte, ces facteurs peuvent être des facteurs d’attirance. L’innovation, la curiosité, la singularité, n’est-pas de cela qu’on parle, lorsqu’on parle de l’intelligence collective comme phénomène évolutionnaire ? Il est plus difficile de mentir que d’être sincère, Henrich déduit des expériences citées dans le livre et des études du cerveau. Mais justement, ce sont les anomalies, les innovations, les néologismes qui font signe d’alerte et qui provoquent l’intérêt ! Certaines nations ont tendance à raconter l’histoire du progrès en n’utilisant que des exemples qui viennent de leurs propres pays. D’autres citent les vrais inventeurs. Lesquels de ces pays sont les plus ouverts aux découvertes ? Si on compare l’anglais au français, prenons le mot « banane » comme exemple ; c’est « banana » en anglais – on n’est pas obligé, en Angleterre, d’angliciser chaque mot – si on l’écrit de travers, c’est souvent parce qu’on a du mal à le prononcer, pas parce qu’on cherche à le faire « sien ». On est curieux de la provenance, on n’essaie pas de l’assimiler à chaque reprise.
En tournant au livre de la Fondation Nicholas Hulot, je cite une phrase (p.214) où on parle de l'attitude des scientifiques en France envers le public. « Plutôt que d’instaurer un dialogue avec lui, l’enjeu est d’éduquer ce public indifférencié et passif en « vulgarisant » les connaissances scientifiques. » Et comment ! En 2002-3 j’ai assisté à une conférence de la CNRS à l’université Lyon II sur le sujet des bars de la science ». J’étais invité en tant que représentant de « Café Scientifique » - une initiative totalement indépendante anglaise qui visait la « mise en cause » de la science dans une atmosphère informelle, en partie calquée sur notre imaginaire des « cafés philos » de la rive gauche à Paris dans les années 1960-70. Les conférenciers français, tous des professionnels des sciences dures (Physique) financés par l’état, parlaient de « la vulgarisation de la science ». Je les écoutais avec un étonnement grandissant. Avec le mot "vulgaire" c'était déjà très mal parti. Ils ne voulaient absolument pas écouter ce que j’aurais eu à dire là-dessus, bien sûr.
Et on ne peut pas dire que l’Angleterre n’a pas de culture scientifique. Dans notre café, qui ne cessait de produire des rejetons partout, nous avions toute sorte de scientifique célèbre qui voulait passer pour parler avec des gens intéressés par la science, des gens aux frontières de la science comme passion plus que métier. Les bars de science en France galéraient, malgré leurs subventions – ce qui ne me paraissait pas étonnant si leur objectif était d’expliquer, de manière condescendante, ce qu'était la science, sans écouter personne. Nous non – même pas du tout, même pas les scientifiques – c’étaient souvent des lanceurs d’alerte qui avaient des graves préoccupations sur certaines questions. Ils voulaient comprendre et être compris, en général. Par exemple, des gens qui étaient en train de découvrir que l’énorme univers de l’ADN « junk » n’était pas « junk » ou qui mettaient en cause les effets du Prozac (c'est comme le Ritalin) sur certaines populations.
Quand je lis le livre des scientifiques de la Fondation Nicholas Hulot, … comment dire, ... je vois que cela n'a guère changé. La tour d’ivoire, le mépris de classe, tout est là encore. Il n’est pas suffisant, dans la conjoncture actuelle, d’attendre que le modèle s’effondre – il faut s’allier avec des confrères et sœurs pour représenter un vrai pôle d’expression des scientifiques et de non-scientifiques innovants – et peut-être tout simplement casser – oui « casser » le pouvoir monolithique de la CNRS. Surtout faire que les bio-sciences, les sciences humaines et les expériences d'immersion fassent partie intégrante de cette « Broad Church », cela devient juste … absurde de ne pas comprendre cela. Si on ne fait pas attention, on va constater, après coup, que la seule science innovante est en train d'être pratiquée par des "profanes".
Dans les circonstances du confinement et du couvre-feu, c’est la libre-association physique qui est réprimable, alors que la solidarité collective devient très importante. La virtualisation de la communication assez directe qui s'y substitue commence à faire substance. Malgré cette aubaine, on cesse de parler du sort des laissés pour compte, se concentrant surtout sur des grands groupes faciles à identifier et institutionnellement encadrés – enfants à l’école, vieux en EHPAD, étudiants à l’université, … en fait le journalisme ne sait pas accommoder les individus sauf en termes de représentants de l’un ou de l’autre des groupes cibles, sa volupté de catégorisation chiffrée induisant une adaptation à ce conformisme-là. C’est pour dire, la média et les sciences sociales ont tendance à inventer la réalité des discriminations par groupe - il y a les a-groupaux aussi, vous savez? Il est difficile ensuite de dire qu’il y a des lobbies … il n’y en auraient pas si on ne les confectionnait pas, conceptuellement, à tout va.
Dans la première et la deuxième guerres mondiales, l’unité (le patriotisme) et l’esprit de corps ont été des valeurs exaltées. Il reste que les lanceurs de la Résistance en France ne venaient pas de la société en général, sinon des groupes ciblés et persécutés par les Nazis et les forces de la France occupée – juifs, communistes et syndicalistes pour la plupart. Cela a pris deux ans pour s’élargir aux « français de souche ». Qui encaisse? Qui résiste?
A la fin de la première guerre mondiale, avec ce grand brassage de gens en transit et de retour de partout sur la planète, la grippe dite « espagnole » a tué presque autant de monde que la guerre elle-même. Dans la deuxième guerre mondiale, la santé physique et mentale de la population britannique a sensiblement amélioré – à cause des « privations » et du niveau d'engagement physique nécessaires, si l’on veut, un genre de corticoïdité générale. Suite à la première et à la deuxième guerres mondiales, des institutions inclusives visant la paix et la coopération mondiales ont été créées, basées sur des concepts de droits et de dignités humains absolus, sans distinctions de race, de religion, etc. L’accélération du développement des mises en œuvre des idées est démontrée par les missions lunaires, le savoir-faire de la solidarité induit par « la guerre » a continué d’atteindre des pics de progrès dans les décennies après sa fin.
Je commente le livre L’Intelligence Collective (œuvre citée, publié en 2016) parce que les idées qu’il contient peuvent avoir une forte influence sur l’opinion des preneurs de décisions dans des positions de pouvoir politique et sociale, pour le bien et pour le mal.
Dans l'ordre, bien sûr, étant donné que je viens de le commenter, indirectement! Le livre prend des exemples de ce que font des petits enfants et des petites tribus non-civilisées pour illustrer sa thèse, que les êtres humains ne sont pas plus intelligents au niveau du raisonnement pur que d’autres animaux, individuellement, mais qu’ils ont des spécificités, distinctes des autres animaux, qui font qu’ils vont enregistrer, reproduire et appliquer des normes sociales, même contre la raison apparente. C’est leur mimétisme, leur soumission sociale (domestication) qui est leur qualité distinctive, au dépens de leur intelligence, supposément. Le « prestige » est séparé de « la dominance » - c’est-à-dire, le statut social d’un individu dépendra plus de son taux de popularité et intégration sociale que de sa « dominance » physique, ce qui fera qu’on le suivra (et ses opinions) même si rationnellement on pourrait savoir qu’elles ne sont pas fondées. Par exemple, on va suivre tous les pas d'une rite ou une danse, sans discriminer celles qui sont vraiment adressées à une fin identifiable - au contraire des chimpanzés.
L’hypothèse qui sous-tend la thèse est que les êtres humains ont commencé leur évolution dans des groupes relativement petits ou dans des organigrammes tribales composées de petits groupes. Pour parvenir à une gestion de grandes populations, on a commencé donc avec les outils affûtés à l’usage de petites populations, entre eux et en lien direct personnel. Cette « domestication » culturelle a forcé l’évolution de nos cerveaux dans un sens social, plutôt que dans le sens que nous soyons individuellement plus « performants » vis-à-vis nos concurrents humains, sauf dans le secteur de l’« obéissance » (soumission) à des règles d’association sociale. L’importance de la thèse dans le contexte présent est qu’elle a tendance à miner notre confiance dans notre capacité à résoudre nos problèmes collectifs de manière bien raisonnée, donnant plutôt des outils aux manipulateurs de l’opinion, générant la confusion et le syndrome de la post-vérité. Ce thème est courant dans le monde scientifique. Il peut normaliser l’expectation de malhonnêteté. Henrich paraît démontrer que les humains ont cependant plutôt tendance à être honnêtes, ce qui est moins coûteux cognitivement et socialement, mais que cette "honnêteté" se détermine par référence aux normes socio-culturelles plutôt que par rapport à la vérité concrète. Exemple qui me vient à l'esprit - l'ordalie (époque dite 'féodale').
Il se peut que la thèse, comme celles de Freud, a ses mérites mais qu’elle est mal-barrée dans sa spécificité, faute de connaissances étoffées et pointues. Il peut très bien continuer de coexister des trait parallèles et complémentaires dans le sein d’une même population. Il peut d’ailleurs se développer des conventions « antidotes » plus puissantes que l’obéissance aveugle aux conventions fafolles – c’est ce que j’essaie de démontrer plus haut. Le conformisme culturel est un outil de sélection évolutionnaire puissant, mais à double tranchant. Il n’y a pas grand-chose qui interdit l’idée de la massification des populations humaines dans le lointain passé, non plus, qu’ils soient nomades ou sédentaires, ce qui rend moins plausible l’idée que l’on peut prouver des traits culturels déterminants « innées » en observant des cultures « vierges » de taille mineure. Comment en extrapoler des caractéristiques culturelles universelles de ces dénominateurs communs à l’échelle individuelle, ce ne sont que des analogies ? Il y a surtout une sous-estimation « méprisante » de l’intelligence adaptative dans des cultures diverses – par exemple pour une culture très nomade, la pauvreté en biens est une richesse en mobilité adaptative – pour les animaux cette richesse interactive avec l’environnement « crée » l’intelligence qui manque souvent aux sédentaires sociaux.
En partie mes critiques sont logiqement injustes - Joseph Henrich tente de montrer que les mécanismes de l'évolution culturelle existent, que c'est ces mécanismes qui travaillent notre évolution génétique et notre biologie, plus qu'on a voulu l'admettre. Soit. Cela peut rajouter de la rigueur explicative. Il peut aussi limiter notre confiance collective dans nos capacités autonomes, comme rouages dans cette machine sociale infernale et aveugle, dominée par des résultats chiffrés. Il me semble, cependant, que cette approche "numérique" vient avec notre jouissance dans le monde des statistiques computationnelles - c'est tout frais, c'est une mode. La démocratie représentative est également sous la régie de simples chiffres, en apparence. Ce n'est cependant qu'une angle sur la réalité du monde.
Dans une publication sur les meutes de chiens et le danger qu'ils représentent, le conseil est donné qu'ils n'attaqueront jamais deux personnes - c'est déjà une "meute" humaine pour eux. Dans la plupart des mouvements sociaux, il suffit souvent de deux ou trois personnes résolues au début pour lancer un effet "boule de neige". Dans la "science" de la gestion, on conseille de faire travailler en groupes de 5 à 8 personnes. En dessous, on est trop exposé à la perte d'individus clés à l'entreprise. Au-dessus, cela devient compliqué de gérer l'ensemble san frais administratives trop lourdes. Il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles les animaux n'ont pas intégré la capacité de compter dans leur "boîte à outils" cogntif. Pour utiliser un outil cognitif, il faut déjà que cela éclaire plutôt que d'obscurcir l'analyse d'une situation agissante.
L’idée qu’il y a des catégories du vivant sociales et des catégories non-sociales est questionnable. Plusieurs espèces peuvent basculer d’un état à l’autre, dans toutes les catégories, selon le cadre. La reproduction et la prédation sont des actes sociaux communs à tous les mortels, parfois en fin de vie (pieuvres, araignées).
Les criquets et les flamants roses peuvent former des vastes communautés, sans être équipés des traits culturels humains. Les invasions des hordes nomades mongoles (Genghis Khan), en Chine ou en Europe, ont déployé des masses d’êtres humains et trouvent une origine dans les pulsations démographiques dans les steppes de l’Asie Centrale, décalées de quelques années suite à des « bonnes années » de pâturage. Les plus anciennes civilisations en partie sédentaires, comme celle de l’Égypte, ont su employer des masses de main d’œuvre à bon escient. C’est-à-dire, la capacité de former et de stabiliser des cités et des citadins, des armées et des caravanes, n’est pas un bon indicateur du progrès évolutionnaire, que ce soit une coévolution culturelle et génétique ou une évolution purement génétique, mais un produit constant de circonstances conjoncturelles, depuis qu’on sait se déplacer, même si les liens individuels dans un groupe peuvent bénéficier d’une mémoire plus grande qui permet de situer plus d’individus et de classes d’individu.
Ce type de mémoire peut également s’employer, comme dans le cas de l’orang-outan ou de l’éléphant, pour mémoriser des territoires, des calendriers saisonniers et des sources d’approvisionnement. Le raisonnement qui mène Henrich à supposer qu’il y a une « évolution culturelle » de l’intelligence collective a un défaut – nous ne paraissons pas en avoir beaucoup, d'intelligence collective culturelle - elle prend facilement des dérives. Les questions "comment?" de la science peuvent trouver des réponses à menu sans que les liens de causalité de l'ensemble soient ainsi décrites - un cancer humain est une désordonnance de la cohérence d'une vie humaine - est-ce la même matière? L'heuristique de l'intelligence collective n'est pas juste une série de mécanismes fortuits statistiques. Le "corpus de savoirs faire" auquel tient Henrich pour étayer sa thèse est éternellement réinventé, mutant. Le plus apte, évolutionnairement parlant, peut ête celui qui a un cerveau moins développé - cela paraît être le cas avec tout animal domestique par rapport à sa version "sauvage". Le "nous" domestiqué, est-ce qu'il a éliminé les nous plus intellectuellement développé sauvage ?
L’une des choses qui peut enflammer le plus, des américains, est « si tu veux réussir comme moi, fais comme moi – regardes, je suis riche et [béatement] heureux » (la chanson "I'm the King of the Jungle", dans le film du Jungle Book par Rudyard Kipling, version Walt Disney, exprime bien ce sentiment). Oui, au dépens du reste du monde, en singeant la méthode coloniale anglaise. Il me semble que mon point de vue est devenu un peu daté et que les américains sont en train de mûrir suffisamment pour reconnaître leurs erreurs – je l’espère, il y a beaucoup à défaire.
L’intelligence collective « civilisée », par contre, peut très bien s’approcher d’une évolution culturelle plus que génétique, si elle réussit à réconcilier les divers intérêts « écologiques » de ceux qui co-occupent l’écosystème, plutôt que de tenter de le remplacer. Tout le monde est d’accord qu’il existe plusieurs variantes de culture qui fonctionnent de manière relativement stable, au moins jusqu’au rencontre avec d’autres civilisations. Le nomadisme peut succéder au sédentarisme agropastoral, si un écosystème excède ses limites, parce qu’il permet de vivre à moindre consommation de ressources et à moindre essor démographique. L’interaction nomade-sédentaire réussie est une signe de sagesse culturelle, à cet égard, puisqu’il est incroyablement difficile à réussir.
Les cultures de conquête et de colonisation, par contre, n’ont pas marché, écologiquement, puisqu’elles ont eu tendance à dépasser rapidement la capacité de leurs propres écosystèmes et celles des autres ensuite, enchaînant les « défaites » écologiques en série. Autant l’aspect désertique de l’ouest de la Grèce qu’une grande partie du sud-est de l’Espagne et de l’Afrique du Nord mettent en évidence les effets du surpâturage des chèvres, aujourd’hui encore. Ces effets délétères au sols du colonialisme grecque, phénicien et autres datent souvent d’il y a plus de 2500 ans (récits de Platon). De dire que le colonialisme a marché parce qu’il a dominé, éliminé ou culturellement assimilé les concurrents est de la pure fiction. Sa propagande a marché, ça oui. Les grands dinosaures qui ont « dominé » la terre ne sont plus là et ce sont les virus, les maladies et les épuisements d’écosystème autant que les guerres qui ont vaincu le plus les êtres humains, jusqu’à effacer leurs traces et leurs histoires.
Les idées reçues de l’intelligentsia, de l’élite, sont très conditionnées par leur propre environnement et modes. Par exemple, en lisant cette œuvre du chef du département de "Biologie évolutive Humaine" à Harvard (faux pas que je dise "ethnobiologie"), je suis frappé par ses interprétations inconsciemment biaisées par des valeurs culturelles américaines et allemandes, tout comme je le le suis en France. Il définit la rationalité de l’intéressement personnel par le « toujours plus » monétaire et matériel, comme Nicholas Sarkozy en avait l’habitude lorsqu’il était au pouvoir. Un nomade n’a aucun intérêt à porter beaucoup, il ne fait pas la même erreur. Les allemands et les néerlandais font des expériences par rapport au conformisme général, ce qui ne cesse d’amuser les anglais. Les enfants américains et allemands s’allient toujours à ceux qui ont le plus de proximité linguistique, ou qui sont du même sexe, etc., ce qui laisse à penser que même s’ils deviennent « anti-racistes », personne ne les aura fait vraiment croire que la catégorisation des gens de cette manière soit à questionner ...
Les britanniques sont des raisonneurs souvent non-hiérarchiques et fraternels, par rapport aux cultures mentionnées. Le non-conformisme est institutionnalisé et représente au moins 6 millions de personnes dans une population de c.65 millions, avec une influence disproportionnée. L’arrivée du non-conformisme est bien sûr le résultat d’un excès de conformisme, mais notons que ce n’est pas l’anti-conformisme, sinon une accommodation de la réalité du vivre ensemble. Cela veut dire baisser les yeux, plutôt que lancer un défi, par exemple, refuser de s’engager ou se retirer au lieu de contre-attaquer. L’idée d’un rapport de force n’est pas très bien compris en Angleterre – si cela en vient à un rapport de force, c’est qu’on a déjà perdu la raison, normalement. Les rapports de raison et non pas de force sont définitivement préférables.
On peut me critiquer pour ma manière autoritaire de « dire » le caractère anglais, mais je ne cherche qu’à démontrer que si on accepte que nos savoirs sont bâtis sur des conventions culturelles plus que sur l’intelligence de l’individu, des conventions qui, comme raccourci, peuvent s’appeler « l’intelligence collective », on doit aussi pouvoir accepter qu’une croyance largement partagée au Dieu « raison » et à son Saint « le rasoir d’Ockham » peut en faire partie.
D’autres exemples dans le cadre anglais sont les anarchistes, qui choisissent presque sans exception de se vêtir de noir, avec des bottes noirs (comme si c’était la liberté de se conformer [aux codes vestimentaires de leurs ‘ennemis’]). Ils sont les analogues des « black blocks » et de l’éponyme passe-partout « Cami/lle » des ZADs. Cela fait contraste avec le désir de se vêtir n’importe comment pour subvertir les codes de l’uniformité, dans ces mêmes groupes. La mode joue avec les codes, elle aussi. Ces jeux sont des répétitions essentielles pour repousser le conformisme irréfléchie. L’anti-autoritarisme n’est pas contre l’autorité (nuance). Il y a une grande différence entre l’apparence et la réalité, qu’il faut souvent percer. Nous avons Robin des Bois (les français aussi, ils mettent l'électricité la nuit), les allemands Hansel und Gretel, les américains the Good the Bad and the Ugly. Etc.
Nous sommes tous les héritiers de l’Âge de la Raison. Nos « normes », si l’on accepte un moment les prémisses du livre d’Henrich, sont donc celles de « la Raison » qui dépasse le dogme. La Raison, c'et le vrai, même si le vrai est difficile à cerrner et dépend de la grille de lecture. Que ces mots existent depuis des lustres prouve notre connaissance et maniement de la problématique. Nous avons fréquemment eu, de toute évidence verbale, à y faire face. Nos normes de l’organisation des sciences du savoir prennent en compte la tendance à l’imitation des êtres humains, le système de « peer review » reconnaît cette réalité humaine, à l’égal du système parlementaire – nous avons donc dores et déjà des systèmes de « raison au pluriel ».
J’ai commencé cet écrit par citer des mots d’origines grecque et latine dans un dictionnaire physique français de 1977 (heuristique, heur) et sur wiktionnaire le mot sérendipité, d’origine sanskrite via le perse et l’italien (1557) et puis l’anglais. C’était en partie pour signaler que l’appréciation de « la raison » et de « la science » n’ont pas leurs origines dans l’époque moderne industrielle, sinon très longtemps avant, qu’on a peut-être oublié leurs origines pour faire cercle complet et revenir aux mêmes conclusions. « Heur-eux soit celui qui ne connaît pas son sort » sonne quand même mieux que « sérendip-iteux sera lui qui ne connaît pas son sort », ou, comme on me l’a dit une fois « la vérité est ce que dit l’oracle de Delphes, cherches à la comprendre ».
La dépréciation systématique de la raison, jusqu’à la dépréciation des « mots savants » (voir ci-dessus, abréviations du Petit Robert 1977) n’est pas pas une norme des civilisations dites primitives, sinon de la nôtre. Pour nos prédécesseurs, les mots étaient leurs outils de travail, pas un simple passe-temps social. Leur transversalité linguistique ne cessait d’enrichir la compréhension – des savoirs neutres dans un monde d’intéressement. L’un des graves dangers du numérique est de nous aliéner de nos outils cognitifs – les langues - qui nous permettent d’appréhender le monde – d’en faire un sens qui nous parle et qui nous donne les outils mentaux pour agir.
Finalement, je suis plutôt convaincu par les conclusions du livre de Henrich. J'ai l'habitude, dans mes processus d'apprentissage, de challenger vigoureusement tout ce qui va contre mes idées reçues - je crois que cela m'aide à m'engager avec la matière.
Les plusieurs points de désaccord surgissent peut-être de mon background, dans la culture des « hobbits ». Il dit avec raison qu'au lieu de nous tenir sur les épaules de géants, nous nous tenons sur les épaules de hobbits. Je pensais utiliser l'image d'Einstein comme exemple de la fulgurance de la génie humaine, mais je suis obligé de reconnaître qu'on ne pourrait plus hobbit que lui. Son entourage et ses expériences expliquent très facilement les outils et les possibilités mentales qu'il a pu acquérir. Ce contexte de haute qualité d'appréciation scientifique explique aussi l'acceptation du milieu scientifique pour ses idées.
Je cite une phrase (p456). « Non seulement un plus gros cerveau collectif produit une évolution culturelle cumulative plus ample et plus rapide, mais, si la taille ou la connectivité d'un groupe diminuent brusquement, ce groupe risque de perdre collectivement des savoir-faire culturels au fil des générations. » Et une autre (p460): « Avant que le commerce international n'ouvre pleinement les océans pour en faire des grandes voies maritimes, nos cerveaux collectifs étaient limités par la taille et la géographie de nos continents. »
Dans les dernières chapitres du livre, Henrich propose que nous sommes en train d'évoluer encore, culturellement et génétiquement, en accélérant. Si nous lisons attentivement les deux phrases citées, deux critiques ressortent. Où arrête la taille de la croissance du cerveau collectif? Les lois de l'évolution requièrent des populations différenciées et séparées aussi. La connectivité d'un groupe peut diminuer brusquement si, par exemple, le schéma d'information rend difficile le discernement à sa juste valeur des informations pertinentes. En fait les arguments, à ce niveau-là, d'Henrich sont grossièrement simplistes - comme des haches en pierre rudimentaires. Nos nouvelles technologies de la dissémination de l'information ne sont aucunement culturellement assimilées, nous n'avons pas eu le temps d'adaptation nécessaire. Les sciences ne se montrent pas assez adaptatives, non plus. Ses théories peuvent aider dans le processus.
Il me semble que si je réagis mal à ses propositions, ce n'est pas parce qu'il a tort, ni parce qu'il a tort de les élaborer, comme outils utiles. Non. C'est parce que je viens, moi aussi, du pays des hobbits - le pays qui a eu l'empire maritime mondial qui a permis à ses scientifiques de relier autant de points d'information culturelles plus tôt que d'autres cultures et de faire que sa langue devienne la lingua franca du monde savant entier. C'est-à-dire que l'Angleterre a un temps d'avance dans le développement d'outils culturels particulièrement bien adaptés à notre époque industrielle et post-industrielle et à la crise écologique présente.
L'Angleterre n'est pas de très grande taille, mais elle est exceptionnellement bien connectée. Henrich ne met pas de confins sur la taille des groupes, on ressort avec l'idée que plus c'est grand, mieux c'est. Ni est-ce qu'il analyse le jeu entre les groupes de différentes tailles, à part dire que les individus savent discriminer entre un bon enseignant et un mauvais enseignant. Peut-être il se défendrait en disant que c'est hors sujet, mais le sujet est la biologie évolutive humaine et l'hypothèse est que les boucles de rétroaction existent. La population humaine est de plusieurs milliards de plus que naguère, on peut se sentir noyé dans la masse. Son évolution est menacée par l'extinction, pur et simple, par l'excroissance de la population. Même à des populations plus réduites, l'humanité a eu des impacts très forts et parfois adverses sur l'écologie de son milieu de vie, dans le passé, une boucle de rétroaction aussi significative que celle qui opère socialement ou dans l'invention d'outils. La pression démographique est une réalité humaine, elle change les rapports entre nous pour créer de l'ouverture sociale ou de la fermeture (repli) sociale. Comme la société est dynamique, il y a une constante insertion sociale de nouveaux venus dans des hiérarchies sociale plus statiques ou stables. Ces arrivants ont tendance à l'ouverture sociale (ils cherchent à s'intégrer). Les hiérarchies consolidées cherchent au contraire à défendre leurs acquis. L'équilibre entre ces deux forces est critique pour le passage de savoir adaptatif.
La nature précise de la connectivité intrahumaine, hors liens familiaux et tribaux, spécifiquement technologique et macro-systèmique, adaptée à ces vastes populations en convergence culturelle, devient la préoccupation centrale. Pas la taille, puisque tout le monde, ou presque, est interconnecté - trop interconnecté. Une fois un certain seuil dépassé, on passe à des critères inter-taille, ce que j'appelle d'inter-connectivité fractale et dynamique. Ce n'est pas un tout ou rien, la granularité rentre en compte - c'est-à-dire la cohésion sociale à diverses échelles. On peut argumenter que peu importe le confort communicatif de chaque individu, mais c'est ce qui a le plus d'importance pour que la culture humaine ait une existence fonctionnelle. Si les tribus, les us et coutumes, les unités familiales commencent à être perçues comme sans importance - qu'est-ce qui peut les remplacer ou les étayer ? Je ne fais qu'accepter son constat que nous sommes en train d'évoluer, plus rapidement que jamais. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Le vrai sujet est de recentrer la sciences en les concentrant sur le rapport qu'ont ces cerveaux collectifs, ces cultures et leur organisation à notre existence. Comme le dit Henrich, ce sont des facteurs co-évolutionnaires - notre manière de nous transporter et de transporter l'information impacte notre organisation sociale et notre capacité de mettre en œuvre les politiques nécessaires. Pour convaincre aux gens de changer d'habitude, il faut qu'ils se trouvent dans des cadres apprenants susceptibles de produire les résultats désirés. En tout cela, nous sommes très déficients. Les écoles n'ont jamais été aussi efficaces que lorsqu'on était dans la découverte de leur valeur, motivés et enthousiastes.
dimanche 7 mars 2021
Peut-être ce n’est pas si complexe. Prenons quelques normes. En France il y a vraiment beaucoup de gens maintenant - autour de 70 millions, il me semble. Plus qu’avant. On était autour de 40 millions il y a moins d’un siècle (années 1940). Nous sommes des hyper-consommateurs aussi, par rapport à cette époque.
La complexité, ce qui se passe en avale et en amont fait des impacts. Les agriculteurs font des impacts. Ils ne peuvent pas faire comme avant – ils ne font pas comme avant. Même sans normes.Il faut qu’ils acceptent qu’ils vivent dans un écosystème qui génère de la biodiversité – qu’ils en font partie. Si Edgar Morin fait partie de ceux, avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui ont en partie fait vivre ces mots et ces récits, tout récit peut mener à une interprétation erronée. Il est vrai que le Développement durable est un oxymore dans son usage présent, mais Small is Beautiful (c.1968) fait toujours mieux contre l’échelle industrielle que Décroissance (c.1972) et croissance verte se met carrément au service du green-washing.
Donc je pense que Xavier Noulhianne, l’auteur du livre Le ménage des Champs, Chronique d’un éleveur au XXIe siècle (2016) a à la fois tort et raison. Il a raison que l’invasion des normes de qualité et de traçabilité industrielles actuelles est néfaste et inique. Il n’a pas raison de s’attaquer à la raison systémique. Il a raison de s’attaquer à cette raison systémique qui nous domine, à présent, mais pas à « la raison systémique » ou à toute raison systémique, ou à toute « rationalité ». Il a raison de douter de la valeur des idées « marques » - comme la Bio (grand B), mais nous avons besoin d’une lexique rafraîchie pour pouvoir comprendre et discuter du monde dans lequel nous nous trouvons. Le mot « résilience », dans le sens qui lui est accordé aujourd’hui, est emprunté à l’anglais où il est déjà rentré dans la langue courante il y a longtemps. Cela veut dire donc « savoir fléchir sans casser ». Je ne l’utiliserai plus maintenant, après l’explication de Xavier Noulhianne que la résilience veut dire que cela use quand même le matériau.
Lorsqu’il ébauche l’analyse des tenants et aboutissants du bio (petit b) à partir de 1972 en les contrastant avec les tentatives de normalisation actuelles, le puçage des chèvres, la télémétrie satellitaire, l’utilisation des agriculteurs au service des industries des pesticides et des machines agricoles, il a raison de nouveau. Mais ce n’est pas pour autant que le petit éleveur de bétail n’est pas critiquable, de son côté, et cela bien avant le présent.
C’est que les mots, il ne faut pas les céder. Les récits non plus. C’est une bagarre de sens, mais pas sans mots. « Solutions techniques » est une autre expression problématique, à l’égal de « la Science ». On cherche bel et bien des solutions à nos problèmes écologiques – des solutions qui donneront des bons résultats physiques. Nous sommes des êtres physiques. Notre bien-être mental – ou spirituel – a lieu dans nos corps et ceux d’autrui. Au lieu de rejeter la science et la technologie, il faudrait récupérer ces mots et les reconnaître pour ce qu’ils sont : des manières de décrire n’importe quelle technique ou savoir faire, qu’il soit humain, social, technologique, physique, chimique. Les mots commencent à perdre leur sens quand nous les employons pour vouloir dire autre chose que leur sens simple, non-dilué.
Je me suis saisi d’une expression « théorie de l’information » dont je ne suis encore pas au courant de ses subtilités académiques. J’ai compris que l’information passe par des agents, des agencements – j’aurais dit « localisés » mais j’aime bien le mot « situé » qu’on commence à utiliser – situés dans l’espace-temps. Dans notre espace-temps de tout un chacun.
Je pense que si le passage d’information et de matériel physiques devient de nouveau « situé », c’est-à-dire localisé – et que cela emploie des agents humains, dans leurs déplacements à l’échelle humaine, nous retrouverons vite une manière de nous adresser physiquement et socialement aux défis écologiques qui se présentent à nous. En ceci je suis déjà pleinement dans le champs d’accord avec la petite paysannerie, telle qu’elle a été, avant 1948.
Mais il faut pour cela des modèles physiques réelles d’infrastructure – en mouvement - dynamiques. Et le petit fermier sur ses 16 hectares ne fait pas l’affaire – il est statique, sans main d’œuvre, « seul face à une actualité jamais saisissable ». Il faut modéliser un système d’autonomie en mouvement, ce qui nous met face à l’altérité – être des gens qui bougent, souvent en formation, en faire jusqu’à une mode de vie. Le monde paysan est autant mis à mal par ces mouvements de populations que d’autres habitants sédentaires, à qui la sédentarité est rendue possible par la voiture. Avec les boucles de retro-action fonctionnelle entre sédentaires et nomades, c’est la complémentarité de ces deux modes de vie qui devient de nouveau possible, mais comment ?
Je pense que les marchés ruraux, mais pas seulement, urbains aussi, démontrent déjà comment cela peut se faire. Pas les ventes « à la ferme » qui ne font qu’une autre version de l’ingénierie socio-économique des supermarchés et des zones pour chaque filière. Les marchés de plein vent répondent logiquement aux besoins d’un espace-temps où les gens peuvent coïncider, en bougeant. La bénéfice est de créer des séquences et des rythmes sur lesquels on peut construire sa vie en déplacement. Ce qui manque, c’est l’accueil – les auberges, les lieux de stockage, les campings municipaux et les potagers qui desservent les populations qui bougent. Ce sont aussi les intérêts partisans, exclusifs, qui terminent par rendre la vie active impossible. Ce sont les occupants de milieu rural qui « ne veulent pas » de populations itinérantes, à moins qu’ils viennent avec l’argent. L'inutilité humaine, elle aussi, est un produit du système - et très dangéreux pour nous tous.
Noulhianne ne paraît vouloir s’adresser qu’à ses frères et sœurs éleveurs, comme camarades dans sa lutte. Il cite ce genre de lutte sectorielle comme « exemplaire », tout en reconnaissant son impossibilité dans les conditions atomisées d’aujourd’hui (p244., par rapport à « Des éleveurs contre la sélection d’État »). Il prétend, avec raison il me semble, que la situation terrible des éleveurs n’est qu’un exemple de plus de la société systémique qui nous afflige. Il faut donc trouver moyen de concentrer les forces, pas les balkaniser, sinon le propos n'est pas sérieux. Sans nier que l'information et le témoignage sont bien utiles, impressionants même.
C’est la voiture en combinaison avec le téléphone portable/ordinateur que nous utilisons actuellement pour ces échanges d’information et de denrées. Mais si cela devient trop cher, même dans une économie de marché les êtres humains sans prothèse peuvent commencer à faire une concurrence économique contre ces moyens industriels – comme c’est déjà le cas avec l’utilisation du vélo en ville. Le fait de resituer nos moyens de communications – de faire renaître l’utilisation de téléphones fixes et non-individualisés, par exemple – conjointement avec une bonne discipline de focalisation sur l’exécution des tâches humaines, sans la facilité de l’hyper-consommation d’énergie - rendent encore plus intéressant cette approche. L’augmentation de l’horticulture en campagne n’est pas une proposition alléchante pour des gens riches ou cultivés, sinon pour des pauvres qui veulent s’en sortir.
Cela nécessite des entreprises en commun – de la coopération, de la coordination. Cela fait renaître l’intérêt pratique qu’apportent d’autres êtres humains.
Ce que je décris ici est une pensée systémique. J’ai toujours été de l’avis que cela sied très mal à un membre de la société « toute voiture » – une vraie monoculture, surtout en campagne – de protester contre la création de systèmes qui ne dépendent pas des machines industrielles. Si on est pro-humain, on devrait pouvoir envisager des systèmes qui mettent la primauté sur le fonctionnement physique et social humains. Si on prétend valoriser la dignité et les droits humains, la cohérence veut qu’on crée des possibilités de vie fonctionnelle sociale très humaines. Cette pensée « systémique » n’est autre qu’une reconnaissance que l’infrastructure, l’entre-nous, l’altérité font partie de notre humanité – que de traiter de chaque humain ou petit groupe d’humains comme un isolat social nie à la communalité de nos vies.
« Nous ne pouvons pas tous vivre comme des Amishs » - c’est le président Macron qui a dit quelque chose du genre. Dans un reportage sur les Amishs de cette époque-là (c.2018-9), on a raconté qu’on a vu des Amish utiliser des portables (dans un marché de bétail), que ceux qui en utilisaient ont expliqué qu’ils allaient aussi à la « petite maison » au fond du jardin en cas de besoin sévère pour les utiliser et que c’était pour pouvoir au moins être en contact avec la société en dehors de leurs communautés.
Je pense que les Amish donnent à réfléchir. Je ne connais pas leurs raisons religieuses, mais ils ont quand même réussi à se tenir, sans fléchir, face à la « techno-société » la plus forte du monde. L’exemple ci-dessus montre leur pragmatisme et non pas la psycho-rigidité qu’on leur attribue. L’urgence écologique est une urgence physique – nous devons déjà être en mode carbone-positive, bio-diversité-positive, dépollution et tout le reste, surtout là où la surconsommation est enracinée, si c’est du tout du tout possible. L’exemple compte pour beaucoup – il y a plein de cultures qui sont « en voie de développement » vers le modèle que nous présentons. Les chiffres pratiques comptent pour beaucoup – c’est nous qui sommes actuellement en train de faire consommer le monde, de par notre surconsommation actuelle.
Le marche à pied et l’emploi physique humains sont potentiellement carbone-positives, productives – et socialement utiles. Dans une infrastructure économique qui prend en compte les critères écologiques, elles le sont plus encore. Il est sûr que de telles normes sociales rencontreront de la résistance, mais aussi du soutien. Il y a beaucoup de formes de travail qui deviennent rentables, surtout en campagne, si on n’a plus à payer la voiture individuelle. Et en engageant les gens physiquement avec la nature dans laquelle ils se déplacent, on est en train de créer, de former des outils d’apprentissage pour des populations qui en sont éloignées. Nous n’avons qu’à créer les formations qui permettent aux gens de se déplacer en faisant revivre la nature pour donner la confiance aux gens que c’est faisable.
Cela mettrait en net relief les technologies qui servent et celles qui ne servent pas à l’intérêt collectif. Ayant au moins une méthode sociétale qui nous permet de stopper le réchauffement climatique, etc., nous nous créons une marge de manœuvre pour rétablir le rapport de force avec lesdites machines, une manière de les accommoder culturellement, tant soit peu. Par rapport à l’argent, le fait de faire tourner une économie physique, sans ou avec peu d’argent, est une manière de resituer les impôts là où on génère la revenu. C'est d'une logique impeccable ... écologique. Sinon, à quoi sont destinés les impôts?
Ce ne sont donc ni des solutions bison-ours ni Utopiques, mais très enracinées dans toute nos réalités, capables d’être soutenues pragmatiquement par des acteurs à toute échelle de la pyramide décisionnelle.
Si j’ai commencé par l’exemple que donne ce livre Le ménage des champs ... par Xavier Noulhianne, c’est que lui, comme la quasi-totalité des écrivains et penseurs jusqu’à là, ont une pensée que je qualifierais de « statique » de fonte en comble. Et cela alors qu’il a un cheptel de ruminants qui sont faits pour bouger (transhumance) à travers des pays où il se passe autre chose que l’élevage. Cette pensée me paraît manquer de calculer le mouvement – les choses et l’information qui bougent – et louper donc les questions fondamentales de l’infrastructure qui nous inclut. Chacun est plaqué sur place, à attendre « les visites ». Il est vrai qu’une pensée systémique non-dynamique nous oblige à l’application de normes qui viennent d’en haut. Si ce n’est pas par le consentement, par la force. Je propose des solutions dans lesquelles on participe, où on est acteur, à l’échelle requise. Il est évident que tout système proposé peut avoir ses défauts – que l’on découvre, au fur et à mesure. Le fait de bouger, sans être isolé, est déjà un passage à l’acte, à l’acte qui mobilise, qui fait découvrir. Pour les gens statiques, j’ai l’impression que cela représente une profonde menace – et je peux les comprendre. Mais il faut chercher l'engagement quand même. Dans mon expérience il n'est pas nécessaire de "chercher le conflit" - cela vient tout seul. "s'imposer dans la réalité de cet autre afin qu'il ne puisse échapper à notre propre perception du monde" (p.230) - cela revient à ce que j'ai déjà dit - il faut bouger. Les manifestations et d'autres actions symboliques de courte durée sont pires que rien, elles font acte de n'être que symboliques.
La liberté de mouvement et d’association (la non-censure) sont quand même les libertés primordiales desquelles écoulent toutes les autres. La « race » des agriculteurs est très bloquée, plus apte à des travaux de force que des courses de fond – ce serait peut-être le résultat de la sélection artificielle ? Blagues à part, la dignité et les droits humaines se perpétuent parce qu’on cherchent à les défendre pour tout le monde, pas parce qu’on les accorde à soi-même en fermant la porte aux étrangers.
Et j’ai des petits doutes. Dans une société agricole tellement appauvrie en petits paysans, est-ce que ceux qui ont trouvé bien de « rentrer dans le système », malgré ses défauts, sont vraiment les meilleurs conseillers ? Est-ce que Xavier a un tracteur ? Est-ce qu’il accepterait de faire faire à main ce qu’il fait actuellement avec le tracteur ? Est-ce qu’il traiterait les gens de passage comme des gens de statu social égal ? Est-ce qu’il accepterait de replanter des arbres (fruitiers) et des haies, en leur assurant la protection des déprédations du bétail pendant qu’ils poussent ? Il me paraît que tous ces efforts sont des efforts conjoints avec autrui et qu’ils ne marcheront que lorsque chacun y trouve son intérêt, pas seulement le détenteur du terrain. La ré-physicalisation (rématérialisation) de ces intérêts, en dehors du sphère purement financier, est la même chose, en réalité, que la reprise en compte du physique – de l’environnement, du vivant, comme des ayants valeur et des ayant droit.
C’est-à-dire des vrais intérêts, qui ne tarderont pas à se réintégrer dans l’économie globale. Cela implique que la dominance de ces « biens » de surface terrestre deviendra de nouveau un sujet très chaud. Des tout-petits paysans vont se trouver en relation avec des grands propriétaires terriens. Il va falloir s’arranger avec des « colons » (« métayers » qui se déplacent, c’est le sens original du mot), des « sans terres » qui veulent cultiver et qui n'attendent pas l'argent qui tombe du ciel. La renaissance d’un sphère d’action sociale restimulera les activités de groupes sociales organisées autour du travail vivrier. Ceux qui viennent planter des arbres, cultiver des potagers et aménager des chemins risquent de faire naître un autre équilibre de pouvoir politique qui n’a rien à voir avec ce qui existe actuellement dans les territoires non-urbains. Très loin des préoccupations des paysans et des fermiers actuels et souvent conflictuels.
Il est évident que le bio vient de la préoccupation avec la manière de pratiquer l’horticulture (l’agriculture est à une échelle trop grande pour être sérieusement écologique, pour moi) et non pas de la « qualité » de ces produits – qui en écoule en tous cas. Mais on peut se permettre de penser que si notre lutte écologique est sur tout le territoire, la production de fruits et légumes n’est pas l’aune par lequel on peut juger notre réussite. La transformation, les arts culinaires, la santé publique, mais à vrai dire toute l’infrastructure qui se concentre dans les autres industries et dans les centres urbains va se retrouver également intégrés au tissu de ce qu’on appelle la campagne, la « ruralité ». C’est notre affaire à toutes et à tous.
Il est donc important que les agriculteurs et ceux qui habitent actuellement en milieu rural soient proactifs dans l'invention de cette nouvelle infrastructure s’ils ne veulent pas couler sans trace. S’ils veulent se spécialiser – dans l’élevage par exemple – qu’ils pensent à créer des bails pour que d’autres gens puissent produire des légumes, beaucoup moins dépensières en surface. L’augmentation des fissures sociales – des gouffres – prend une forme où elle permet à des très riches et leurs dépendants de bouger entre la ville et la campagne en toute liberté, alors que les pauvres doivent rester dans et à proximité des milieux urbains. Cette polarisation est tellement forte – et croissante – que l’écologie sociale se trouve de plus en plus en antagonisme profonde avec les conservateurs de la nature, excessivement privilégiés, excessivement informés des traditions perdues dans les génocides culturelles successives des couches inférieures. Avec la fluidification, en bon ordre, de nos voyages en milieu rural, nous pouvons espérer trouver des remèdes à cette situation, mais s’il y a fermeture, l’occupation des zones rurales deviendra une source de conflit croissant. La possibilité de créer une vraie interactivité située, entre des agents situées autonomes, fait partie de la science nouvelle, qui révalorise l'humain, qui passe par l'humain.
Tournons maintenant à des manières d’agir pragmatiques dans notre situation actuelle, réelle. Avec le confinement et le couvre-feu qui se terminent, le désir d’aller voir le pays, de se décontracter, est en train, sans doute, de se manifester et de prendre forme. Ceux qui sont les mieux à même de passer à l’acte vont relancer des initiatives. Il y a bien besoin de soutien logistique. Le mouvement écologique devient plus radicalement opposée à la société industrielle, il occupe des grandes mairies en milieu urbain mais pas des petites mairies en milieu rural, en général. Il prend le relais, dans le radicalisme de gauche, sur les partis de gauche traditionnels. Malgré les tentatives de désamorcer la formation de centres de pouvoir territorial conséquents, les anciens centres régionaux, les grandes villes provinciales, ont des liens forts avec leur arrière-pays, si ce n’est que parce qu’une grande partie de l’élite et de la population active y vie, y va en vacances une partie de l’année, est originaire des départements autour de la grande ville.
Il serait donc intéressant d’étendre ces liens à la population ouvrière – que les actifs désœuvrés en ville trouvent du travail écologique dans la campagne. La logique de la situation écologique, économique et politique est telle que cela est devenu presque inévitable.
mardi 23 février 2021
N'oublions pas un seul moment que les paysages qu'il nous faut analyser sont ici – pas dans les pays sous-pliants, dans la mesure que c'est ici que l'on a consommé et qu'on va consommer le monde – dans les pays dominateurs d'origine. La rapidité de l'épuisement des ressources, de l'extinctinction d'espèces et d'individus est telle qu'il restera très peu pour les pays en voie d'adopter notre mode d'hyperconsommation hyper-destructrice.
Mais cette analyse ne doit pas se faire sur des critères purement physiques au niveau dit «local» – c'est la logique du paysage dans sa manière d'appuyer nos valeurs qui en est le sujet, de l'analyse. Car, bien sûr, ce sont les dégâts perpétrés dans des pays lointains, pour fournir nos «besoins» de consommation, qui font partie de notre paysage actuel. C'est même pour cette raison que notre paysage local ne nous sert plus guère à rien en termes de fourniture physique de ce qu'il nous «faut» pour vivre. Au contraire, il nous est façonné pour créer le néant, le vide sur lequel nous imprimons nos rêves et nos désirs secrets, sans nous déranger outre mesure.
Voyons comment ça marche. A l'époque de ma naissance, en Angleterre, les «bed-and-breakfasts» mettaient encore des panneaux avec «pas de noirs, pas de chiens et pas d'irlandais» écrit dessus – et la moitié de ma famille est très identifiée à son origine irlandaise de par le nom de famille de divers personnages célèbres ... en Amérique. Rappelons-nous que John Fitzgerald-Kennedy a décidé d'occulter la première partie de son vrai nom de famille pour des raisons électoraux. Il s'est fait élire, aux États-Unis, presque au moment de ma naissance. Cela a marché, dans les deux cas, malgré les obstacles.
Ces irlandais et leur histoire servent presque de «testbed» pour le modèle colonial grand-plan instauré entre le dix-huitième et le dix-neuvième siècle. Ils étaient les «navvies» («ouvriers de base» - péjoratif) sur les gros œuvres des chemins de fer, des canaux, etc., sur le «Mainland» - la base manufacturière pour les importations de ressources primaires dans les colonies. Les pouvoirs anglais ont toujours cherché à garder les ouvriers «noirs» en dehors de leurs frontières métropolitaines – ce n'est que dans les années 1960s qu'on a vu arriver des antillais en grand nombre (la génération «Windrush») un peu de la manière qu'on a vu arriver les algériens en France, même si les circonstances furent moins tendues. S'il y a une raison à cette absence de noirs dans le mixte, naguère, elle est que les anglais ont un concept de la liberté et de l'égalité de tout le monde dans leur lois et dans leurs mœurs depuis toujours, qui ne sied pas du tout avec l'esclavagisme. Le «deux poids deux mesures» s'est entretenu en limitant la présence des coloniaux au minimum sur les îles britanniques – et en parlant encore moins de cette existence, sauf au niveau de l'exoticisme. C'est le Bristol, port primaire des armateurs de l'esclavagisme, qui en a connu le plus, historiquement. Mais la libération et la révolution se sont passés heureusement ailleurs, nous avons déjà eu la nôtre, à titre relatif, et nous l'avons poursuivie en extrayant nos bénéfices des autres par le free trade. Vive la liberté!.
Le modèle est encore plus malicieux – puisque une grande partie de ces irlandais (écossais, gallois, cornouaillais) servaient à l'empire britannique comme la classe d'administration coloniale de base – les pirates, les marchands, les petits chefs de chantier – et maîtres d'esclaves. On peut aussi observer à quel point les irlandais arrivaient à pénétrer partout si on jette un coup d'œil sur les noms des participants à … la révolution française, ou à la révolte dans la Vendée. «Takes one to know one» - d'après tout, ils savaient mieux que personne là d'où ils venaient … les grandes familles, l'extrême pauvreté rurale, les nettoyages ethniques ont tous étés d'abord le lot des ethnies discriminées des îles britanniques, leur rendant capables d'infliger leur «savoir faire avec» aux autres.
Pendant le cours du dix-neuvième et du vingtième siècle, tout le monde, peu à peu, a changé de station sociale. De nouveau, le trajectoire de mon grand-père d'origine purement irlandaise (sa famille est venue autour de la «Famine des Patates» génocidaire - c. 1850) en est un bon exemple. Il a intégré les forces navales anglaises pendant la première guerre mondiale au plus bas dans la salle des machines, pour terminer dans la deuxième guerre mondiale chef ingénieur sur les plus grands navires de la flotte. Pour l'anecdote, tous les bâtiments de guerre dans lesquels il a exercé ses fonctions ont coulé, sans qu'il soit jamais present au moment de leur némésis. Son fils, mon père, est devenu prof. Cette «ascension sociale» est des plus banales, dans l'histoire de presque tout «anglais» du début du vingtième siècle. Cela fait que l'Angleterre n'est décidément pas anglaise et le caractère national d'autant moins, la majorité de la «classe dirigeante» se sentant encore bien heureuse de s'être échappée du plus bas – il n'existe que le besoin de s'inventer quelque chose de discernable dans le flou des génocides progressives culturelles qui terminent par rendre ridicule l'idée d'une «guerre de classes» dans le sens figé du terme. Une guerre de l'entre-soi contre soi, sotto voce, à la rigueur.
Ce qu'on appelle le racisme, ou de manière encore plus indéterminée la discrimination, a commencé très près de chez nous, partout, avant de se mondialiser. On pourrait dire que le racisme est «fractal» dans le sens qu'il va trouver moyen de s'appliquer dans tous les cas, si on lui donne sa tête.
Les échelles de la fractalité sont physiquement déterminées, on peut affirmer cela aussi. Les «classes discriminées» vont se trouver tout près lorsque les moyens de transport ne sont pas très rapides, ensuite ils vont s'éloigner - à l'époque des empires maritimes, pour, dans leur incarnation présente, se trouver partout, au temps de l'instantanéité éthèréale. Il faut simplement des marqueurs clairs – couleur de peau, voiture, âge, nom de famille, fric – lorsque la connaissance est dans le détail défaillante.
L'oligarchie, un mot sans importance jusqu'à il y a peu, a aujourd'hui un caractère défini surtout par la richesse et la mobilité matérielles et non pas par la couleur de la peau, le sexe, l'éducation, la langue. Les plaintes de racisme et de discrimination, par contre, se font par rapport à des vieilles histoires qui ne sont plus à l'ordre du jour réel – tout au moins dans la mesure que l'anti-discrimination à ces égards est devenue, en soi, une force de discrimination massive.
Dans notre trame d'analyse du racisme des États-Unis, un racisme d'apparence qui est, pour nous, anachronique, nous oublions cela – c'est-à-dire que de nouveaux motifs de discrimination peuvent naître et créer un ou plusieurs «effets ricochet» qui font resurgir les anciens ressentiments. Il nous faudrait y prêter plus d'attention sérieuse. La discrimination positive, basée sur des déterminants de classe saillants, laisse son empreinte négative sur des individus qui sont par conséquence exclus, sans motif, qui forment ensuite des coalitions de «pas contents». Ce n'est pas étonnant: sur le principe bien anglais de céder avant que la barque «craque», la proto-révolution américaine du déplacement d'une grande quantité de gens tout-à-fait compétents et aiguisés à la tâche de gouverner, blancs, mâles et d'une certaine âge, pour les remplacer par des gens moins rôdés, bien que ne manquant ni d'enthousiasme, ni de compétence, juste parce qu'ils ne sont pas blancs, pas des hommes et pas très âgés, peut paraître un peu fort de café. La logique statistique, hypothétiquement au service de l'individu, termine par violer l'égalité d'opportunité pour le dit individu, comme si on rajoutait dulestage à un plongeur pour l'interdire de refaire surface avant les autres. Il ne faut pas laisser hors compte le calcul politique des dirigeants encore en poste, de voir des barracudas voraces de la même taille remplacés par des poissons «sage-femme» à la plaisante complicité. L'individuation statistique de notre analyse de ces phénomènes insulte, en quelque sorte, notre intelligence collective, tout comme l'atomisation numérique et économique de nos intérêts masque habilement l'enjeu si favorable pour les pouvoirs hiérarchiques - qui soudent ainsi de plus en plus le pouvoir et de richesse entre leurs seules mains à cause de ces effets «secondaires».
L'un de ces effets secondaires non-identifiés est que l'oligarchie a, aujourd'hui, adopte ostensiblement une idéologie illusoire définie de plus en plus par des critères d'affect, aidé par ce tabou sur la discussion ouverte de leur fonctionnalité combinatorielle - leur «fractalité». Des mots comme performance, mérite, docilité, vitalité, beauté, chaleur humaine, empathie, autonomie, facilité, adaptivité, charisme, dynamisme, compatibilité foisonnent et contrastent joyeusement avec d'autres mots comme compliqué, difficile, intriqué, caractère, insoumission, marginal, psycho-rigide … sans que l'on se demande s'il est vraiment possible, socio-psychologiquement, d'expliquer des effets de groupe en termes de pure psychologie individuelle. Témoigne la concentration qui se prête aux qualités exaltées nécessaires aux astronautes putatifs ...
Les mots choisis ci-dessus se veulent universels et neutres mais dans leurs effets exercent autant de tyrannie sur la «non-conformité» que n'importe quelle catégorie arbitrairement discriminatoire d'antan. Dans leur usage réel, dans leur subjectivité relationnelle, ces mots donnent le feu vert à toutes les manipulations du pouvoir social possibles.
L'anti-universalisme naît du désir de s'échapper des confins de cette monoculture amorphe en auto-service des privilégiés. Les idéologies de repli «identitaire» servent comme drapeaux rassembleurs auto-protecteurs dans le sens qu'étant, par définition, non-universelles, on ne peut pas les attaquer en utilisant les codes de ce cadre de logique devenu orthodoxe et politiquement correct. Noblesse oblige. Inconformité oblige plus.
La petite expression assassine qui représente le mieux cette situation de repli identitaire est: «c'est ton choix»
(mais, ... merci pour me le faire connaître …).
Bon, cela a été une grande parenthèse – du moins en apparence – dans le sujet de tête - l'analyse du paysage. Ce paysage, il est cependant le résultat, le produit de cette trame analytique. Vu d'un avion, le paysage de l'Europe de l'ouest est affreusement répétitif, un patchwork de rectangles à perte de vue, qui ne cesse que lorsque la mer ou les montagnes empêchent l'intervention humano-machinale directe. A l'instar des HLMs anglaises, fondées sur la doctrine du choix, ces rectangles sont d'une uniformité éclatant de mornitude. Pour ne pas perdre la face dans notre accaparation du monde entier, notre abandon des quelques friches inaptes à l'occupation se qualifié de «réserve» – pour que personne d'autre ne s'y aventure non plus - la nature humaine remplit ainsi le vide.
Mais la bio-nature et la biodiversité sont ici en état catastrophique, la régularité «anti-naturelle» du paysage met en évidence les spasmes et contractions qui ont arrêté le «cœur» de cette nature. La qualité géométrique de ces phénomènes n'est pas dû au hasard, ni est-elle dû à un dessinateur global «conscient», elle est le produit d'un système, oui, mais surtout d'un système qui a perdu le sens de ses aboutissants géophysiques contextuels, sa seule cohérence étant auto-référentielle.
Le plus pitoyable, dans ce système qui s'est échappé à ses dessinateurs, est que la «nature», pour nous, ce sont les montagnes, la mer, qui avec leurs formes d'apparence insoumise à l'artificialisation de l'anthropocène, représentent des éléments d'espoir de retrouvailles avec notre nature propre. Cette mode de pensée «anti-classique, néo-gothique», est née avec la révolution industrielle, c'est comme l'idéal du jardin anglais en contre-point de l'idéal du jardin de Versailles.
En réalité, les friches qui se trouvent aux marges de notre artificialisation du sol n'ont pas plus de sens que le paysage domestiqué – l'échelle des choix décisifs qui les a formé n'est nullement en phase avec les besoins de la planète et ces vestiges dites «naturelles» ne sont que les bords de page non-guillotinés dans une œuvre d'auto-destruction quasi-complète.
Tout ce dont on peut être sûr, c'est que les paysages qui en résultent représentent les manifestations physiques de la dynamique qui les a créés – si on sait les lire.
Ce matin, j'ai marché, sur la route qui mène vers le haut, vers l'éco-golf (sans encore le trouver, j'espère que ma bonne chance continuera). L'ambiance sonore, le matin de ma sortie, a été remplie par le vrombissement des automobiles vacancières d'un beau dimanche de «couvre-feu», en symphonie avec des tirs soutenus de fusil assez gros-calibre. Les fourgonnettes et 4x4 blanches qui sont de rigueur pour le transport des chiens de chasse surnuméraires étaient librement distribuées en bas du chemin. En montant, j'ai noté l'oblitération standarde de tout arbuste, tout roseau par le fauchage, au bord d'une route goudronnée en état immaculé. Des panneaux d'apparence rustique indiquaient les gîtes toutes prêtes à accueillir le touriste aux poches profondes. Le panorama qui s'étalait devant moi était d'un paysage de champs vides entourés de clôture électrique, quelques moignons d'arbre erratiques, quelques vaches vacantes. Ensuite des tas de pierres et d'agrégat qui donnaient à penser qu'il y a eu des travaux de construction «en cours», des champs déchiquetés en ornières de boue de tracteur, deux ou trois petits conglomérats de hangars massifs qui devaient être les fermes du coin. En surplomb, la garrigue du haut des «causses», trop pentues, trop dénuées de sol arable pour subir des mis-à-ras systématiques, peuplés d'épineux résistants aux vaches, avec des antennes relais encerclées de clôtures défensives tout au sommet comme des cornes surdimensionnées.
J'ai trouvé ce paysage désolant parce que désolé, désert. Le désert néo-rural réel. Les objets matériels épars étaient comme des bouts de lego géant placés ci et là. Il ne s'y trouvait aucun véritable lien avec les contours du paysage, à part la sinuosité précise de la route, aucune échelle mineure, aucune diversité, juste un gros dessin délaissé d'enfant désenchanté et distrait, avec les crayons couleurs abandonnés sur place. Seulement le LIDAR serait capable d'y voir quelques restes d'activité contingente humaine. Pas de jardin, pas d'abri pour des gens «bosseurs» qui ne prennent leurs loisirs qu'«en voiture», au dedans – dans un tel paysage je pouvais les comprendre. Très peu de variation chromatique. Des bennes en plastique au bout de chaque chemin de chaque «amateur de la nature» qui a décidé de venir vivre dans ce désert qu'il pensait plus prêt de la nature. Des bennes aliènes qui servaient à extraire les intrants dont dépendait le ménage.
Un paysage «infractal», où l'ordre de l'infractalité arbitraire s'impose, plus que l'ordre des êtres vivants qui s'accordent à en faire quelque chose. Même les vaches n'y voient que le sens de l'entrée des graines et du foin d'ailleurs – elles sont équipées, ces ruminantes à courte vie d'ennui, pour rêvasser jusqu'à la fin du temps tronqué. Une fractalité unique – donc impossiblement contre-nature, idéale pour la chasse et les grosses machines, aucune anfractuosité du terrain pour se cacher, des champs de libre tir à perte de vue.
Ce paysage dit «pastoral», il peut s'apercevoir sur toutes les landes et les haut-pays de l'Europe, surtout au nord de l'Angleterre, là où les écossais ont été chassé de leurs terres (crofts), reprises par des aristocrates chasseurs qui en ont fait des réserves d'abattage «naturelles» pour ensuite douglasser le domaine forestier, ne laissant finalement que l'ossature du pays nu dans les vents hurlants, là où il y avait jadis des jardins, de la tourbe, des arbres anciens, des accidents de terrain vécu partout.
Les premiers «touristes», les premiers consommateurs, les premières vaches-à-lait de l'obsolescence programmée du paysage trouveraient ici les héritiers qu'ils méritent.
Je me rappelle que dans la Suisse, dans l'une de réserves naturelles les plus anciennes de l'Europe, on réintroduit au bout de cent ans les loups pour permettre la croissance des jeunes arbres, broutés jusqu'à l'extinction sinon par les cerfs non-chassés du coin. Je me demande si l'effet majeure de la présence des loups n'est pas pas tout simplement que les cerfs savent qu'on les guette, qu'une présence familière les regarde de nouveau avec du sens.
Un paysage qui n'a pas de sens, peut-être ça se sent – que le vide se sent et qu'il est devenu la nature de l'étoffe cérébrale des esthètes du monde entier. Le silence. L'absence. L'effacement et son observateur, émerveillé, niais devant cette merveille insondable du vide qu'il sait créer, là où la vie a renoncé à son savoir vivre.
Dans un écosystème, il existe une (en réalité plusieurs) dynamiques de réaction-diffusion – des insectes voraces pullulent, des prédateurs qui les mangent commencent à pulluler, l'équilibre entre les deux populations s'établit, mais cet équilibre est toujours oscillant – il y a des années où il y a plus de prédateurs, des années où il y a plus d'insectes, …
La vastitude de la nature nous a permis d'alimenter la croyance que nos petits efforts humains, que chaque «patch» de notre «work», n'allait jamais porter atteinte à l'énorme réservoir naturel qui rengraissait chaque année nos propres réserves. Ou plutôt, cet article de mauvaise foi s'est érigé en bannière de l'exploitation agricole (sic.), c'est-à-dire que son temps est venu avec les projets chaque fois plus ambitieux de spoliation outre-mesure de ces réserves. Il nous a fallu produire une autre mythe, celle des terres vierges et non-exploitées au delà de la montagne, toujours plus loin, pour continuer d'y croire, lorsque le monde sans limites s'est montré à bout de souffle chez nous. Les mythes présentes de «solution technique» à notre excroissance de consommation suivent dans la droite lignée de ces abjects mensonges. En foutant des engrais artificiels sur des terres agricoles écrasés et compactés par nos tracteurs trop lourds, nous pouvons faire des calculs optimistes de productivité augmentée, pour arriver à des bilans net-positifs de «développement durable». Il nous faut juste trouver les moyens de créer une énergie sans limites pour que le système se relance - je pense à l'abondance de croquettes de chien qui pourraient mieux servir à alimenter les feux éternels de l'église de l'industrie, mais ces sacrés amateurs de la nature me lyncheraient sur les seuls arbres qui restent.
Le patchwork du paysage actuel nous peint un tableau qui ne correspond à aucune augure du futur.
C'est la non-fractalité de ce patchwork de champs qui nous démontre cette réalité, de nouveau. C'est les champs carrés d'un mile anglais pendant des milliers de kilomètres au Canada, avec des villes identiques, avec des magasins identiques, chaque mil de miles. C'est les franges de ce règne anthropique qui, comme les franges délabrées d'une aile de papillon migrateur au bout du voyage, mettent en évidence l'usure qui condamne le système. Ce système auto-organisatif qui à l'origine était fait pour «jouer les échelles» comme un jeu de ciseaux, papier, pierre, qui n'était jamais réductionniste, mais expansiviste, contre toute épreuve. Du passé. Ses noyaux d'interférence à petite échelle pouvaient «pulluler» à n'importe quel instant, sauf que les moments de leur interaction avaient de l'échelle, coïncidaient et divergeaient de manière à créer des foyers et des granules à la mesure de leur environnement – puisqu'ils étaient faits de et avec leurs environnements, en contact intime.
Les grands migrateurs, les oiseaux, les virus, les planktons et nous, les éléphants de mer, nous sommes des vecteurs et nous nous devons d'en faire un sens et une cohérence de nos interactions, d'exporter et d'importer des modes «à diffusion lente» dans un monde qui dorénavant décollera de rapidité sinon.
Les modèles statistiques ont du mal à traiter de cette réalité mais imposent leur camisole sur notre univers perceptuel. La météo utilise des modèles cellulaires qui créent des prédictions gros-plan de ce qui va se passer, au coût d'une consommation effarante de données. Les modèles climatiques et écologiques qui nous font si peur pour l'avenir fonctionnent de manière analogue, comme si le futur n'était qu'une projection du présent – rien de plus … simpliste.
La vie, non. Il suffit d'une seule mutation, à l'extrême limite de l'improbabilité, pour bouleverser le monde – (salut Covid!). On peut même oser dire que les principaux déterminants de l'avenir sont ceux qu'on n'a pas su anticiper ou comprendre ou accepter – bien que la meilleure manière de prédire l'avenir est d'essayer de le créer, avec ou sans connaissance de ses causes et de ses effets. Le monde humain s'est embullé, pour ne plus savoir cela, il se terraforme tout seul dans son coin, en splendide ignorance virtuelle.
Malgré tout la vie, dans ce sens, est expressément dessinée pour créer de l'exponentiation d'un presque rien – pour se reproduire, se multiplier, à partir de l'infiniment petit. Il faudrait vraiment que les pessimistes abandonnent l'espoir de se faire valoir, leur monde n'est pas du nôtre.
Les grains d'espoir réaliste se logent partout ou ils trouvent prise. Pour devenir des perles, leurs hôtes ont besoin d'une courbe d'oxygénation et d'alimentation régulière et pour qu'on les apprécie, ces perles ont besoin qu'on les récupère.
Il faut une tissu propice, une culture à même de faire fleurir des solutions écologiques réelles. Le conformiste industriel jette donc ses énergies dans l'élimination de tout sou-strate propice pour que l'avenir du possible soit mort-né. Il est pessimiste, sinon il n'est rien, il se défend en attaquant l'espoir, là où l'espoir a l'habitude de pousser. Sa récompense, les ronces.
Mais l'idée que parce que les probabilités sont là, le chemin logique doit les suivre, est ainsi invalidée. Plus on généralise l'infaillible statistique (comme s'il n'y avait que cela de scientifique), plus on se met en otage à l'inévitabilisme: le destin en tant que doctrine. Le problème avec cela est que l'on crée le monde de l'inévitable en s'appuyant pour la prise de décisions sur les analyses d'anticipation statistique qui le confirment – qui ne peuvent que projeter les probabilités -jeter les dés pour entraver notre avenir.
Cette analyse indique qu'il serait mieux qu'on arrive à parcelliser à petite échelle un monde de grande échelle, tout en maintenant le liaison entre les deux – que par exemple des grandes entités nationales et supra-nationales ne peuvent pas répondre à nos besoins collectifs, à moins de créer des cadres qui laissent le pouvoir décisionnaire à des entités cohérentes à chacune des échelles de dynamique localisable, pour y cueillir les fruits réflexifs après. Un jardin bien réfléchi n'a besoin que d'être laissé à se faire, la plupart du temps, pour qu'on cueillit ses fruits.
Des raisonnements: des protocoles; des cadres logiques: des itérations. Nous ne sommes que «des machines» à penser. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Instinct, intuition, sens commun.
C'est comme si chaque expression devenait le cible pour les salves de son ennemi. Si les gens se réfugient dans la non-raison et exècrent l'intellectualisme, ils ont des fois bien raison, pense-t-on - pas de bravoure sans sentir le succès.
Le problème est l'apparent déterminisme des cadres logiques proposés. L'être humain est sous attaque depuis que Freud lui attribue des déterminismes structurels mentaux trop fixes, un peu à la «Fairy Tales de Grimm». La psycho-analyse nous achève – cherche les raisons de cœur supposément innées et enfouillées pour débusquer une raison devenue extrinsèque, déclarée, … analysable.
Ce sont les britanniques les plus résistants à cette vague d'absolutisme raisonnée qui ne donne pas son nom. «Soyez raisonnables» disent-ils, lorsque les extrémistes de la raison absolue tentent de les épingler. «Quand même, …!», ou «C'est un peu limite».
Peut-être toutes ces expressions ne veulent qu'exprimer l'importance du jeu et de la nuance, face à la rigidité dite «cartésienne». Cette rigidité peut se voir dans tous les dogmatismes, y inclus celui de «l'esprit» administré en antidote à «la raison». Le corpus de culture que j'ai stigmatisé de l'épithète «britannique» est important parce qu'il ne se réfugie pas dans l'absolu et il ne tente pas non plus d'abolir l'emploi de la raison, mais plutôt de chercher «le juste milieu», aussi inconfortable qu'il soit. Il est en fait adaptatif aux absolutismes auxquels il a du faire face – il sait maintenir le cap (une certaine cohérence) face au vent de proue.
«Vive la différence» est une expression très bien connue et très souvent utilisée en Angleterre – elle est, bien sûr, toujours exprimée en français - c'est l'une des rares expressions en langue française qu'on maîtrise. Il n'est donc pas tout-à-fait par hasard que Darwin a eu les moyens intellectuels de comprendre que pour que la spéciation et l'adaptation aient lieu, l'isolement, bien que temporaire, des populations, plutôt que leur constant métissage (brassage), soit un prérequis. Les anglais ont tendance à s'identifier avec une certaine fierté comme «nation bâtarde» – c'est a dire très métissée – ce qui est absolument vraie, surtout au niveau de leurs multiples cultures, qui se maintiennent en tension mutuelle. L'agnosticisme britannique dépasse de loin le sens de ce mot, se crée sans état laïc et sans état d'âme.
Il est dommage que le «Brexit» provoque un retranchement européen, à la lumière de cette analyse. L'Angleterre, dans sa digestion interne des empires externes, ne fait que miroiter notre sort collectif. Nous souffrons des mêmes maux que tout le monde, même un peu plus, et le mot «patchwork» s'est ré-employé d'abord en Angleterre pour décrire notre système champêtre, notre système d'«enclosure», qui s'est universalisé depuis … et comment! C'est sans doute, à l'origine, une adaptation culturelle à une démographie potentiellement affolante et aux tensions « cocotte-minute» qui en écoulent – préfigurant en symétrie fractale l'affreux élan démographique du monde entier - alors que nous avons déjà «immobilisé» notre campagne pour soutenir notre richesse, en rêvant d'ailleurs.
Lorsqu'on parle de «conscience collective» au singulier – de la transmission, de nos outillages et de nos technologies, il est légitime de se référer à des corps de connaissance culturelle comme celui des britanniques du fait qu'ils ont souvent étés les premiers à souffrir un mal de la modernité et ont donc eu plusieurs générations de génération du savoir-faire adaptatif aux problèmes – le paysage est ce qu'on peut appeler l'empreinte de sa «mémoire institutionnelle», pour le bien et pour le mal.
Le pays a en plus la qualité d'être assez grand, en termes de population et de convolutions côtières, pour modéliser vraisemblablement des problèmes à plus vaste échelle. Il est intéressant de noter l'imitativité des américains – sur leur îlot-continent – à cet égard, souvent plus anglais-parodie que les faux-anglais autochtones n'ont su l'être – puisque la présence de puissances continentales de l'autre côté de la Manche n'a jamais cessé de nous absorber l'esprit. Plus on est loin ... pour les écossais, le Continent représente la salvation de la gueule de «Big Brother». Le trop-absolutisme rationaliste, l'empirisme littéral de l'âge des lumières, sont le propre du collectif européen qui, de fait, occupe le continent nord-américain. Lorsque cette plaque continentale rencontre les premières bastions de l'Europe – les Îles Britanniques, elle fait des dégâts culturels: elle germanise, elle franchise, elle hispanise, elle lusitanise, elle latinise, pour ensuite être labellisée «anglo-saxone», une amalgame on ne peut plus paradoxale. L'Angleterre observe, sentinelle de l'Europe de toujours: elle fait le gué.
La pieuvre nous donne des leçons sur la transmission et la sociabilité. Il est très intéressant de noter que ses petits, pendant qu'ils sont encore dans l'œuf translucide, enregistrent et sont formés par ce qu'ils observent et expérimentent dans la tanière de leur mère attentive. Les êtres humains sont nés «prématurés» – comme les petites pieuvres ils observent et ils enregistrent – ils «goûtent» à ce qu'il y a autours d'eux avant de devenir «acteurs» à part entière dans le grand monde. Pareillement aux britanniques – la deuxième phase dans l'apprentissage des pieuvres est de se trouver jetées dans les écumes des vagues en «flotsam and jetsam» («cannon fodder») pour des voyages qui ne peuvent que leur faire apprendre l'importance de l'adaptation à l'aléatoire dans la vie.
Dans le meilleur des cas, on rentre ensuite chez soi, bien équipé pour construire une vie casanière. C'est ce que font les pieuvres, en tous cas. Chaque nuit, ils sortent de leurs tanières, pour faire des promenades autour de leurs territoires chéris, en sentant la houle qui se défoule jusqu'au loin.
Or, la pieuvre est notée et notable pour être solitaire – avec les congénères il n'y a que peu de commisération – et plutôt en fin de vie. Elles peuvent cependant être grégaires – et leur «capacité» interactive est étonnante – changements de couleur, de texture et de forme, selon l'identité du prédateur ou de la proie qu'elles rencontrent. La «sociabilité» est déversée, dans leurs cas, surtout dans l'interaction avec plusieurs autres êtres – à part leurs congénères, si ce n'est que pour les maintenir à distance.
L'entre-soi d'une pieuvre est également très intense, elle a huit bras quasi-autonomes avec des milliers de ventouses collaboratrices, trois cœurs, deux yeux autonomes et des neurones partout. Le bas d'une pieuvre est plein d'intériorité tandis que le haut, à part, sert de plateforme aux yeux et le tout peut ou marcher ou se propulser moyennant son siphon et sa «jupe», ou encore s'insérer dans le plus petit des trous. De quoi se divertir tout seul, à l'infini. Les êtres humains partagent des facettes de ce jeu entre l'image mentale et l'interactivité dynamique, la plasticité de l'imaginaire et l'exigence du réel. Laisserons-nous la fractalité de nos vies nous échapper, par désir de l'autonomie absolue inatteignable? Pieuvreusement, j'ai l'espoir du contraire.
«Trial and error» ... «destructive testing». La méthode scientifique suppose que l'on vérifie les hypothèses dans le monde réel - que l'on mesure les résultats dans le champs. En ceci, la dérive du scientisme a beaucoup en commun avec les «idées reçues», le «sens commun» et la tradition. A force de ridiculiser les us et coutûmes qui n'ont pas de base «scientifique», nous éliminons des corps de savoir faire importants ... tout en en infligeant d'autres qui n'ont que peu de temps opératif, en nous assénant de leurs lois de causalité rudimentaires.
C'est par rapport à soi qu'on est fractal, finalement. On peut commencer par dire que c'est en interaction avec ce qui est le plus proche de soi que se bâtit la structure fractale, l'alterité la plus proche - la complémentarité, antagonisme, mutualité la plus proche, les sosies de soi. Les pieuvres et les humains vont beaucoup plus loin. Ils peuvent se contenter pendant de longues périodes avec les histoires qu'ils font courir dans l'intérieur de leurs machines à rêves, leurs têtes et leurs corps, une sorte d'involution du monde externe, un animisme affûté à l'énième.
L'indéterminisme causal réquiert ce dynamisme précaire. Les neurones miroirs signalent la moindre asymmétrie ou faille dans un dessein, elles s'alignent face à ces fentes dans la réalité plausible. Pourquoi un si grand nombre de neurones - nos cerveaux sont-ils un genre de cancer? Nos cerveaux, pourquoi ne prennent-il jamais de pause? Plus ils ont de l'information, plus ils en extrayent de la pertinence. Quel est le gain, dans ce tri incessant, interminable? Cela ne nous laisse même pas le temps pour réfléchir, c'est les rails qu'il nous faut observer, pour rouler dessus, voilà tout.
Les renouvelables, le développement durable, ces vieilles dogues. Le scénario fait songer à une histoire d'avion perdu dans les Andes avec un équipe de joueurs de rugby dedans. Les survivants ont leur esprit de corps, leur vigueur comme atouts. Ils les convertissent en cannibalisme. Ayant consommé leurs camarades, les derniers survivants pensent finalement qu'il vaudrait mieux sortir de là. Soyons positifs, comme eux! Mais pas juste pour masquer la déroute, l'effort requis est de relier la positivité aux raisons pour l'être. N'ayons pas peur de notre pouvoir démocratique - il est basé sur l'alternance! L'échelle du catastrophe déferlant commence à correspondre au cycle electoral, tellement il raccourcit - même un politicien raisonnable peut s'y risquer un peu dorénavant - à dire que le développement durable ne durera point - qu'il faut quitter l'avion.
J'ai toujours eu l'impression que les mots avaient un usage similaire aux pierres dans une rivière ou sur une côte. On saute, de l'une à l'autre, en perdant de vu la fin du chemin, pour se concentrer sur l'équilibre précaire de chaque bond en avant. On avance ainsi très bien, pour atterir pas trop loin du point visé, sans réelle intelligence du chemin qu'on a parcouru. C'est même une méthode: on choisit le cap, on met l'autopilote, on dort. Mais la barque, la barque, il faut la quitter!
mercredi 24 février 2021
«écraser l'autre avec sa science»
«je le savais»
«après coup»
«gros problème de timing»
… mais encore plus gros si on l'avait dit correctement, en anticipation, la double erreur d'avoir raison, pile et face, devant ses «tort»ionnaires.
L'excès d'immodestie devient modeste – et après?
Les «tentatives de domination» deviennent quoi?
Lorsqu'on participe à ce jeu qu'on ne peut pas gagner, il ne reste que la parodie.
Les universitaires s'en tirent le mieux – mais bien sûr – ils ont affûté l'art de la parodie au point que le bafouage de leurs dignités les plus vraies ne fait qu'aiguiser le couteau de leur dédain. Ce ne sont pas des piègistes, avec les mots ils peuvent faire des jeux ...
… pendant que France Culture, sur ses rails invisibles cherche des experts extérieurs pour dire l'indicible chez eux, en faisant que cela reste ainsi dans le légèrement non-dit – on l'a juste traduit.
Le droit d'en tirer bénéfice, de son lopin de terre – le propre des américains du sud et des espagnols, devient le droit à l'emploi devant ses pairs anglo-saxons, chacun le stéréotype porteur de sa culture.
Avec le revenu universel, les logiciens européens pensent éviter l'esclavage salarial.
Comme un fleuve paisible, la radio eunuque promeut des politiques fixes la longueur de la journée.
Je le savais, … diraient-ils à chaque reproche, …
Et oui, mais vous ne le disiez pas …
On ne pouvait pas le dire, sans perdre la cote
Et oui, et vous le disiez, ça?
Ou vous le faisiez dire d'autrui, en les ridiculisant, dans le dit?
Il est déjà un acte de mépris de non-dire que les américains automatisés ne font pas concurrence à leurs pairs, sinon aux machines de la vente aux enchères, qu'ils n'ôtent pas l'argent de la bouche des bons bosseurs, mais au contraire ne cherchent que l'auto-money qui les assimile au rêve.
La dissonance cognitive n'est pas ici produite par des publicitaires sinon par les meneurs du cœur de l'opinion du service public.
Le «droit» d'un paysan de l'Amérique du Sud à tirer profit de son lopin de terre, c'est le terroir de Bolzanaro, c'est ce qui le rend, chez lui, où les latifundia s'étalent, inattaquable par des écolos étrangers qui en parfaite incohérence demandent à réserver ces terres à des indiens vouées à l'extinction auxquels ils profèrent des marques de noblesse partagée.
La solution existe, mais elle ne peut pas être dite. Le seul travail irremplaçable humain capable d'absorber les masses qui a du sens écologique ici et là est celui de la répartition des latifundia en œuvre d'homme et du vivant. Sans réserve. Sans sub-primes.
été 2020

Ce serait une erreur de croire que la Pelouse tient au-dessus de tout toute seule, ses racines pendant dans le vide des murs écroulés. Elle est le symbole même du pastoralisme, mais le calcul n'est plus économique, ni productif, sinon esthétique, voire éthique : une tentative de figer le moment nostalgique de l'éternelle Nature.
On vient ici pour débusquer le silence et le dénuement humains, comme s'ils étaient des trésors d'une valeur inestimable. Le collectif de l'Estive collabore, en réalité, dans le but d'empêcher la restitution des ruines et de leurs cultures potagères, leurs champs de céréales vivrières, leur familles, leurs enfants qui y vivent. Le « tout bétail » met sous le sabot chaque mouvement visant à démonoculturiser l'affaire. La Monoculture fait régner la Paix : c'est, après tout, l'aspiration de toute hégémonie collective, de toute dictature consensuelle.
La Vallée de Liers est le pays des Versantiles – chaque versant comprend jusqu'à 1,000m de dénivelé. À mi-pente on a vue, à un kilomètre de distance, sur un pays où on ne va jamais, l'autre versant de sa vallée.
Comment articuler un pays de « randonneurs » ?
... chemin faisant ... chemin vers ... chemin versantile
Dans les Andes, les ancêtres des Incas et des autres civilisations andines vivaient un ordre socio-géographique au vertical, gouverné par les transhumances périodiques entre des « paliers » écologiques : en bas le maïs, là où l'irrigation le permet, en haut les patates, pour pouvoir les sécher et les stocker.
Au Port, en principe, chaque maisonnée a une étroite découpe, du bas jusqu'au haut, de paliers écologiques qui se travaillent à diverses époques de l'année. Selon Le Journal d'Ici (№ 27, mars 2020), en 2010 le Massatois comprend « 2268 ha en SAU (Surface Agricole Utilisée), dont 2248 ha en herbe à bétail, 10 ha en terres arables et 5 ha en cultures pérennes (fruits) ».
L'ouverture des estives au véhicules rompt à peu près totalement cette obligation de transhumances concertées, permettant aux sédentaires que nous sommes de nous cantonner dans de petites parcelles cadastrales ombiliquement reliées aux « sources » que sont devenus les supermarchés d'en bas, l'Estive prend le reste.
L'origine de ces maintes parcelles cadastrées est, comme au Port, la connectivité de ses paliers écologiques, l'échange et le partage de biens et de services se fait sur place, dans le détail.
Tombées sous le joug de la civilisation véhiculaire supermarchisée, le sens même de ces parcelles et subverti à diverses causes, celle de la propriété immobilière, celle des amateurs de « La Nature », celle de ceux qui aiment les vaches, les ovins les caprins, les desmans.
Ces objets de nos affects symbolisent notre « intégration ». La fonctionnalité manifeste des orris, des granges et des petites maisons parsemés sur les versants – qui est de mettre à proximité et en collaboration ceux qui entreprennent les maints travaux physiques de la vallée - est totalement bafouée par nos dépendances à distance, qui nous font consommer à un niveau qui ne pourrait jamais être atteint par la vallée elle-même. Et pourtant, cette même vallée serait capable d'absorber, sans frémir, dix fois plus que sa population présente, sans cette consommation dédiée aux véhicules.
Comment faire évoluer une estive pastorale et potagère, pastorale et céréalière ? Déjà en confrontant les « estivants » à leurs propres incohérences d'amateurs de la Nature. La Pelouse ne peut pas longtemps supporter la population actuelle de bétail, ni est-ce supportable.
La Vallée de Liers a un atout écologique : ses habitats ruinés et son absence de viabilité carrossable permettent l'essor d'une économie humaine qui prend partie pour la nature de manière intégrée, pouvant servir d'exemple à d'autres milieux ruraux dépeuplés.
hiver 2020

Je me réveille à 7h moins 10. Silence. Quelques étoiles. Le soleil se lève à 7.31. J’allume un petit feu de cuisine, la radio. Peu après 7h, un bruit étrange, un peu de mouvement dans le branchage. Et le bruit. C’est comme un TGV, et bientôt plusieurs TGVs et je vois le grand chêne FLÉCHIR vers l’ouest – ce qui n’arrive jamais – et LA RAFALE est sur nous, et des craquements d’arbres qui se cassent comme des pistolets partout.
Ce que je viens d’expérimenter est un phénomène météorologique qui s’avérera de plus en plus fréquent. Dans l’Ariège on est un peu à l’Est du centre des Pyrénées. L’aube touche d’abord à l’Est, mais nous sommes encore sous le coup du refroidissement matinal – la différence de pression entre les terres touchées par les premières lueurs du soleil et celles encore en refroidissement à l’intérieur est maximal. Des deux littoraux, méditerranéen et atlantique après, les fronts de vent courent pour se rencontrer au milieu de la chaîne, mais nous ne sommes pas au milieu, mais un peu à l’Est – côté aube. Et la météo le dit : ciel dégagé, en région côtière méditerranéenne et dans l’Est de la Corse. Et il fait sec – et même chaud – on est quand même au début mars …
Tous les arbres se construisent ici pour contester les vents prédominants – de l’Ouest. Et ils n’ont même pas eu le temps de se raidir – là sur le chemin de retour en vélo, partout je vois des arbres brisés – les plus grands et ceux en lisière, là où on fait les travaux, là où il y a eu de la coupe, au bord des routes, laissant les troncs des grands exposés. Ces arbres sont devenus stupides – mais ce n’est pas de leur faute – et de toute façon – et de toute façon, c’est leur rôle de se sacrifier pur la nouvelle génération qu’ils maternent. La mer fouettarde prend tout. Vive les haies !
Ce texte a été écrit sur place, sous le coup de l’expérience. On a du mal à apprécier pleinement un phénomène écologique sans être dedans – touché viscéralement par le vécu, à mon avis. Plus loin sur la route,dans la tempête, j’étais en train de regarder un grand et beau sapin qui s’est déraciné et cassé en deux, emportant un autre conifère derrière lui, sur une aire de pique-nique. J’ai vu des cantonniers arriver – trois, dans un camion, qui se sont arrêtés pour observer les dégâts. L’un des trois est sorti, en frissonnant.
L’arbre de plantation « scénique » est tombé, en effet, parce que ses racines, moins profondes que celles des arbres caduques, n’avaient prise que sur du gravier malengoudronné – et parce que l’arbre, plus élancé que les autres, portait ses aiguilles à une saison où les adventices du coin étaient nus, ainsi offrant une surface optimale au vent.
« C’est bien coincé, vous n’allez pas le bouger sans treuil » je leur dis. « Il nous faut le tractopelle » il répond, et puis « il fait trop froid pour rester ici dehors » et il monte dans son camion chauffé, sans corde en acier et sans treuil. Actuellement, on déblaie les lisières des routes à 10 à 20 mètres de chaque côté, « pour ouvrir le paysage », laissant des troncs de dix à vingt mètres exposés au vents. On « nettoie » les fossés avec des grosses machines, on roule sur le talus,laissant des hématomes dans le sol, les écoulements d’eaux boueuses se creusent quand elles ne se bloquent pas, les routes s’affaissent …
Et partout, les arbres tombent.
Vous comprenez, j’en ai un peu marre – ils sont payés pour ça … Peu à peu, malgré eux, ils commencent à faire des élagages qui commencent à ressembler à des haies, à fur et à mesure que les arbres de forêt qu’ils ont exposé en lisière tombent sur la route – ils sont bien obligés … peut-être ils ont oublié qu’un arbre, ça pousse ...
1 mars 2014
On a parcellisé la terre, et ainsi faisant on a déchiqueté notre milieu de vie. Aussi grave que cela puisse paraître comme constat, ce n'est pas loin de la vérité.
Le Vivre avec la nature n'est pas toujours facile, surtout lorsque le taux de déprédation arrive à un certain seuil, imaginons que nous sommes tous des grands nomades, les chevaux, les chèvres, nos familiaux et nous.
Nous ne sommes pas faits pour manger en surface contenue, sinon pour brouter au large, sur des surfaces énormes, pas autant des territoires sinon des couloirs de passage entre les pâturages saisonniers. Nos grands cerveaux servent d'atlas de randonnées dans notre parcours de vie. C'est, en quelque sorte, notre intelligence commune.
Et tout cela s'écrase lorsqu'on nous contient, d'autant plus si c'est dans des logements serrés. Nous avons besoin d'espace, mais en tant que bons sédentaires, c'est au mètre, hectare ou kilomètre carré que nous nous bornons. Ayant perdu l'esprit du broutage intelligent, nous sommes devenus des bovins paisibles, alimentés ... allez, gavés comme des oies, notre fonction dans la vie, être consommateur, et ainsi faire tourner le monde du fric. C'est, dans le cadre présent, notre devoir citoyen.
Qu'est-ce qui se passerait si on cherchait à étendre les liens, d'abord entre et dans les biens - les surfaces desquelles nous construisons notre monde conceptuel, nos espaces vitaux, nos territoires notre chez nous, et ensuite en cassant les rectangles, les barrières, les clôtures, les murs qui ne servent qu'à nous séparer?
Pour les remplacer avec quoi? Au plan physique, des chemins à l'échelle humaine et animale, au bord desquels on broute et on trouve de quoi vivre. Le chemin est dans les termes du biotope une lisière, c'est-à-dire l'un des endroits les plus productifs, tant en vie animale que végétale, construite de plusieurs couches tant verticales qu'horizontales, ayant comme définition même d'être à la marge.
Ici j'explore l'idée assez géométrique de points et de tracés, traces ou chemins, les points étant des formes de vie telles que nous-mêmes, ou le tronc d'un arbre, en coupe latérale, les chemins étant simplement des parcours, des lignes. J'oppose ces idées à l'idée de l'occupation de plus en plus d'espace et de volume. Si ces concepts étaient adoptés par suffisamment de monde, ils pourraient réduire d'un coup le besoin apparent d'une consommation acharnée - et ils pourraient le réduire de manière dramatique, de plusieurs fois moins que dans l'état actuel des choses.
Le lien physique prendrait le relais du bien - le monde capitaliste dans son incarnation actuelle s'évaporerait comme s'il n'avait jamais existé.
Le besoin politique présent de restimuler sans cesse la méfiance à l'égard des dépendances sur d'autres êtres humains - le culte de l'autonomie - la production de l'insécurité afin d'atomiser la résistance politique pourraient être remplacés par la confiance du lien - chacun d'entre nous en chaque autre qu'il connaît et qu’il rencontre – la loyauté, la solidarité, comme des biens publics d'une valeur réelle.
Ce qui est notable de l'époque industrielle, née de l'Age de la Lumière, c'est l'abandon du lien transversal et son remplacement par un ordre - une hiérarchie absolue. On pourrait dire que dorénavant notre pensée est restée dans la camisole de la propagande contre le féodalisme qui a inauguré l'âge de la lumière - il fallait militer contre et oblitérer dans la mémoire collective l'idée féodale du lien, jusqu'à nos jours cette dépréciation systématique tient bon. Les exceptions sont clés - le mariage et le lien de l'enfant avec ses parents sont attaqués mais difficilement par les champions de l'âge de la raison.
Nous ne sommes que des points, nous nous rencontrons et nous partageons l'infime comme s'il était synonyme du monde entier, nous n'avons pas besoin de plus que ça
... et cependant, la nature qui nous entoure ne peut pas se déplacer en Auvergne, faire un transfert de ses biens à destination de New York, casser son propre écosystème et avoir l'espoir de perdurer, déménager et en trouver un autre.
La nature est, de toute apparence, assez sédentaire, dans ce sens. Comment donc vivre léger, vivre libre et à la fois participer au bien-être de la nature autour de nous?
La tâche se facilite du fait que des points qui ne cherchent plus à occuper de l'espace, ou tout au moins de l'espace constant, réduisent de beaucoup notre fardeau parce qu'il y a moins de tâches - on a des sentiers à entretenir, mais on peut facilement s'en passer de plusieurs œuvres de construction et aménagement qui sauront être dépassés par la réduction des besoins humains.
Et il se passe que la modélisation de ce possible avenir errant démontre que la défense de la nature, dans ce cas, est aussi la défense des milliards de gens aujourd'hui sur la planète. Plus on réussit à utiliser l'intelligence et le lien humains, plus on rend l'humain nécessaire et fonctionnel. Le paysagisme bio, la co-responsabilisation et le partage sédentaire-nomade des tâches d'entretien des terrains dont les deux tirent bénéfice rendent obsolète le conflit des intérêts qui existerait dans un système concurrentiel. Une fois les éléments de base introduits, calculés pour être efficaces en termes d'énergie humaine, on gère la nature jusqu'au point où elle sait se gérer toute seule, en harmonie avec nos besoins tant récréatifs que productifs.
c. automne 2019
Ceci, par voie de présentation du « projet global » écologique que je tente de mener, tant bien que mal, ces quelques dix années durant.
Le mot « infrastructure » est critique, l’expérience que je mène ne conçoit de l’individu que dans le prisme de l’entre-nous, avec l’idée, en plus de cela, d’« extra-personnaliser » les opérations de chacun, vu que, bon gré mal gré, c’est l’altérité de tous dont on dépend et qui nous concerne.
Il va presque sans dire que le mot « écologique» nous pointe notre avenir collectif – ce qui justifie l’emploi du mot « infrastructure » - de l’entre-nous, comme préoccupation principale de l’écologie, non pas les actes de chacun dans sa bulle. A la fois, il faut peut-être noter, vu la tournure chaque fois plus "gestionnaire d'en haut", "flux", "traçabilité" et "puçage" que prend notre société que l'auteur y est tout-à-fait opposé - l'entre-nous c'est vraiment entre nous - et en plus ça marche mieux comme ça.
Le danger de la technicité n’est pas tant qu’elle soit faisable ou non, sinon que, dans le cas de sa faisabilité, elle se substitue au « nous » - au monde du vivant tel qu’il s’imbrique, s’extirpe et s’articule de lui-même. Cette perte d’agencement, par individu et par groupe, est aussi une perte d’existence « fonctionnelle », une perte de motivation engrenée dans ce monde. Le verbe « pouvoir » et son contraire, l’impuissance, décrivent la globalité de cette situation gravissime, lorsqu’elle touche à notre pouvoir décisionnaire sur notre sort. La technique nous donne des leviers, le « nous » nous donne la raison des leviers.
Ce qui est à proposer est une trame organisatrice de nos vies qui nous permette de reconstituer cet engrenage qui fait bien fonctionner la vie ensemble.
Or, la conscience de notre place dans le monde a été flouée par la banalisation de notre utilisation très prodige de l’énergie. Exemple : un être humain de 70 kilos, consommant 60 Watts par heure, se bouge dans un véhicule de 1,200kg (20 fois plus de poids), consommant 10,000 Watts (10kW) par heure (100 fois plus d’énergie). Et puisque le monde s’est adapté, ces derniers temps, plus à la voiture qu’à l’être humain dedans, lorsqu’il sort de son « véhicule », il se trouve dans un cadre « voiture-friendly » qui n’est plus à la mesure de ses capacités inhérentes. La perte de cadence fait aussi son effet – ces mouvements s’opèrent de manière saccadée, intermittente, ponctuant l’allure et les rythmes plus humain-adaptées.
Tout s’absorbe, comme par des éponges grandissantes, par les consommateurs fonctionnels du capitalisme, tel qu’il existe.
Si les gens s’exercent à paraître heureux et performants, dans ce monde de désœuvrement physique et intellectuel, c’est qu’il devient de plus en plus difficile de ne pas se sentir déprécié et inepte, sans l’assistance de machines de tous bords. On continuera de faire mine de conducteur, même éconduit.
Les animaux domestiques peuvent nous donner des idées claires sur ce qui nous attend, puisque nous-mêmes, nous sommes devenus des animaux domestiques par rapport à ces constructions à une échelle qui paraît nous dépasser, tant intellectuellement que physiquement. Ils se focalisent, comme nous, sur le confort, sur l’aisance et sur la sécurité. Nous devenons des mailles dans une société d’émail, consentants.
La démocratie, notre version présente, intrigue aussi, il ne peut pas nous échapper qu’elle est chiffrée à la enième – pourquoi vouloir plutôt mettre sa foi dans les chiffres que les gens ? Une raison potentielle – se défaire d’une responsabilité quelconque dans l’affaire.
3 mars 2020 (rev. 201109)
J’essaie de me mettre (pile-poil) là où ça fait le plus mal, écologiquement – systématiquement. Je suis très mal compris. C’est un travail. Cela me permet, mon nez devenu affûté, de décoder les maux écolos, d’en témoigner, d’ébaucher des solutions – pratiques, faisables dans le vrai monde anti-écologique d’aujourd’hui. Je pense que si des gens connus, bien vus, se joignent à mon « entreprise », la boule de neige ira croissante. Pourquoi je le crois ? Parce que je l’ai planifié ainsi et c’est mon métier. De plus que, l’ayant pratiqué, sans argent, sans essence, sans portables, depuis bientôt huit ans, ma survie en témoigne, de sa « faisabilité » - mieux dit « viabilité » dans ce monde – et pas un autre.
1. étant donné que les mots « confort » et « facilité » sont devenus la monnaie courante et le leitmotiv de notre époque de mort cérébrale et physique - et de dégoût mutuel … le système doit favoriser ( faciliter ) et rendre enthousiasmant tout ce qui est vraiment écologique D’ABORD. Je sais que je parle à une société de toxicomanes et que ce n’est pas « facile » d’abandonner sa drogue – mais c’est en « ayant fait » que je le sais, je ne parle ni au conditionnel ni au futur. Pour « mater » l’anti-écologisme, il faut jouer le jeu de société de l’échec (écologique), avec bonne foi et fierté humaines – oui, c’est une guerre, une guerre contre la violence.
2. Le terrain, c’est toute la surface de la terre, le désert rural existe parce que, logistiquement, on n’a plus moyen de l’investir sans le détruire. Les brigades « pas toucher » de la « conservation de la nature » existent parce qu’on a l’impression qu’on brise tout ce qu’on touche – on a perdu la capacité de vivre dans et interpénétré par la nature.
Les boucles de rétro-action humaines que je propose (les Boucles de Marché, avec leurs espaces de partage et leurs gîtes de passage), sans argent, sans essence, sans portables, résolvent ce problème. L’empreinte écologique de quelqu’un qui marche « rentre dans les clous » écologiques. Le paysage redevient vaste et abordable, la pression démographique (la haine d’autrui, le racisme en sont des exemples) cesse de faire obstacle à son rôle de pôle d’attraction démographique.
3. Les gens de la ville viennent à la campagne. De cette manière, ils remplissent, de plus en plus, les fonctions à présent occupées par les machines en campagne. A moindre coût. Ils ne doivent plus assumer les charges de voiture et de communication qui mangent la marge de toute entreprise rurale actuelle. Et du fait qu’ils bougent, ils ne menacent pas de s’installer ou de déplacer les populations locales, sinon de les desservir ! J’ai noté que les gens de la campagne aiment voir des jeunes actifs, si les termes sont respectueux et de profit mutuel.
Pour créer ce « pied dans la porte » de l’anti-écologisme croissant, il faut des « équipes » de gens résolus, déterminés, visibles – avec des tâches bien spécifiées. En utilisant l’infrastructure des stands sur les marchés, des équipes d’étudiants dentistes ou médicaux, des cartographes (géographie humaine), des botanistes, des apprentis-chefs, des écoliers, ... peuvent, en formation, en stages, en « école linéaire », peupler le réseau et établir des permanences entre plusieurs – des normes « culturelles » qui n’ont plus rien à voir avec les normes de mendiant nomade avec lesquelles on a hâte de stigmatiser tout itinérant avoué (« SDF »).
Il est évident que je vise aussi une enveloppe « structurelle » capable d’emmagasiner les populations bourgeonnantes qui se déplacent – y inclus les réfugiés climatiques auxquels on s’attend – mais à profit mutuel – à la fois des humains et du reste du vivant qui n’attend, lui, qu’à nous embrasser, comme si tout ce « fauchage » et « oblitération » ne fût qu’un mauvais rêve.
La Vie sait très bien identifier un ami – ou un ennami.
Le propos de cette initiative n’est pas tant d’éliminer tout usage actuel des machines – pour cela on ne peut pas l’accuser d’être révolutionnaire dans le sens d’un catharsis abrupte et destructeur – qui viserait la création de « vides » à remplir.
J’envisage simplement d’établir un « rapport de force » où on n’est pas l’esclave de la machine, « indenturé » par l’argent. L’argent suivra, là où nous menons, sa valeur nous reconnaîtra. Cette loi du marché, en marchant nous la créons. C’est pour dire qu’il n’y a pas de prise de position dogmatique, doctrinaire, par rapport aux idéologies existantes (et défuntes, résiduelles). On ne cherche pas à dénicher les autorités existante, on cherche à travailler avec … La peur d’autrui, de l’inconnu, s’aborde « sur place », les actes et les mots font synthèse.
J’appelle ce système, en trois mots « pluri-cultures, co-hérences, ex-titution ».
un cadre non-monoculturel en faveur de la coexistence
Partage des l’héritage commun,
respect de la cohérence de chaque entité,
à chaque échelle
S’extraire des institutions existantes,
en recomposer nous-mêmes,
à notre échelle
c. 2018
Dans un monde écologique, l’écologie s’insère dans toute prise de décision, surtout celles qui concernent l’infrastructure choisie.
Par commun accord, nous devons changer de système – de pensée systémique, à une rapidité inouïe, en termes de notre culture, de nos habitudes, et de leur expression physique.
Prenons l’exemple du feu.
Depuis l’aube du temps, l’homme fait des brûlis pour dégager et fertiliser la terre qu’il cultive. Slash-and-burn – agriculture sur brûlis. Et cela continue – mais pour sauver le monde du vivant, c’est l’une des choses qu’il faudrait arrêter.
L’exemple est parlant. Cette technique de culture sur brûlis existerait depuis qu’on sait faire du feu. En temps moderne, on brûle les feuilles, les déchets végétaux, les restes des récoltes dans les champs. Et c’est très dur de faire autrement, c’est devenu, ou presque, un instinct, une partie de notre code génétique, mémoire collective, mémoire ancestrale.
Nous devons, comme priorité, diminuer drastiquement notre consommation d’énergie, par rapport à la moyenne actuelle – lorsqu’on ne brûle plus la végétation, pour la laisser composter, on fait cela – cette méthode permet de retenir plus d’éléments utiles que le brûlis, et elle permet de les garder plus humides, plus longtemps – en « ralentissant » le cycle de consommation.
« Mais non ! » criera-t-on, « il faut brûler le bois mort pour ne pas avoir d’incendie ».
Comme je l’ai observé, changer les cultures de pensée profonde n’est jamais facile.
Pour nous, les moteurs à combustion interne continuent d’exister, et pour à peu près les mêmes raisons que le brûlis persiste. Les coûts de l’opération sont merveilleusement externalisés. Les profits, non.
Parlant du modèle industriel ou du capitalisme, de l’économie de marché ou de la liberté de commerce, on parle de systèmes qui ont en quelque sorte toujours été, comme propriétés émergentes de notre vie « en société ». On peut essayer de les changer ou de les remplacer – alors que cela donnerait peut-être de meilleurs résultats de s’adresser aux fondations dont ils émergent. Un système économique est fondé sur des valeurs, ou il n’est pas.
Notre société est vectorielle. Une supposition en forme de constat. Elle l’est logiquement, puisque tout ne peut être transmis que par des mouvements, physiques, réels, dans le temps et dans l’espace, tantôt grands, tantôt petits. L’information, ce qui permet à la vie de se constituer en cohérence avec elle-même et autrui, elle bouge, suivant la règle : tout bouge, tout est vectoriel – DONC.
Il s’ensuit, dans ce système vectoriel, que les valeurs de mouvement relatif deviennent critiques. Un prédateur n’a besoin que d’une certaine force pour en terminer avec sa proie. Un rapport de force excessif ne sert à rien, sauf à être obligé à consommer plus. S’il est facile d’obtenir de l’énergie, on peut consommer plus, pour rester compétitifs il faut que les autres consomment plus, et ainsi naît un système économique.
Il est basé sur des nécessités économiques.
c. 2019
Selon comment on les conçoit, on peut déterminer si l'un ou l'autre est hors-cadre – ou encadré.
Un cadre auto-déterminé est un cadre. Un cadre prédéterminé ou imposé est un cadre.
Hors cadre est un cadre – un peu douteux – il ne peut se définir que par rapport à un ou des cadres.
Hors piste tu suis quand même ta piste – tu la traces aussi bien si tu suis dans les traces des autres sans le savoir.
Ce sont peut-être des jeux sémantiques – mais gare à celui qui manipule l'un de ces mots pour le donner – à travers un sens restrictif, un sens général non-contingent (un sens générique).
Comme si les chemins existaient pour aller quelque part – plus loin en tous cas …
Un chemin, piste, acheminement est sûrement un encadrement. On a du mal à le concevoir autrement, on ne peut pas suivre deux pistes à la fois, en être singulier.
Et l'algorithme, la chanson, le film et la symphonie ne sont que des entités composées de constituants individuels. Une foule ne peut être « foule » que si elle est composée d'individus. Sinon, ce sont des soldats – qui marchent « synchronisés » - et encore … ?
On est en train de décrire des phénomènes qui changent – « dynamiques » (= qui bougent, qui sont plastiques, mobiles), composés d'éléments particuliers qui ont des rapports les uns avec les autres – qui varient parce qu'il y a mouvance.
Le mouvement crée le changement. Le changement crée le mouvement.
On peut constater l’existence d’un phénomène dynamique – un vélo est en équilibre dynamique, cet équilibre ne change pas, tant que le mouvement nécessaire existe – l'effet gyroscopique ne cesse qu'à l'arrêt.
Et s'il n'y avait pas de cadre – la gravité, la friction, la force des jambes sur les pédales, le vent d'en face - le cadre du vélo ne bougerait plus, sans effets encadrants.
Est-ce que les gens bougent parce qu'ils aiment bouger ? On dirait que « oui ».
En tous cas, ils s'arrangent pour bouger … ils ne sont pas des moules.
Faire bouger les choses « pour soi » - est-ce que cela vaut « bouger soi-même » … ?
Après un bon jeu de combat virtuel – mais très actif (en immersion), on est sortie de cette salle pour se détendre avec les autres combattants – boire un café.
J'ai accidentellement renversé ma tasse de café sur les genoux d'une combattante, elle n'était pas contente. Elle a quand même vidé la ½ de son café-crème dans la mienne pour compenser – et tout le monde s'est souri – mais je ne savais pas que c'était parce que ma moustache était dorénavant couverte de crème fouettée – moi j'ai juste souri comme un idiot, comme tout le monde, quoi.
Après je leur ai dit « au revoir » pour aller dormir. Nous nous étions compatibilisés en fuseau horaire mais j'avais quand même un peu de jet lag – c'étaient des Sud-Coréennes habituées à faire la fête jusqu'à tard et partout.
Moi, je devais penser à me lever pour aller à la Poste, c'était 2019 et on n'avait pas encore changé en « tout numérique » – quelle fatigue !
Cet exemple met en question les avantages de « bouger soi même » sur « bouger les objets » … [comment diable est-ce qu'on a réussi à verser, ou à « recevoir sur les genoux » une liquide chaude, venant de l’autre bout du monde ?] mais la question n'est qu'à moitié sérieuse. Il y a sans doute des manières de tromper les perceptions des gens (drogues, prestidigitation, dissonance cognitive) – de simuler le phénomène.
Est-ce que « l’ambroisie » plastique remplit le creux dans l'estomac des goélands ?
Ce qui est moins sûr, c'est que ces méthodes virtuelles pour « bouger le monde » seraient à moindre frais opérationnels. On peut s’accorder que plus la distance et la vitesse d'exécution augmentent, plus le coût énergétique augmente.
… mais pour les super-riches, au contraire, cela évite des ennuis de voisinage …en avant les océans d'information, localisée, dispersée, codée, décodée, …
Très simplement, pour faire fonctionner un tel système, il faudrait convertir la matière même de la terre en énergie – il faudrait en faire un soleil.
J'ai du mal à voir la place des êtres humains là-dedans, il ferait beaucoup trop chaud.
Cette « mise en abîme » du système « énergie à gogo » vise à remettre la réalité physique humaine (somatique) au cœur de nos activités. Le tout numérique n'est point faisable, même pas en partie.
La qualité algorithmique de la Nature, la nature algorithmique de la Vie sont assez bien comprises, de nos jours. Essentiellement les plusieurs formes de vie ont trouvé plusieurs manières de vivre ensemble – à plusieurs échelles – et souvent entrelacées – à profit mutuel, depuis belle lurette.
Cette inertie que conserve la Vie, qui maintient la Terre en état d'accueillir le Vivant – avec l'apport du Soleil, bien sûr.
L'ensemble existe de manière co-évolutionnaire depuis des milliardaires – cette machine si affûtée par l'ensemble des conditions qu'a pu nous inventer le milieu terrestre – se distille en « savoir génétique », « patrimoine protéinique », « intelligence virale ».
L'essentiel étant le captage, l'échange, la transmission entre les êtres vivants – à profit commun (globalement) – un équilibre cohérent, dynamique, adaptatif.
Une forêt peut s'oxygéner, s'humidifier. Elle peut produire des catalyseurs qui lancent des actions en chaîne. Des nuages.
Ce sont des questions techniques – qui relèvent des techniques propres au vivant – de ses « comportements ». « Faire du vélo » est une adaptation technique du comportement « marcher/courir ». Son impulsion, tant en termes d'énergie qu'en termes d'orientation, est respectivement dans les jambes et dans les mains de l'opérateur.
Tout près et aussi léger que possible. La vitesse atteinte peut ressembler à celle où le détail de l'environnement reste encore accessible à la vision, à l'ouïe, à l'odorat et au toucher humains.
Une vitesse exagérée nuit à la sensibilité humaine. Elle réduit notre champs du perceptible et ainsi notre « intelligence cadente » du milieu. En termes « scientifiques » - conceptuels donc, pas juste techniques (exécution), le vélo a beaucoup d'avance sur la technologie véhiculaire d'aujourd'hui.
Et bien plus lorsque cette technologie est motorisée – ou biaisée par l'intermédiaire d'un petit écran tactile. Tout comme les caractères de cet écrit, le petit écran, ou l'immersion 3D, permettent d'accomplir des tâches réelles – commander de la matière à distance, le fameux « pizza », par exemple.
« Sans bouger » réellement, ces machines « font communiquer » et « font bouger ». Le poids est très lourd. On ne le porte absolument pas soi-même, loin s'en faut. On ne sait plus le poids qu'on fait porter. Il existe, il n'a pas été virtualisé, mais cela ne mérite même pas d'être su.
Le vélo, la liquide bouillante, la constipation, tant de maux qui s'alourdissent, derrière notre dos, cachés par le monde virtuel.
Ce monde réel qui nous est devenu subitement opaque.
dimanche 7 mars 2021
« Arbitre ». « Libre ». Est-ce que ce sont des mots qui vont très bien ensemble ?
Bizarrement, oui. Exercer son libre-arbitre, c'est exercer sa propre liberté décisionnaire. Un arbitre est celui qui tranche, qui décide. N'empêche que l'emploi de cette expression se fait souvent dans un cas plus contraignant : dans le but de remettre sur l'individu la responsabilité de ses actes, bien que le contexte dans lequel il agit n'y soit pas propice.
Le mot « arbitrage » sert souvent de remplaçant pour le mot « jugement ». Dans le sens de « décision » tranchée entre deux ou plusieurs positionnements.
Les gens disent à maints répétitions aujourd'hui « Il ne faut pas juger », mais mettons qu'ils disaient « Il ne faut pas arbitrer » ? On fait quoi alors ? Qui décide ? Chaque acte, chaque enchaînement d'actes représente une décisions. Qui décide ?
Le cadre dans lequel on décide est souvent « décisif ». Il détermine avec une probabilité haute ce qui va se passer. L'arbitrage est la reprise en main de ce sentier décisionnaire. A la base, il est une représentation de la possibilité d'être coopératif et mutualiste dans la prise de décisions sur son propre sort.
Cette idée se manifeste dans un autre mot qui a la même racine – « arbitraire », qui est défini dans le Petit Robert comme ce « qui dépend de la seule volonté, qui n'est pas lié par l'observation des règles ». C'est beaucoup dire. Si. Il y a une règle, que les partis soient volontaires pour accepter que le différend entre les partis soit tranché. L'encadrement réglementaire qui ne laisse aucun pouvoir de participer à la décision aux partis, c'est ce qu'il y a d'arbitraire là-dedans.
Le cahier de charges du libre-arbitre
Maintenant, appliquons ces raisonnements au cadre administratif de toutes nos vies. Qui a libre-arbitre ? Qui a droit à l'arbitrage – et par qui ? Quels sont les déterminants ? La « subsidiarité » est un concept déployé dans une tentative de faire face à ces questions. Ce principe veut que chaque décision soit prise à l'échelle qui lui est propre. Le problème est que les moyens techniques mènent à un pouvoir décisionnaire réel qui ne respecte qui n'a même pas d'idée de ce que c'est, une échelle. Le rapport ainsi établi avec les moins forts d'entre nous, même chez eux, dans leur intimité, est un rapport de force, sans arbitrage, sans qu'ils aient aucun pouvoir décisionnaire.
Tout « savant » pense apprécier ce problème. Il faut avancer. Il faut changer de paradigme. Les gens vont bénéficier de l'intelligence collective qu'on leur apporte. Ils ne sont pas équipés pour le faire assez rapidement eux-mêmes, de leur propre volonté. Le cadre administratif va permettre d'opérer les changements, décidés par les savants, dans le temps voulu.
Tout cela paraît bien raisonnable. Pourquoi, donc, est-ce que cela ne marche pas ? Déjà, est-ce que c'est vrai que cela ne marche pas, ou au moins que cela n'a pas marché ? Au niveau du secteur industriel, cela a plutôt marché. On pourrait dire que pour le citadin lambda, aussi. Il achète ce que produit l'industriel, il se transporte dans sa voiture et il utilise le portable. Toutes ces choses augmentent "sa" capacité physique et mentale de manière considérable.
Sauf qu'il n'a l'exercice d'aucun libre-arbitre. Il n'arrive même plus à bien parler, puisqu'il y a divorce entre parole et acte. Ses actes sont les actes prescrites – mais l'asservissent plus que jamais aux variables qui lui échappent.
« I'm the urban spaceman. I don't exist » (David Bowie) est à peu près le summum de ce paradoxe.
24 octobre 2020 (rev. 201109)
L’œuvre de l’activiste écologique est celle du simpliste – trouver un chemin logique et direct envers une infrastructure écologique qui vaille le nom, en la tentant. Pour voir clair, on abandonne l’argent et l’essence.
Après une pratique assidue de cette discipline pendant sept ans, on découvre que la technique applicable est celle de la machine sociale humaine, avec un premier constat : il faut que ça bouge pour que ça marche, il faut que ça marche pour que ça bouge.
La liberté de mouvement, c’est la liberté qui permet la liberté d’association. Les deux rendent possible la transmission et la réception d’information nouvellement pertinente. A pied ou à vélo, on peut librement se croiser et se parler au passage. La machine sociale humaine dont il est question est celle qui véhicule la liberté de créer des algorithmes entre nous, de créer des entités sociales communiquantes et agissantes.
C’est l’exercice de ces libertés-là - celles nommées « autonomie » et « choix » que nous cédons aux machines numériques, réchauffantes, climatisantes, transportantes. La démocratie non-participative est une autre de ces vases communiquantes iniques à la fonction sociale humaine, les réseaux dits sociaux en font une autre.
La constitution d’entités sociales qui bougent a un effet « dynamisant », tandis que le sédentaire se trouve séparé de ses pairs – à moins qu’ils bougent envers lui, lui obligeant, séduisant, attirant, comme une fleur sur laquelle on atterrit. L’utilisateur du numérique permet aux réseaux informatiques d’assumer des fonctions auparavant déléguées aux cerveaux interdépendants. Il ne lui est plus nécessaire de marcher à la rencontre de personne. Présentiellement, il n’est pas là.
Dans les communautés hermétiques ainsi créées, on peut trouver des athées humanistes, tout comme on peut trouver des croyants humanistes. L’écrit, notre Bible, notre phare intellectuel, est en quelque sorte mort. La conversation aussi. On ne peut plus parler des écrits. Les deux registres s’effacent – on parle à sa réflexion dans l’écran, comme on le sent. Sa famille toute entière est dans l’écran dans le creux de sa main.
On parle à sa main, alors que la personne en face rétrocède au loin. Sa famille tout près, on y est. On change de paysage, mais son portable, il est là, en soi. Finalement, changer de paysage, à quoi ça sert ? Cela ne vaut même pas l’effort additionnel. On est toujours chez soi, même ailleurs. C’est toujours de soi qu’il est question. Le monde bouge dans son téléphone, on le suit, on en est avataré. Nulle part physique, sauf ailleurs. Le monde s’efface autour de son petit écran, point brillant dans les ténèbres sociales tangibles.
22 mai 2014
Une vie suffit, ne prenons pas la vie aux autres pour fournir les nôtres.
Là où on dit que tout le monde a son prix, rions et marchons dans l'autre sens.
Soyons généreux, pour empêcher le radin de prendre l'ascendant.
Refoulons le tyran, faisons que les lieux collectifs soient des lieux d'inclusion, et non d'exclusion.
Accordons-nous l'opportunité de mener des vies bénéfiques à la Terre et à nos pairs, insufflons-nous la confiance,
Militons pour la dignité humaine et l'égalité des droits, soyons responsables envers notre environnement, tant humain que naturel.
Ne tardons pas, il y a tout à faire, commençons chez nous dans les pays riches et nocifs,
Abnégons notre richesse superflue, pour soutenir ceux qui pataugent dans la misère de notre exploitation,
Réattribuons au système socio-économique des valeurs franches, sans fatalisme cynique et complaisant,
Ne renonçons à rien, surtout pas à la liberté des autres,
Ne parlons jamais de notre libre choix et de la tolérance de nos multiples voies …
… si celles-ci tuent le monde notre monde à tous.
Encadrons notre propre licence avant de maudire nos gérants.
Récupérons la vie politique à notre échelle, pour éviter la facilité de l'absentéisme vide de sens,
Vivons dans le temps, respectons les anciens combattants en faveur de la décence humaine,
Élançons-nous vers les combats futurs, vivons ainsi notre présent, la quatrième dimension,
Traçons-nous des lignes, nous, points mouvants dans l'espace,
Sans occuper plus de place que celle qui nous sert à continuer sur
Le chemin des imparfaits et des plus que parfaits que nous sommes, tous, ensemble.
mai 2018
On vit une sorte de vie intérieure à la
City du Mirail déraillée par la Bullition
et l'encapsulation et la corridorisation
dans ce vaste labyrinthe d'insectes sociaux
que nous nous sommes créé pour nous
Co-conniser et nous Bétonniser en
cellules scellées de rûche communautaire
L11-11 ans d'enfermement, D12 – 2 ans avant la retraite
ACDN+2Q - R101-2 – ça vous parle ?
L'apex de l'industrie Architecturale
Livre ses fruits, gris re-contre gris du ciel
Arrrchééés en prisme carcéral
Le ferment se fait à pression froide
en petits groupes de fébriles fumeurs
Parsemés sur les allées à se geler les proverbiales
Jusqu'à ce que culoir s'ensuive …
Isolés dans l'espace, les gens se ramassent
pour s'écouler lentement sur les allées et puis
s'enculotter de nouveau dans les
Bunkers tachetés de l'Orange
des Troubadours Brevetés
¿Quién vaincrÁ ?
* * *

Recordando a Pablo Neruda
En Odas Sacrilegiosas (2003)
El corazón de la alcachofa
es tierno y dulce
pero la flor de la alcachofa
no se come ni se conoce
porque ya se comió su cúpula
solamente los jardineros flojos
conocen su flor incomestible
así asegurando su propagación
5 Septembre 2013
Dreams dream dreams
Hinterland blend
One language
Into another
An expressive fillip
How sad
One forgets
Echoey vault recede
Traces fade
In the fog
Real nothingness
On either side
No end calling
No back drop
Continue, dream
Lead up, lead on
Do not leave me
Cowering nude
Protect me from evil
Relieve memory
Replace thought
Faut arriver à des méthodes qui marchent …
Un modèle vectoriel réel – il vectorise tout. Il prend partie en faveur de l’espace-temps comme fondement systémique.
Ainsi les décisions prises correspondent aux acteurs qui bougent. Tout est rythmé au diapason des mouvements effectués.
Les écrits, comme les images sur ce site, sont sujet-centrés. C'est la recombinaison de ces sujets qui retisse le grand monde.
Partir de plusieurs perspectives paraît bien raisonnable et cohérent. Faire épanouir ces cohérences en sollicitant au lecteur de devenir coopérant - mais n'est-ce pas ce qu'il fait en lisant ? Qui le sait ?
L'ossature épurée, intuitive, crée la forme. Chaque instrument technique est, dans la mesure du possible, une clé d'accés langagier.
Dans la section images nature le français, l'anglais et l'espagnol apparaissent dans les rubriques "titre", "alt", "caption", dans les adresses des pages web, dans l'arborescence des dossiers. Le jargon "machine-friendly" qui sert à nos ordinateurs est soigneusement annoté, de telle manière que cela nous devienne potentiellement intelligible.
révisé mercredi 8 janvier 2025
INECODYN signifie :
"infrastructure écologique dynamique".
Une proposition générique - en faveur de la diversité culturelle du vivant
ecowiki en chantier participatif
mail : inecodyn@singularity.fr
cv09, c'est chemin vert 09, Ariège (09), à partir de 2009.
On va laisser ce message qui suit tel quel - mais c'est plutôt que l'on cherche un lieu physique de stockage. Bien des réservations à l'égard de labase de données maintenant.
cherche collaborateurs pour mettre en oeuvre une base de données (Mysql?) avec l'objet de créer des listes de denrées et d'autres articles à déplacer, à donner et à recevoir au niveau local
Les flèches du menu globe (en haut à gauche) permettent de choisir votre cadre de navigation.
Chaque écrit peut s'imprimer individuellement en cliquant sur le logo "imprimante" pour aller au document, que vous pouvez ensuite imprimer moyennant le menu "fichier" ("file") de votre navigateur.
En dessous du symbole de l'imprimante, il y a une flèche vers le haut pour retourner à l'article précédent et une flèche vers le bas pour passer au prochain écrit.
Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir au début de page.
Les écrits se trouvent dans le dossier "intxt" et les images dans le dossier "images".